08/02/2012
Les couleurs du Maroc
L’ŒIL ET LA MAIN

Fatna Gbouri: La femme tatouée,1987
C’est au Maroc profond des plaines atlantique que Fatna Gbouri qui vient de s'éteindre à Safi, a vu le jour en 1924. Plus précisément dans la localité de Tnin el Gharbia aux frontières des Abda et des Doukkala. Paysanne elle y a longtemps moissonné pour subvenir aux besoins de sa progéniture avant d’aller travailler comme tisseuse à khouribga puis à Safi où elle allait côtoyer quotidiennement la colline des potiers mais aussi la place des conteurs à Sidi Boudhab, le marabout de l’or.

Fatna Gbouri: Femme et tapis, 1986
Aujourd’hui elle reconnaît trois sources d’inspiration à son travail ; le tissage, le tatouage et le dessin au henné :« Pour travailler le tapis, j’achetais les couleurs naturelles au colporteur : le jaune, le vert, le rouge, le bleu. Le médaillon central je le tissais en blanc. Dans mes tapis je reproduisais aussi des images familières : la théière, la bouilloire, le brasero ainsi que des fleurs. Le dessin au henné, je le reproduis sur des peaux de mouton. Je m’inspire aussi des tatouages de Zayan, car nous avons vécu là-bas un certain temps lorsque j’étais toute petite. Mon père, tailleur de son état que j’étais à confectionner les caftons, était quelque peu nomade, de sorte que nous avons vécu successivement chez les Doukkala, les Zayan, à khouribga et enfin à Safi.»
Une errance qui lui a permis de beaucoup apprendre sur les expressions visuelles traditionnelles de ces différentes régions. N’ayant plus la force de travailler au tissage, elle s’est mise à peindre des poteries qu’elle va vendre « aux marchands de tableaux » comme elle dit si joliment, pour signifier que ces marchands n’étaient pas des connaisseurs et qu’ils dévalorisaient ses ouvres en la destinant aux simples touristes de passage à Safi.
Mais cette expression des signes et des symboles associés à des images anthropomorphiques et floraux, fortement codifiée par des traditions millénaires, ne lui permet pas de se démarquer encore de la masse des tisseuses et des potières traditionnelles, en tant qu’artiste. Il a fallu attendre l’âge de soixante ans, pour qu’en 1984 son talent soit enfin révélé et reconnu en tant que tel. Une rencontre fut déterminante :« Cette année là, j’ai peins une tisseuse en train de carder la laine sur un plat de plâtre. Dés le premier coup d’oeil Boujamaoui reconnu immédiatement ce travail comme étant une œuvre d’art à part entière et le présenta en tant que telle à une exposition collective organisée alors par une association culturelle de Safi. »

Fatna Gbouri : Les deux moissonneuses, 1990
Dés lors, la paysanne anonyme de jadis sort de l’ombre et porte un nom célébré dans les expositions et les galeries. Une artiste est née. Dés lors, ce que le tissage traditionnel inhiba en elle , explosa dans un foisonnement d’images et de couleurs éclatantes, libérant son énergie créatrice. Dés lors, la peinture a « dénoué » en quelque sorte, sa créativité entravée jusque là par le tissage. Elle passa ainsi de l’artisanat à l’art. Et ce passage fut ressenti par elle comme une libération d’énergies contenues jusque là :« J’ai ressenti comme un soulagement, et une grande satisfaction à chaque fois que je termine un tableau. Je me suis mise à peindre de mémoire ce que j’ai vécu par le passé : une chikhate en train de chanter, le moussem de Moulay Abdellah Amghar d’El Jadida que j’avais visité il y a fort longtemps avec ses escouades de cavaliers, celui des Aïssaoua, ainsi que la femme de Sidi Rahal, que j’avais vu boire de l’eau bouillante en état de transe. »

Fatna Gbouri: Dresseur de singes 1986
Et ce sont toujours ses souvenirs d’enfance qui lui reviennent chaque fois qu’elle se met à peindre. Elle peint ainsi Taghounja, cette déesse de la pluie, qu’on habillait jadis comme une poupée, et qu’on promenait à travers champs, en période de sécheresse pour implorer la pluie :
Taghounja, Taghounja comme l’espérance !
Ô mon Dieu donne nous de la pluie !
L’épi est altérée, donnez lui à boire ô maître !
Les récoltes sont altérées, arrosez, ô vous qui les avez créées !
Elle se souvient encore de ce qu’on chantait dans son lointain village de Tnine el Gharbia en période de sécheresse :
Ô mère de l’espérance !
Demande à ton maître de nous accorder de la pluie !
C’est en souvenir de ces antiques rites rogatoires qu’elle a peint Taghounja, cette grande cuiller en bois de noyer qui sert à puiser de l’eau et qu’on habillait en poupée, avec « la vache noire », qu’on promenait également pour implorer la pluie, en chantant :
La vache a demandé la pluie
Demande à ton maître de nous accorder la pluie
Ô vache ! Pisse ! Pisse !
Accorde nous des épis....

Fatna Gbouri: L'âne,1987
De tout ce monde disparu, Gbouri se souvient et le reproduit de mémoire dans un plan unique sans considération pour les lois de la perspective en profondeur. Exactement comme elle faisait jadis avec la tapisserie. Tout ce qu’elle peint relève de la mémoire visuelle, et n’est nullement en rupture avec ce qu’elle avait appris tout le long de sa vie. Un parcours initiatique qui l’a prédisposé à la peinture. En effet, dans les arts populaires, seuls les tissages et les poteries, de villages ruraux comme celui dont elle est issue, reproduisent des représentations figuratives où s’opère une véritable transfiguration de la nature.

Fatna Gbouri: Deux paysans 1986
Le passage du tissage à la peinture libère ses énergies créatrices. Pour elle,, les couleurs sont un jeu au même titre que le tissage, la broderie ou le tatouage. Elle aime les couleurs gaies qui apaisent : le mauve d’amour, le bleu de la mer, le vert du printemps et de la forêt si proche, qui est un poumon pour la ville au même titre que l’océan, le jaune solaire, le rose nuptial. Par contre, elle utilise rarement le noir. Le noir, c’est l’ombre, et l’ombre, c’est l’âme même projetée en dehors du corps. C’est la puissance ténébreuse des choses.
Gbouri fut initiée à tout un ensemble de techniques du corps qui l’on prédisposée à la peinture : à la fois nakkacha, enluminant de henné les mains et les pieds, « tatoueuse », maquillant les visages, et enfin aidant son père à confectionner de beaux caftans bariolés, pour parer les mariées de leurs plus beaux atours, pour la cérémonie nuptiale de loghrama où elles sont couvertes de cadeaux de noce par les invités.

Fatna Gbouri: La mariée, 1987
La maîtrise de la teinture au henné, des formes symboliques du tatouage et l’art de parure des neggafa, ont inspiré ses premières peintures en particulier le goût des couleurs éclatantes des jours de fête. Toute sa démarche artistique est une transposition de ces techniques séculaires du corps, dans le domaine de la peinture. En troquant la seringue pour le pinceau, elle passe du tatouage des corps à celui des paysages, d’une technique du corps à une fête des couleurs. Une profusion de couleurs et de formes se générant les unes les autres, comme dans un jeu d’enfants sans perspective, mais avec beaucoup d’harmonie dans l’ensemble et une grande vitalité poétique intérieure. La surface de la toile lui impose une autre démarche. Au lieu d’embellir le vivant, elle réanime l’inerte : elle s’amuse avec les choses de l’imagination en peignant tout ce qui me passe par la tête. Au début, elle dessine une chose, mais aboutis à une autre. En particulier l’œil qui est le sens le plus important de l’homme, et la main qui protège du mauvais œil : « L’œil est précieux, nous dit Fatna Gbouri : l’œil chasse le mauvais œil. La main aussi chasse le mauvais œil. A l’occasion de la fête de l’aïd el kébir, on trompait nos mains dans un bol de henné et on les appliquait au dessus de la porte d’entrée, de manière à éloigner le mauvais sort. L’œil et la main on les reproduisait aussi dans le tapis traditionnel. Lors de cette grande fête, juste avant le sacrifice on faisait ingurgiter au bélier un mélange de henné et de blé en lui disant :Nous t’engraissons dans ce bas – monde / Pour que tu nous engraisse dans l’autre »

Fatna Gbouri: L'oeil et la main 1987
La main dont nous parle Gbouri est déjà représentée dans les peintures rupestres d’Afrique du Nord. Comme la main punique, la hamsa est bénéfique, presque sacrée : associée au chiffre cinq, elle en acquiert les vertus Une femme s’exclamant devant la beauté d’une mariée peinte par Gbouri ne dira pas qu’ « elle est belle » ! Mais « khamsa ou khmis » (cinq et jeudi sur elle !) ; jeudi étant le cinquième jour de la semaine. La hamsa protège de l’œil. Et la main protège contre l’œil, la langue et le destin.
Dans les derniers tableaux de Gbouri l’œil et omniprésent mais aussi la main : cette khamsaqui entraine dans les profondeurs du symbolisme de la fécondité, formulée d’une manière très variée suivant les civilisations. Ce thème apparaît dés les premières manifestations figuratives de la préhistoire, comme en témoignent les empreintes de mains sur les parois des grottes préhistoriques. Dans quelle mesure les symboles peuvent – ils traverser les millénaires en filiation continue ? On possède dans l’ancien monde de très nombreux témoignages qui joignent de siècle en siècle les confins de l’âge de bronze au monde actuel.

Fatna Gbouri: Sans titre 1987
Les signes et les symboles qui sont profondément ancrés dans l’imaginaire collectif, remontent spontanément à la surface de l’acte créateur, parce qu’ils constituent une composante essentielle de l’identité culturelle de l’artiste. Il s’inspire du stock de la mémoire visuelle des tapis et des bijoux berbères, mais aussi de la coutume qui consiste à se teindre les pieds au henné, en certaines occasions rituelles. Cette coutume remonte loin dans l’histoire : le nom par lequel les Egyptiens désignent les occidentaux qui les attaquaient souvent du 3ème millénaire au 15ème siècle, était Tahénnouqu’Ossendowsky traduit par « ceux du henné ». Les artistes s’inspirent aussi du tatouage qui était à l’origine une amulette permanente sur la peau. Ce qui prouve que le tatouage avait une signification magique de protection contre le mauvais œil.

Fatna Gbouri: Bleu d'absinthe, 1987
« Jaune » ou « bariolée » la mariée est omniprésent chez l’artiste, avec sa cérémonie du henné, entourée de fleurs, symboles d’amour et de renouveau, comme on le constate dans ce chant nuptial des plaines atlantique d’où est originaire notre artiste :
Nous sommes dans une nuit lunaire
C’est la nuit du bien aimé
Le henné tombe dans le lait
Nous sommes dans la nuit du parcours
Le henné tombe dans la cour...
Chante une chikhate. Un cavalier des Abda se lève alors et lui passe un collier de billets de banque au milieu des applaudissements puis se tournant vers ses compagnons, il entonne :
Ô gens des Abda aujourd’hui c’est la fantasia
Cette vie s’en va, c’est vers la mort qu’elle s’en va.
Jouissons doc du toast qui fait rougir les joues,
Jouissons donc du toast qui fait briller les yeux !
La chikhate lui réplique :
Ô mon cher, ne me ferme pas la porte de ton jardin,
Puisque c’est pour toi que mon cœur brûle de chagrin !

Fatna Gbouri: DANSE DU THE 1987
L’aïta (l’appel) est un genre musical, spécifique aux plaines atlantiques arabophones, céréalières et pastorales. Remontant à l’implantation des Béni Hilal et des Béni Maâquil, elle porte la marque des chevaliers errants tout autant que d’une sensualité ritualisée. Il faut avoir une oreille d’initié pour distinguer ces différents genres. On y accorde la plus haute importance à la parole proférée lentement, couplet par couplet, en imitant gestuellement, corporellement, le flux et le reflux des marées :
« Allons voir la mer
Restons face aux vagues jusqu’au vertige ».
L’aïta, c’est l’appel. S’agissait-il, dans quelques antiques origines, d’un appel aux divinités de la nature ? On retrouve dans les œuvres de l’artiste populaire Gbouri les mêmes saveurs qu’on découvre dans les chants des plaines côtières :
En éperonnant le fauve (al Bargui),
Elle m’a piqué au cœur.
Combien de porteurs d’étendards
Ont accompagné les chevaliers errants ?
C’est surtout lors des moussems-fêtes foraines à la fois commerciales et religieuses, réunissant plusieurs tribus autour d’un sanctuaire, généralement après la période des moissons - qu’ont lieu les manifestations collectives les plus éclatantes :

Fatna Gbouri: Au foyer,1986
Moi aussi, El Hâjj Bouchaïb
J’irai au moussem le cœur en fête
D’une tente immense, je planterai les piquets
Et de tapis multicolores, je couvrirai l’intérieur.
L’Oum Rbia, « la mère du printemps », s’il n’étanche pas la soif de la terre - il passe par la Chaouia sans l’arroser - n’en menace pas moins les hommes de son inondation :
Oued ! Oued ! Ô Oued
J’ai peur de tes inondations !
Zine, Zine, Ya ma !
J’ai peur de tes foudres !

Fatna Gbouri: Jeux de bergers, 1986
Il existe une aïta dédiée à Rabbouha, qui fut emportée par l’Oum Rbia. Sa sœur qui était une chikha s’est mise à se lamenter, en promettant ses charmes à celui qui la sauverait :
Et la chevelure de Rabbouha
Ondulant au milieu de l’inondation
Chaque tresse couvrant une vague.
Et les vaches de Rabbouha
Errant dans les territoires de l’État,
Que celui qui les reconnaîtra
Les emmène à l’abreuvoir !
On retrouve chez Gbouri des filles au bord de la fontaine pratiquant la corvée de l’eau, on voit des femmes-serpents dans un entrelacs inextricable – des croyances accordent au serpent des vertus de protection et des attributs sacrés – et surtout l’œil omniprésent répété à l’infini comme une prière tendant à remplir le ciel de la cosmogonie. Gbouri semble chanter avec cette chihate des plaines côtières :
Ton œil, mon œil
Enlace-la pour qu’elle t’enlace
L’aurore me fait signe
Le bien-aimé craint la séparation.

Fatna Gbouri: Thé, 1991
Les toiles de Gbouri sont aussi à leur manière un hymne à la beauté de ces plaines côtières si lumineuses dont elle est issue. Le tout baignant dans une profusion de couleurs à la fois chaude et éclatante. Abdelkader MANA
14:21 Écrit par elhajthami dans Aïta | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
05/02/2012
Les fêtes du Mouloud
La religion des femmes

Veille du Mouloud, une rumeur persistante circule au pays, à Casablanca, dans les trains et à Meknès même : cette année la procession des cierges de Salé n’aura pas lieu. Le deuil suspend la fête de la nativité à Salé, comme si la procession avait été frappée, en ce bord de l’Atlantique par l’onde de choc de la lointaine Palestine. Les morts de Naplouse, ceux de Jenine et les bannis de l’église de la Nativité – dont les images passent en boucle sur les ondes d’Al Jazira suspendent la fête de la Nativité du Prophète à Salé.
Chez les Trobriandais du Pacifique occidental aussi, nous dit Branislow Malinowski, la circulation des objets et des hommes, ne s’arrête qu’à l’occasion de la disparition d’un grand personnage. Les morts suspendent, le temps du deuil, les fêtes des vivants.

Peu importe que la procession des cierges ait eu lieu ou pas : la rumeur est significative en elle-même, puisqu’elle est née de l’air du temps. Elle concerne l’interruption cette année d’une procession qui ouvre au Maroc les fêtes du Mouloud, qui aurait été instituée par le Sultan saâdien « victorieux et doré », au terme d’un voyage en Orient où il aurait assisté à Istamboul à un carnaval de poupées colorées ornées aux fleurs de cire. Par sa naissance comme par ses multiples injonctions au « temps suspendant son vol », qui ont ponctué son histoire tel l’exil de Mohamed V à Madagascar la procession salétine vibre au rythme du monde. On dirait, aujourd’hui, qu’elle est suspendue au soupir de la mondialisation.
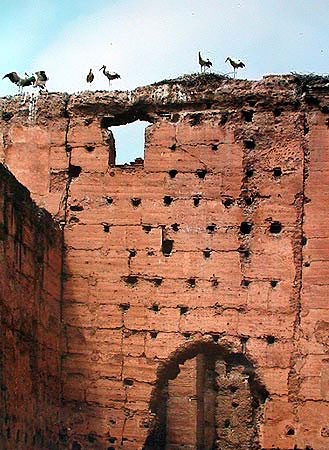
L’histoire confirme la tradition. En effet, al-Ifrâni, consacre à la préparation de la nativité du Prophète sous le règne d’Ahmed El Mansour Dahbi, une description assez détaillée et assez précise pour qu’on puisse l’identifier sans le moindre doute avec celle de Salé : il s’agit incontestablement des mêmes cierges, dont l’aspect évoquait déjà l’image de rayons de cire. Voici ce qu’en dit El Ifrâni :
« dés qu’on apercevait les premiers rayons de la lune de Rebia I, le souverain adressait des invitations à ceux des faqirs de l’ordre des soufis qui exerçaient les fonctions de muezzins et se dévouaient à faire les appels à la prière pendant les heures de la nuit. Il en venaient de toutes les villes importantes du Maroc..Ordre était ensuite donné aux marchands de cire de préparer un certain nombre de cierges et de mettre tous leurs soins à cette fabrication. Aussitôt ces habiles artisans se mettaient à l’œuvre et rivalisaient de zèle comme font les abeilles lorsqu’elles construisent les gracieux enchevêtrements de leurs alvéoles. Ces cierges avaient une grande variété de formes ; ils étaient si élégants qu’ils émerveillaient les regards et leurs couleurs étaient si vives que leur éclat ne palissait pas devant celui des plus belles fleurs. La veille de la Nativité, les gens dont le métier consiste à porter les litières des fiancées lorsqu’on les conduit à leurs maris se mettaient en devoir de transporter en grande pompe ces magnifiques cierges. Ce cortège était si brillamment ordonnancé et présentait un si beau coup d’œil que les habitants de la ville accouraient de tous côtés pour les contempler. Aussitôt que la chaleur du jour commençait à se calmer, les porteurs se mettent en marche, tenant sur leur tête ces cierges qui semblaient être alors de jeunes vierges traînant les pans de splendides tuniques ; leur nombre était tel qu’on croyait voir une forêt de palmiers. Le cou tendu, hommes et femmes se bousculaient pour admirer ces porteurs de cierges que suivaient d’habiles musiciens jouant du tambour et de la trompette. Dés que l’aurore aparaissait, le sultan sortait du palais, faisait la prière avec la foule du peuple, puis, vêtu d’une tunique blanche emblême de la royauté, il allait prendre place sur le trône devant lequel on avait déposé tous les cierges aux couleurs variées, les uns blans comme des statutes, d’autres rouges, tous garnis d’étoffes de soie pourpre et vertes, à côté étaient rangés des flambeaux et des cassolettes d’un si beau travail qu’ils causaient l’admiration des spectateurs et émerveillaient les assistants. Cela fait, la foule était admise à pénétrer ; chacun se plaçait selon son rang, et quand tout le monde avait pris place, un prédicateur s’avançait et faisait une longue énumération des vertus du Prophète et de ses miracles. La conférence terminée, tous les assistants accomplissent les cérémonies de l’office de la Nativité, puis on voyait alors s’avancer les membres des confréries murmurant les paroles d’ach-chuchtûrî (célèbre soufi andalou ayant vécu au Maroc et mort en 896) et celles d’autres soufis, tandisqu’une troupe de coryphées déclamait des vers en l’honneur des deux familles (celle du Prophète et celle d’Al Mansour). » (d’après « Nozhat El Hâdî » d’Al Ifrânî).

Meknès, le samedi 25 mai 2002, premier jour du Mouloud. De partout d’immenses foules dévotes et bariolées convergent vers le sanctuaire du fondateur de la confrérie des Aïssaoua. Au début du XVe siècle, en pleine effervescence mystique maghrébine de lutte contre la pénétration portugaise, El Hadi Ben Aïssa aurait, dit-on, quitté son hameau des Mokhtar dans le Gharb pour aller parfaire son savoir théologique à Fès avant de venir s’établir finalement à Meknès dans une « khaloua » : paradoxe de l’ermite, le solitaire deviendra populaire. Pour stimuler la foi religieuse autour de lui, il allait, racontait-on, jusqu’à rémunérer ceux qui acceptent de délaisser les gains d’ici-bas pour les promesses de l’au-delà.
Sous un soleil matinal, les taïfas du Gharb, étendards en tête, se succèdent les unes aux autres. À l’approche du sanctuaire, comme happé par les énergies spirituelles du seuil sacré le horm hommes et femmes accourent pieds nus, chevelures au vent, souffle haletant, regard hagard. Humanité pathétique qui semble avoir laissé derrière elle, charrue et travaux des champs pour venir ici à la rencontre du divin. Pathétiques et néanmoins beaux, par leur quête du céleste et du sacré, sont ces paysannes disgracieuses et ces vieillards édentés aux pieds calleux, retrouvant en ce temps du pèlerinage, jouvence et nouvelles énergies. Au terme d’une course éperdue, ils s’accrochent au catafalque du saint pour y trouver réconfort et purification. Au cours de cette course effrénée, ils doivent enjamber le corps de pèlerins à plat ventre au seuil du mausolée, comme pour leur transmettre l’énergie bénéfique dont ils sont sensés être porteurs en ce moment de grâce. La croyance veut que par ce geste, ils contribuent à dénouer les entraves visibles et invisibles dont on cherche délivrance, auprès d’Aïssa le guérisseur des aveugles et des paralytiques.

Parmi les taïfa rurales du Gharb, c’est celle d’El Mokhtar dont est issu le cheykh el Kamel Hadi Ben Aïssa serait né vers 1450 qui ouvre en ce premier jour du Mouloud, la marche des processions. Cette taïfa aurait le pouvoir de remettre debout les paralytiques en piétinant leurs corps. Chez les pèlerins, sous un soleil matinal éclatant, la tunique blanche, symbole de pureté prédomine. Car, malheur à qui est vêtu de noir, il risque à tout moment de s’attirer les foudres des « lions » et des « lionnes », possédés par l’irrésistible esprit de la « frissa », de la consommation rituelle de la chair crue d’une victime expiatoire au pelage noir, bouc ou taureau. En souvenir de ce rite aïssaoua, aujourd’hui aboli, les possédés du lion symbole solaire, se ruent sur tout porteur de vêtement ou d’objet de couleur noire.
Sur la place sacrée où auront lieu les sacrifices au troisième jour du Mouloud, au cœur même du mausolée, de nombreuses pèlerines viennent passer une nuit d’incubation, dans le secret espoir d’entrevoir en un rêve divinatoire, le cheikh el Kamel en personne, ordonner leur délivrance des souillures et des nœuds qui entravent le cours de leur vie ici-bas.

Comme à l’accoutumée, sous le vieux mûrier, au rythme du tambour et d’un air lancinant de flûtes traversières, les « charbonniers » de Meliana, venus d’Algérie, exposent leurs corps au bûcher sans être pour autant sensibles aux flammes. Attire particulièrement l’attention un vieux danseur au torse nu noirci par ses deux tisons enflammés, qui évoque curieusement à la fois, le Bossu de Notre – Dame de Paris et le gardien de la Géhenne de Dante. Juste, en face, une troupe Haïyata jouant le répertoire haletant dit du « hiit », spécifique à la région du Gharb entonne des chants qui sont autant de vœux pour la régénération de l’année à venir :
« Ô jeunesse, ne t’en fais pas trop, pour ton mariage.
La plus belle des filles sera bientôt pour toi ! »
L’un des signes d’élection spirituelle est le port de la « gouttaya », touffe de cheveux qu’on laisse pousser à la partie postérieure du crâne entièrement rasé. Je demande à l’un de ces personnages étrange :
- Pourquoi portez-vous cette touffe ?
- Parce que Sidi Mohamed Ben Aïssa attachait sa « gouttaya » à un arbre pour prier de jour comme de nuit, sans être vaincu par le sommeil ; celui qui n’est pas capable de porter la gouttaya ne doit pas la laisser pousser.
Venir à ce moussem pour ce personnage énigmatique du Gharb est une obligation :
- Si je ne viens pas au Mouloud, je tombe malade. Des fois, j’arrive au seuil de la mort. Mais quand ils m’emmènent au cheikh, je me rétablis aussitôt.

Toujours plus bas, en s’éloignant du sanctuaire, dans un espace périurbain, mi-rural, mi-citadin, s’étend, l’immense souk du barouk, avec ses tentes, ses bouchers et autres marchands de fruits secs, ses immenses roues et autres jeux forains, ses musiciens ambulants et autres dresseurs de singes. Ce sont mille clameurs qui s’entremêlent tandis qu’au loin retentissent les détonations des fantassins et de la fantasia : au Maroc le baroud ouvre généralement un nouveau cycle. Ces réjouissances hippiques sont parfois ponctuées d’incidents : sous nos yeux, un homme traversant le champ de course, fut violemment heurté et piétiné par la charge des étalons. Mort ou vif. Une fois l’homme évacué, la fête continue comme si de rien n’était.

Au crépuscule une ultime taïfa se présente au seuil du mausolée. C’est dans la nuit brune, au minaret jauni, la lune, comme un point sur un « i ». La pleine lune préside à l’ouverture du Mouloud, portant au paroxysme, toutes les énergies cosmiques : comme les marées montantes, les transes se voient décuplées. Les ruelles de la vieille médina s’animent de tambours et de hautbois pour des veillées domiciliaires aïssaoua, qui dureront jusqu’à l’aube.
Au deuxième jour du Mouloud, on est surpris de constater vers la mi-journée que déjà le souk du barouk et la fantasia ont plié bagages. Les ruraux ayant décampé de la zone périurbaine les citadins entrent en scène : à l’apaisement des ardeurs solaires, à partir de la monumentale Bab-el-Mansour, le cortège de la taïfa de Fès s’ébranle vers le mausolée du cheikh el Kamel. La famille Battahi de Fès y envoie en offrande deux beaux lustres que des adolescents portent au-devant du cortège. Viennent ensuite les danseurs aïssaoua scandant « Allah Hay ! » (Dieu est vivant). Fermant la marche, cinq hautboïstes sur leurs vieux mulets. Arrivée à hauteur du mausolée, la musique de procession cesse pour faire place à la hadhra proprement dite : danse extatique des citadins qui s’oppose, à bien des égards, à la possession rituelle par les « lions » et les « lionnes », à laquelle nous avons assisté la veille avec le défilé des taïfa rurales.
Les offrandes comportent outre les lustres de la taïfa de Fès, les tapis de celle de Casablanca, et même la couverture du catafalque. Chaque année ces accessoires du mausolée sont renouvelés en guise de régénération et de renaissance.
Au sortir de ce pèlerinage, nous apprenons par une dépêche que l’ancien ministre gauliste et islamophile Michel Jobert est mort le dimanche 26 mai à 0 h 30 à la suite d’un malaise, c’est-à-dire à l’aube du Mouloud. En effet Michel Jobert était né à Meknès le 11 septembre 1921. En tant que journaliste, j’ai eu à interroger à deux reprises l’auteur du Maghreb à l’ombre de ses mains : il tenait à chaque fois à revoir avec minutie la copie, à la virgule près, avant de l’envoyer au journal. Mais il le faisait avec beaucoup de tact et une infinie gentillesse. C’est en guise d’hommage que cet article est dédié à la mémoire du célèbre enfant de Meknès qui vient de nous quitter à l’âge de 80 ans.
Troisième jour du Mouloud, mont Zerhoun.
Les tentes des pèlerins venus pour le grand moussem annuel sont déjà plantées. Je découvre un monde insolite, avec ses voyantes installées sous de petites guérites de toiles, ses troupeaux de boucs noirs parqués, en attendant d’être achetés et sacrifiés, ainsi que des poules noires enfermées dans de grandes volières.
J’entends le rythme sourd des grands tambours, les Herz des Hamadcha. J’y vais, et j’arrive à la grotte d’Aïcha. C’est un immense figuier aux feuillages compacts qui forme la grotte. Sur l’autel brûlent d’innombrables bougies. Juste à côté, au milieu d’une aire délimitée par des haies de branchages, se tient sa prêtresse. Plus loin, au fond, l’espace des sacrifices.
Trois femmes dansent au rythme des Herraz. Aïcha les possède et les entraîne dans un ballet échevelé. Puis je me rends au sanctuaire de Sidi Ali Ben Hamdouch. Là, le sol est jonché de nombreux pèlerins, surtout de femmes endormies ou en état de crise. J’ai l’impression de débarquer dans une véritable cour des miracles peuplée de possédés.
La nuit tombe. Maintenant du haut de cette montagne, on peut voir au loin dans la plaine, scintiller les lumières de Meknès. C’est le moment de la hadhra. Partout, sous les tentes, les Hamadcha venus du Gharb animent les veillées spirituelles, avec leurs hautbois et leurs tambours. C’est une musique saccadée et rapide, alors que celle des villes est lente et balancée. Les danseurs en transe, sautillent sur place interminablement. C’est la version rurale du rituel des Hamadcha. Ceux des villes arriveront demain.
Je rencontre une troupe des Jilala. Ils exécutent sur leurs grandes flûtes de nomades les airs mélancoliques du désert. Ils sont d’abord passés au Moussem des Aïssaoua de Meknès avant de venir ici. Ils y resteront jusqu’à la clôture.
Vers minuit, sous la pleine lune, un groupe de femmes avance en file indienne par les sentiers au flanc de la montagne. Elles portent leurs offrandes à Aïcha, dans son sanctuaire. L’une d’elles me dit qu’Aïcha aime qu’on lui offre de l’encens, des chèvres et des poules noires, du lait, du henné, et des tissus de soie colorés :
103Aujourd’hui, me dit-elle, on célèbre les fiançailles d’Aïcha. Dimanche prochain, septième jour du Mouloud, elle épousera Sidi Ali Ben Hamdouch.
Le cortège des femmes pénètre maintenant dans la grotte avec ses offrandes qui sont déposées sur l’autel. Elles y allument de nouveaux cierges. Elles apportent la chèvre à sacrifier et la poule noire à la prêtresse qui les bénit en parlant de « nœuds à dénouer » et de « portes à ouvrir ». Aïcha a fait des nœuds et a fermé des portes dans le destin des gens qui l’ont offensée et qu’elle a frappés. Raison pour laquelle ils viennent lui offrir des sacrifices de réconciliation.
Arrive le sacrificateur. Tout d’abord, devant l’autel d’Aïcha, il procède aux ablutions de la chèvre et de la poule noire, qu’il fait tournoyer par trois fois sur la tête et autour des épaules d’une femme accroupie. Puis il tranche la tête de la poule et la jette au loin. Enfin il égorge la chèvre noire qui se lève ensanglantée et se dirige vers les lumières de l’autel où elle va s’effondrer. Un peu plus tard, une famille aisée de Rabat, accompagnée d’une troupe de Gnaoua, apporte ses offrandes. Cette fois, on va immoler sept chèvres et douze poules. Les ruines de Volubilis ne sont pas loin d’ici. Peut-être gardent-elles le souvenir des sacrifices qu’on offrait jadis en ces lieux à la déesse Kadoucha ?
Marrakech, quatrième jour du Mouloud. En quittant le Zerhoun, j’ai laissé là-bas à leur moussem les Hamadcha du Nord. Je viens ici, à Marrakech, à la rencontre de ceux du Sud. Leur moussem commence aujourd’hui et se terminera dimanche.
À 18 heures, le cortège des Hamadcha marche avec le veau du sacrifice en direction de Riad Laârouss où se trouve leur zaouïa. Le sacrifice aura lieu demain à dix heures. J’apprends que les Hamadcha d’El Jadida, qui ont célébré leur moussem au premier jour du Mouloud seront présents ainsi que ceux de Damnate, Safi, Taroudant et d’Essaouira. Marrakech est la ville des innombrables zaouïas cachées et disséminées dans les ruelles de la médina. À Riad Laârouss, la zaouïa des Hamadcha illuminée de projecteurs et couverte d’étendards se prépare à recevoir les taïfa du sud.

Marrakech, cinquième jour du Mouloud.
Ce matin, comme prévu, je retourne à Riad Laârouss où je rencontre les Hamadcha de Safi à l’heure du petit-déjeuner. Les vieux adeptes échangent des couplets de melhûn autour d’un verre de thé. On attend les autres taïfa qui vont arriver dans la journée. Après le sacrifice d’ouverture, elles animeront à tour de rôle des séances de Dhikr et de Hadra. J’ai décidé de les quitter pour suivre le pèlerinage d’une prêtresse des Gnaoua, une talaâ, à Moulay Brahim au sommet de la montagne. Je me rends donc à Bab Rab, la porte du Seigneur, d’où vont partir pour Moulay Brahim les chamelles apportées par les différentes taïfa du Maroc. Elles seront conduites là-haut en cortège au rythme des Aïssaoua.

Moulay Brahim. À midi, j’arrive au pied de la montagne. Il y a là quelques pèlerins prenant un bain rituel près du moulin à eau, ainsi que quelques chamelles. Une femme qui est déjà venue ici l’an dernier n’est pas étonnée de voir si peu de gens cette année :
- L’année dernière, dit-elle, beaucoup de gens ont péri dans la grosse crue de l’oued qui a fait de nombreuses victimes. Alors que les autres années on avait beaucoup de mal à se loger, cette année, les courtiers vous courent après pour vous offrir les logements vides.
J’arrive à Moulay Brahim à une heure de l’après-midi. Des musiciens tournent autour du sanctuaire avec une jeune chamelle blanche couverte d’un tissu vert. Ce groupe vient des environs de Casablanca. Plus loin, voici une autre procession accompagnant elle aussi une chamelle : c’est la taïfa de Tarraste, en provenance du Sous. Et voici un troisième cortège avec sa chamelle en provenance des environs de Taroudant. Les cours intérieures des maisons qui font hôtellerie pour l’occasion sont animées par les Oulad Sidi Rahal avec leurs bouilloires et leurs serpents ; une autre troupe des Oulad Sidi Rahal, ceux de Bouya Omar, est venue pour animer demain des séances de Hadra. Un groupe de l’Ahouach des Houara ainsi qu’une troupe de Gnaoua d’Agadir proposent leur spectacle d’un patio à l’autre.
Sixième jour du Mouloud. Je pars à la recherche de talaât. Elles se trouvent, me dit-on, dans la maison attenante à la zaouïa. Il y a là, dans la cour intérieure, la grande chamelle qui sera sacrifiée. Elle a été amenée ici par Lalla Bacha une talaâ venue de Kénitra accompagnée de sa troupe de Gnaoua. Dans une petite pièce adjacente, les Gnaoua se reposent. Leur maître de cérémonie raconte :
- La chamelle a été achetée à Settat et on l’a amenée à Kénitra où la talaâ a organisé une lila le jour du Mouloud. De là, on a transporté cette chamelle à Marrakech par camion. On l’a conduite en procession depuis Bab Rab jusqu’ici, en passant par Tamesloht où notre talaâ a organisé une autre lila avec sacrifice d’un bélier. Nous resterons ici jusqu’au sacrifice de la chamelle.
Un peu plus loin, je rencontre une autre talaâ avec sa troupe de Gnaoua de Marrakech. Elle est originaire du Sahara et vit en ce moment en Belgique avec son mari, ancien travailleur immigré. C’est une grande et belle femme, imposante et couverte de bijoux :
- J’ai hérité mon activité de talaâ de mes ancêtres, dit-elle.
Puis son mari enchaîne :
- Elle vit avec moi depuis 32 ans, à Bruxelles. Elle y fat son métier de voyante par téléphone et sur rendez-vous pour les immigrés de là-bas et parfois aussi pour des clients européens.
La talaâ reprend la parole pour me raconter comment elle a découvert la vocation de médium :
- Je suis tombée en transe sans m’y attendre, et au cours de ma transe, j’ai commencé à « parler ». Je n’en étais pas consciente, ce sont les gens qui me l’ont dit à mon réveil.
Le parler en transe N’tiq est la caractéristique fondamentale de la talaâ. C’est son esprit allié, son melk, qui parle par sa bouche, et qui fait la divination. Elle dit :
- J’ai chez moi deux autels, l’un me vient de Moulay Brahim, l’autre de Sidi Ali, pour son rapport avec Aïcha Qandicha, la Gnaouia. Je tombe malade chaque année au mois de Chaâbane. Je dois alors organiser une lila. L’année dernière, c’était à Essaouira. Je suis arrivée au Maroc cinq jours avant le Mouloud, et ici le jour du Mouloud pour y passer toute la semaine. J’ai acheté la chamelle pour Moulay Brahim au souk de Had Draâ. Après le moussem, je monterai à Sidi Chamharouch, le maître de la divination, puis je me rendrai à Bouya Omar, et j’irai enfin au Zerhoune chez Aïcha Qandicha. Je dois faire chaque année ce grand tour qui dure deux mois avant de revenir en Belgique. Sans quoi je ne pourrais pas travailler.
J’entends soudain un cri étrange qui tient à la fois du jappement d’un chiot et du hurlement d’un chacal :
- Regarde derrière toi ! Ordonne la talaâ de Bruxelles.
C’est un homme accroupi tenant sa tête entre ses mains et qui aboie. Brusquement, il se lève et commence à aller et venir, se rapprochant, puis s’éloignant de moi. Je ne suis pas rassuré. Il crie qu’il est Aïcha Qandicha :
- Je suis la reine des vallées et des fleuves ! Des forêts et des déserts ! J’attaque celui qui m’agresse !
Il parle avec un accent féminin. Et soudain, j’entends tout près de moi une autre voix, cette fois-ci masculine. C’est la talaâ en transe qui s’adresse à moi en criant :
- Ferme ton bloc-notes et va-t-en d’ici !
Alors qu’ils continuent leurs imprécations à mon encontre, je quitte les lieux en courant. Un peu plus tard, le Gnaoui de l’autre talaâ me dit que c’était une comédie pour essayer de m’extorquer de l’argent. Et beaucoup plus tard, quand je rencontre à nouveau la talaâ de Belgique alors qu’elle a retrouvé, me semble-t-il, son état normal, elle me dit :
- Aïcha a estimé que l’entretien était allée trop loin. Je ne devais pas vous livrer notre secret. C’est elle qui s’est adressée à vous par ma bouche pour vous demander de partir.
Midi, il fait très chaud, et je me promène à travers le village. Le Gnaoui de Marrakech vient à ma rencontre. Je l’invite à partager un tagine. Au cours du repas, il me dit combien le progrès de la modernisation au Maroc fait reculer les croyances traditionnelles :
- Dans les années soixante-dix, on apportait au moins dix-huit chamelles chaque année à Moulay Brahim, dont quatre de Marrakech. Maintenant, seuls les tanneurs de la ville rouge apportent la leur à l’oiseau des cimes. Même chose pour Casablanca d’où arrivaient cinq camelins pour un seul aujourd’hui.
Il est environ dix-huit heures lorsque les tanneurs de Marrakech, qui étaient déjà dans la zaouïa, en sortent avec leur chamelle, la seule qui sera sacrifiée. C’est une sorte de mise en scène, où tout se passe comme s’ils arrivaient sur les lieux. Leur procession fait le tour du marabout.
Moulay Brahim, septième jour du Mouloud. Ce matin, ce sont les Aïssaoua qui animent la place du sacrifice. À 9 h 30, on accompagne la chamelle hors de l’enceinte, du côté de l’entrée nord de la zaouïa, au milieu d’une foule bariolée, ensoleillée et joyeuse. La chamelle porte sur sa bosse une écharpe blanche où il est écrit : « Mohamed Messager d’Allah ». Étendards, tambours, crotales, la chamelle bouge. On l’oriente vers l’Orient. Une femme commente :
- Quand on veut la sacrifier, on lui fait manger du henné et on lui fait faire le tour du marabout. Certains s’abreuvent de son sang et il y a beaucoup de bagarres.
On lui enlève l’écharpe, mais elle se relève. Alors qu’elle est encore debout, beuglant de plus belle, on lui tranche le cou à la racine. Elle perd des flots de sang, on ouvre la porte nord, on la traîne à l’aide de cordes sur une pente glissante et à l’aide d’une hachette, on achève de lui trancher le cou. De vigoureux jeunes gens emportent la tête à toute allure, dévalant la montagne en direction de l’oued. La tête semble continuer à beugler toujours, quoique de manière aphone. Elle doit pousser son dernier soupir au moulin à eau si on veut que l’année qui vient s’annonce fertile.
Le corps gisant sans la tête tremble toujours. Une femme s’évanouit. On commence le dépeçage par le haut. On empêche les gens de prendre des photos. On enlève la bosse, considérée comme une ressource thérapeutique pour l’asthme. À l’aide de la hachette, on sectionne les pattes antérieures, puis les postérieures. On ouvre par le dos la carcasse agenouillée : tout est énorme en une chamelle ; ses poumons, son foie, son cœur, ses entrailles. Chaque organe pèse plusieurs livres. Le tout sera partagé entre les cinq cents Chérifs descendants du saint. Les pèlerins réclament un peu de barouk. Le soupir de la chamelle serait un puissant remède contre les maladies des voies respiratoires. Selon le moqadem de Moulay Brahim, c’est parce qu’on avait étouffé la tête de la chamelle dans un sac de jute l’année dernière que, deux jours après le moussem, l’oued a tout emporté. Je quitte les lieux en direction de Tamesloht, alors que sur les aires à battre les paysans procèdent déjà à la séparation du grain d’avec la paille.

Tamesloht, septième jour du Mouloud. À mon arrivée à Tamesloht, ce matin, je rencontre un Gnaoui qui joue du guembri. Je lui demande aussitôt si je peux trouver ici une talaâ. Celle qui fait « monter les mlouk ». Il me désigne ses doigts qui pincent les cordes pour me signifier que c’est sur sa sollicitation que les mlouk « montent » (tlaâ). Je rencontre celui qui l’a initié, maître Razouq de Safi, que je connais depuis déjà longtemps. Il me dit qu’il est venu ici en « touriste » bien qu’il soit là avec sa troupe et tous les instruments. En effet, aucune voyante n’a loué ses services. À Moulay Brahim, comme à Tamesloht, ce sont les prêtresses qui conduisent les rituels et les pèlerinages ; les musiciens gnaoua comme les griots d’Afrique sont leurs assistants.
Puis je me rends à la maison des hôtes des Chérifs descendants de Moulay Abdellah Ben Hsein, il y a là un aveugle assis sur une natte. Il m’accueille chaleureusement, comme s’il me connaissait depuis toujours :
- Mets-toi à l’aise, me dit-il, voici du thé, des galettes d’orge et de l’huile d’olive.
Pour l’aveugle l’important en ce jour du Mouloud, c’est le moussem des chérifs descendants de Moulay Abdellah Ben Hsein. Il me dit à ce propos :
- La pratique des Gnaoua qui sont ici relève du sacré impur, alors que la nôtre, à nous les chorfa, est d’essence prophétique.
Il me décrit la chaîne mystique de ce soufisme de Tamesloht en remontant à Chadili, via Moul Laqsour le sixième saint de Marrakech jusqu’à Jounaïd, le grand mystique de Baghdad. Et comme j’écoute ses discours, je ne peux plus traîner dans les ruelles de Tamesloht à la recherche des voyantes comme j’en avais l’intention. Je parvins finalement à lui fausser compagnie. Je pars à la recherche de la talaâ de Bruxelles. Mais je ne la trouve pas. D’ailleurs, toutes les talaât présentes restent enfermées dans les maisons louées aux habitants de Tamesloht, où elles organisent leur cérémonie nocturne. Je rejoins le Gnaoui de Marrakech. Il est maintenant 16 heures et le gnaoui se repose au voisinage d’un bélier et de deux jeunes boucs. Il me dit que je dois patienter jusqu’à demain si je veux vraiment assister au pèlerinage des talaât dans les sanctuaires et refuse de me présenter sa femme, elle aussi talaâ, qu’il accompagne ici.
Quand tombe la nuit, je finis par retrouver la talaâ de Bruxelles. Sa cérémonie nocturne vient de commencer. Les musiciens de l’orchestre dansent au rythme des Oulad Bambara. L’un d’eux figure l’ancêtre esclave, dont les pieds sont entravés, et saute dans un effort pour se libérer. Puis on brûle le bejoin pour sacraliser l’espace où vont se tenir les danses de possession. Et voici, Bouderbala, le mendiant céleste avec sa tunique rapiécée, sa canne et sa besace. Puis on évoque Sidi Mimoun le potier, et le défilé de sa cohorte donne lieu à la danse des bougies qu’exécute une vieille femme noire. Pour évoquer et représenter Baba Moussa le marin, un Gnaoui danse avec un bol d’eau sur la tête. Il est suivi du possédé de Pacha Hammou, qui danse avec des poignards. Après une pause, on célèbre les saints chorfa, en particulier Moulay Brahim et Moulay Abdellah Ben Hsein. C’est la revanche des Gnaoua : ils ont fait entrer dans leur système de la possession les saints d’ici, dont les descendants les tiennent un peu en marge.
Puis les Gnaoua fidèles à leur propre passé africain, invoquent « les gens de la forêt sauvage », dont on dit que seuls les jeddaba aguerris sont capables de les incarner. Et l’on finit à l’aube par les esprits féminins aux couleurs bariolées. La dernière invoquée, c’est Aïcha Qandicha. La voyante de Bruxelles, qui a organisé cette soirée, l’incarne et prophétise en état de transe. La cérémonie prend fin avec cette invocation d’Aïcha. Je l’avais laissé à Zerhoun et Moulay- Brahim, je la retrouve ici parce qu’elle est présente partout au Maroc et même au-delà de nos frontières.
Huitième et dernier jour des célébrations du Mouloud. Il fait très chaud et les voyantes, épuisées par la nuit cérémonielle, dorment dans leurs maisons. Elles en sortent vers seize heures. Chaque voyante apporte son bouc pour Sidi El Hâjj Bou Brahim et son bélier pour Moulay Abdellah Ben Hsein. Certaines d’entre elles vont même jusqu’à un veau ou une vachette. L’importance des offrandes exhibées témoigne de leur prospérité, de leur réussite, et rehausse leur prestige. Hier, elles ont déposé au sanctuaire leurs étendards et leurs autels. Sans ce dépôt d’une nuit, le voyage serait inutile. Il faut que ce qui fonde la pratique de ces talaât vienne ici se recharger de la baraka du saint. Les « filles des Gnaoua » accompagnent, pieds nus, leur talaât, entièrement voilée – comme si elle se dirigeait vers une soirée de noce, en tant que « fiancée » du maître des esprits. Elles sont leurs auxiliaires et constituent autour de chacune une sorte de petite confrérie féminine.
Le monde des Gnaoua avec leur rite de possession et leur initiation adorciste est avant tout une religion de femmes dont Aïcha est la figure centrale. Une sorte de religion alternative dans une société où seuls les hommes ont vraiment accès aux lieux consacrés de la religion établie. Le moussem de Tamesloht donne à voir cette dualité, avec d’un côté les chérifs célébrant au grand jour leur religion d’hommes, et d’un autre les rites nocturnes et privés animés par les prêtresses d’Aïcha.
Abdelkader MANA
12:54 Écrit par elhajthami dans Psychothérapie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : psychothérapie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Soirée de Samaâ
Musique et extase

Reportage photographique d'Abdelkader Mana
Hier soir, le vendredi 12 mars 2010, Essaouira a connu une mémorable soirée de musique et d'extase (pour parodier un célèbre ouvrage de Jhon During), à Dar Souiri, aniumée par les Haddarates d'Essaouira, et les chanteurs du Samaâ de la zaouia des Darkaoua. Le public était composé essentiellement de femmes, qui ne sratent pas l'occasion d'assister aux soirées musicales organisées ces derniers temps par Latifa Boumazzourh(présidente des Haddarates d'Essaouira, un groupe qui monte au niveau local et qui se fait déjà connaître au niveau international, en France et bientôt en Italie) et Monsieur Marina un grand connaisseur du samaâ (oratorio) qui a déjà fait ces preuves dans ce domaine au niveau national. Nous avons assisté à la soirée d'hier et profiter de l'occasion pour prendre quelques images pour marquer cet évènement.






















12:52 Écrit par elhajthami dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, photographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook





