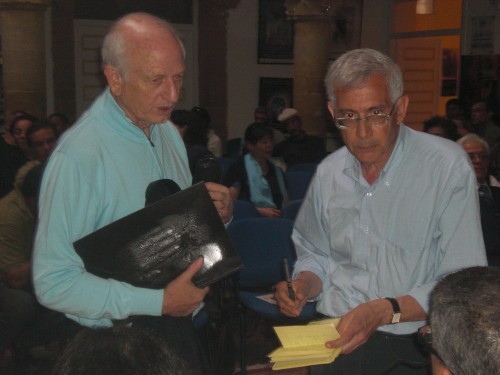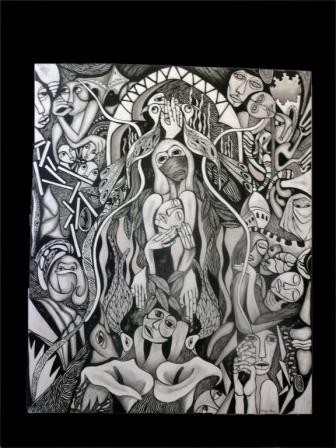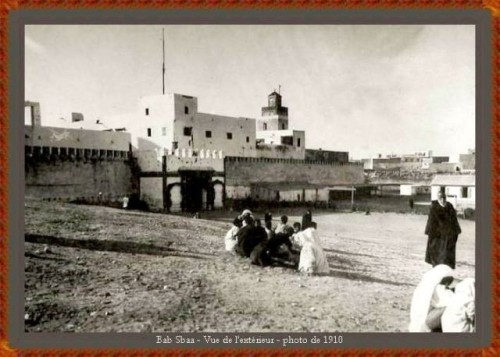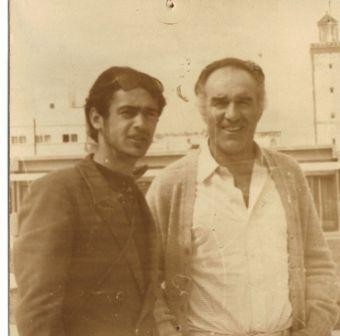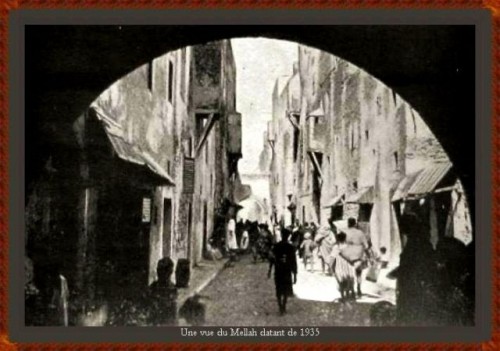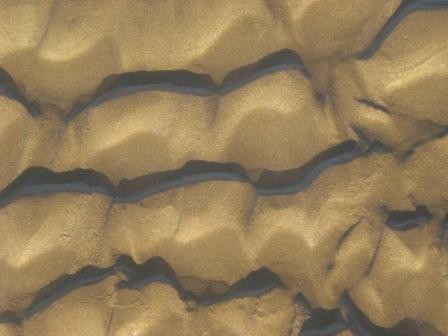18/07/2013
L’aurore me fait signe
Essaouira,son histoire et sa culture

Abdelkader Mana
Remerciements
A mon frère Abdelmajid Mana pour ses reportages photographiques. A David Bouhaddana et Jean François Clément.pour m'avoir permi d'utiliser leurs collections de photos anciennes. Au artistes peintres Hucein Miloudi, Hamza Fakir et Roman Lazarev . Mes vifs remerciements vont également à JP Peroncel - Hugoz, qui a relu ce tapuscrit et m'a donné divers conseils utiles.
PRELUDE

La ville frémit comme un être vivant sous les fracas des houles. La prière des minarets se répand dans la lumière froide du crépuscule, en échos à la prière cosmique du firmament. Le chien noir qui aboit en bas de la citadelle, effraie les oiseaux de nuit et les fenêtres closes. Une étoile polaire scintille au dessus du rayon vert. Des ombres, tous les soirs, viennent sur les remparts contempler les îles. Frêle humanité qui semble surgir des temps antiques, accentuant l’aspect fontomatique de la ville.
Avec le jour qui point, les gnaoua disent pour annoncer la fin de leur rituel nocturne de la lila : « Ban Dou » (la lumière est apparue).Et au moment de terminer ce livre,je me suis souvenu de cette nuit où une chikhate chantait :
Ton œil, mon œil
Enlace-la pour qu’elle t’enlace
L’aurore me fait signe
Le bien-aimé craint la séparation.
J’ai eu alors,le déclic de changer le titre initial de « Sociétés sans horloge », qui me semblait trop ethnologique, inutilement académique et quelque peu ambiguë, en choisissant finalement l’aurore me fait signe, qui correspond mieux à ma démarche ethno-poétique, qui s’apparente davantage à une « quête » qu’à une enquête. J’écrivais ainsi dans mon journal de route, du vendredi 22 mars 1984 : Il fait encore sombre. Les baluchons et les peaux brûlées trahissent l’origine paysanne des voyageurs : « Vas-y pour changer d’air ; la forêt est le poumon de la ville ; elle réactivera en toi la joie de vivre et d’écrire ». Me dit mon père.La route file droit devant nous ; vers l’Afrique ancienne, vers le Maroc de l’aube. Je cherche des idées neuves qui surgissent de ma pensée comme l’herbe fraîche au milieu de la rosée. Je me surprends à la recherche d’une langue inexistante pour échapper au « français ».
Vois le ciel au-dessus de la terre, source de lumière
Les habitants de la terre ne peuvent l’atteindre
Guerre des hommes, ô toi qui dort,
Vois le mouvement des astres
Ils ont éclairé de leur lumière éclatante, les ignorants.
Dérive enfin, vers ces couleurs que prend l’âme, à l’approche des énergies telluriques de la montagne, vers cette galaxie, où chaque peintre est un univers... Il est pourtant loin le temps où les femmes venaient se débarrasser du mauvais sort, recueillir au nouvel an, les sept vagues de l’aube.... Peut-être, en effectuant moi-même « le pèlerinage du pauvre » chez les Regraga, je ne faisais qu’emprunter la voie de mes propres ancêtres ?

Je signais à Casablanca cet avant propos en le datant de la nuit du destin 27 Ramadan 1429 correspondant au dimanche 28 septembre 2008, jusqu’à ce dimnche veille du 1erRamadan 1432 correspondant au lundi 1eraoût 2011 où m’a fille Sarah me posa cette question :
- Comment tu appelle ton livre papa ?
J’ai répondu :
- " Rivages de pourpre » avant de me rétracter : non plutôt « Nostalgie de Mogador "(une manière d'évoquer "la nostalgie des origines")…
- Ce n’est pas ainsi que tu l’avais appelé initialement : rappelles-toi, c’était plus jolis,avant ?
- Ah, oui, ça me revient : « l’aurore me fait signe ».Tu trouve que c’est plus beau ?
- Oui, c’est plus poétique en tous les cas…
- Alors désormais ça sera « l’aurore me fait signe »…
Quand souffle le vent du nord, il faut pêcher sur l’îlot de « firaoune », mais quand souffle le vent du Sud, il faut aller jusqu’à la grande île. Les goélands y forment une véritable voie lactée aux milliers d’ailes qui vibrent avec douceur, comme des prières bercées par les vagues.
Maintenant à Casablanca, nous avons déménagé, moi, ma sœur et ma fille, dans un nouvel appartement, et j’ai dû me rendre tout à l’heure dans l’ancien pour récupérer tous mes documents : une fois dedans, je n’ai pu m’empêcher de sangloter comme un enfant : mon père et ma mère que je n’ose visiter au cimetière de Casablanca parce que j’aurai aimé qu’ils soient enterrés sous l’olivier sauvage de Lalla Toufella Hsein, la sainte de la vallée heureuse de Tlit au pays hahî, entre le mont Amsiten et le mont Tama, où j’ai passé toutes les vacances de mon enfance et mon adolescence, au hameau de Tassila, aujourd’hui tombé en ruine et où ma grand-mère maternelle nous offrait le Balghou , à base de blé tendre, d’huile d’argan et de lait de chèvre… semblent toujours présents dans ce lieu. Le musulman, me dit-on, ne choisit pas sa terre d’élection : il doit être enterré là où la mort l’a surpris. Car la terre entière est temple de Dieu. C’est dans ce vieil appartement de type colonial, qu’on vient d’évacuer comme tous les autres locataires de l’immeuble lequel sera bientôt rasé, pour faire place à un édifice flambant neuf, répondant mieux à la fièvre immobilière qui s’est emparée de Casablanca , qu’au cours du Ramadan 1986, je me suis rendu compte de la vacuité de mes reportages à Maroc-Soir (où l’on passait du coq-à-l’âne du jour au lendemain), et du même coup de la valeur de mes notes sur le daour des Regraga de 1984-1985 : j’ai alors retiré d’un couffin, que j’avais acheté en pays chiadmî, la dizaine de calepins écrits en français mais aussi en aroubi – le dialecte du pays chiadmî – et je me suis mis à écrire avec frénésie dans une espèce d’extase mystique, d’une manière continue avec seulement quatre heures de sommeil : si bien qu’à la fin du Ramadan, le livre était pratiquement écrit… La journée est également bouleversante par les messages de solidarité et de soutien de mes amis Manoël Pénicaud et Falk van Gaver, qui m’encouragent à écrire ce livre, sans lequel je m’enfoncerais à jamais dans le silence et l’anonymat. Et je me dis en cette journée bouleversante, que les valeurs humaines que j’ai perdues avec la mort de mes parents, je peux les retrouver lorsque le destin vous amène à rencontrer l’amitié et la fraternité humaines. Sans quoi, je le répète, à quoi bon écrire dans un pays qui accorde un sort si peu enviable aux choses de l’esprit…« Le journal de route » que j’ai écrit sur les Regraga, est non seulement un « style », mais un héritage : Chez nous les Arabo-Berbères, et en particulier les Marocains, on excellait uniquement dans la littérature de voyage – le fameux adab Rihla lié au pèlerinage à La Mecque et dont le prototype était celui d’Ibn Battouta, qui décrit son voyage de Tanger à la Chine.
La société marocaine reste une société de tradition orale : il n’y a pas de reconstruction du réel par le récit. Le vécu ne laisse pas de trace. Or sans traces écrites, selon la conception occidentale, il n’y a ni mémoire ni progrès au niveau de la pensée. L’un des enseignements fondamentaux que j’ai reçu de Georges Lapassade, en menant ensemble, une vaste enquête sur « la parole d’Essaouira » au début des années quatre-vingts, c’est non seulement l’obligation de tenir une sorte de compte – rendu sur les apprentissages de chaque jour, mais surtout la vertu pédagogique du « compte-rendu » : au retour de mon pèlerinage chez les Regraga, il venait chaque soir m’écouter : en lui racontant ce qui s’est passé, je me rendais compte que mon subconscient avait enregistré des faits pertinents à mon insu. Mais sans son écoute attentive, je n’aurais certainement pas produit telle ou telle idée intéressante, comme faire le lien avec « l’essai sur le don » de Mauss, « l’éternel retour » de Nietzsche, ou « l’observation participante » de Malinowski : on produit autant par soi-même que par l’écoute amicale de l’autre. Comme me le disait si bien mon ami Georges Lapassade : dans ton cerveau et dans le mien, il n’y a que de l’eau ; la véritable étincelle jaillit dans l’interaction entre les deux. C’est du dialogue que naît la lumière…
D’ailleurs, ce n’est pas un hasard que la philosophie naisse du compte rendu que faisait Platon, des dialogues qu’entretenait Socrate avec ses disciples. C’est ce qu’a toujours voulu dire mon père qui me répétait inlassablement que la vérité jaillit comme une lumière des échanges qu’entretiennent les esprits. Ce livre est né de l’échange épistolaire avec mon ami le poète Falk Van Gaver : Il faut, lui écrivais-je, que nous continuons cet échange, jusqu’au jour où en jaillira peut-être de la lumière, en tout cas une voie à suivre, une voix à écouter, un livre à construire. En espérant un jour rencontrer ce « duende » dont parlait si bien Garcia Lorca… « Suivons la lumière », me répondit-t-il.
Une quête spirituelle donc comme c'est souvent le cas chez les poètes marocains.Ainsi de Sidi Kaddour El Alami : il était un maître, et les connaisseurs du melhûn sont ses « adeptes », dans le sens où ils n’ont pas un simple rapport esthétique avec cette poésie, mais un rapport mystique proche de la possession rituelle. Et le producteur de melhûnqu’on appelle Sejaï n’était pas non plus un simple poète, mais un mejdoub, une sorte de fou de Dieu, auquel on élève parfois un mausolée après sa mort. Les initiés – ces priseurs de tabatières, ces joueurs de ronda qui semblent « tuer le temps », sont en fait en quête permanente de la sjia, cette sorte d’extase, cette voie mystique que la poésie et le chant rendent possible. En ce sens, le melhûn devient un besoin fondamental pour l’équilibre spirituel et psychique de l’individu. Une sorte de « drogue poétique » à laquelle on s’accoutume autant qu’au tabac à priser. C’est en cela que cette poésie diffère fondamentalement de ce qu’on entend généralement par « poésie » dans notre monde moderne : son but n’est pas esthétique, mais spirituel. Une quête du "hal"en somme. Etat de celui qui est possédé par la transe. La confrérie des Ghazaoua chante le hal en ces termes :
Le hal, le hal, Ô ceux qui connaissent le hal !
Le hal qui me fait trembler !
Celui que le hal ne fait pas trembler, je vous annonce ;
Ô homme ! Que sa tête est encore vide
Ses ailes n’ont pas de plumes
Et sa maison n’a pas d’enceinte
Son jardin n’a pas de palmier
Celui qui est parfait, la calomnie ne l’effleure pas
Sidi Ahmed Ben Ali le wali
Prends-nous en charge, Ô notre cheikh !
Sidi Ahmed et Sidi Mohamed
Ayez pitié de nous. »
Selon Sidi Abderrahman el-Majdoub, le meilleur poète Marocain jusqu’à maintenant qui produisait sa poésie sous l'emprise du "hal" :
« Essaouira périra par le déluge
Un vendredi ou un jour de fête,
Marrakech est un tagine brûlant,
Fès, une coupe transparente.... »
En guise de commentaire à ce quatrain un pèlerin me disait au printemps des Regraga : « On raconte que le Mejdoub était fou. Mais tout ce qu’il disait arrivait. L’œil verra ce que l’oreille entend. On raconte qu’il était fou, mais il voyait avec « l’œil du cœur ». l’œil – la vision du Majdoub – n’est pas simple regard ; il est « l’œil du monde », comme disait Schopenhauer : « le pur connaître »...
Abdelkader Mana
PREMIERE PARTIE
LES SAISONS PRINTANIERES
Les sept vagues de l’aube
Essaouira, le 9 août 2003
J’ai marché, marché à n’en pas finir, depuis la baie immense et lumineuse d’Essaouira, jusqu’au-delà du cap Sim, sans rencontrer âme qui vive, hormis quelques tourterelles perchés aux branchages squelettiques et desséchés des mimosas. Car les dunes de sable sont d’une brûlure insupportables. J’arrive enfin à la crique où finit le cap Sim et où commence la baie sauvage et préhistorique de Kawki. C’est à ce moment-là — après m’être baigné dans l’océan glacial d’un bleu turquoise – qu’au bruissement des vagues, et sous le soleil zénithal, j’ai enfin le déclic salvateur : je proposerai à la revue française Immédiatement un article sur la jeune poésie du zajaldans le Sud marocain. Le cap Sim et le Zajal. Béni soit le cap Sim pour m’avoir fait une telle offrande de poésie.
Je ne l’ai pas trouvée là où elle posait ses mains
Où est partie la mer ce matin ?
Était-ce un poète qui serait passé par là ?
La mouette
Il n’a pas trouvé sur quoi écrire son désarroi
Était-ce un poète qui serait passé par là ?
De deux coquillages,
Une pierre de sagesse me parvient
En se roulant vers moi
Était-ce un poète qui serait passé par là ?
Il se demandait le long du fleuve :
Était-ce
Un poète
Qui serait
Passé
Par
Là
?
Je me suis rendu au cap Sim, puis à Kawki. Cela fait un trajet de vingt-cinq kilomètres à pied par une côte sauvage et magnifique. Bien entendu, je pense très fort à mon père décédé le 14 décembre 2002, qui est à l’origine de mon projet d’écriture : sauver de la ruine, les fragiles empreintes de ceux que nous aimons, c’est ne pas les perdre totalement. Et voilà, qu’à mi-parcours, je tombe sur un coquillage rare dans les parages, et pas n’importe lequel : une nacre . C’est le type même de ces coquillages avec lesquels mon père décorait les tables d’arar (thuya) durant toute sa vie de labeurs, de sueurs et de prières. Chez les Argonautes du Pacifique occidental aussi, la circulation des coquillages souleva (blanc) et mwali (rouge) signifie, d’une certaine manière, le retour de la mémoire des morts. Pour quiconque, une telle rencontre nacrée est simple coïncidence, pour moi, c’est l’esprit toujours vivant de mon père, qui m’envoie ainsi ce message cosmique pour apaiser ma désolation et ma solitude.
OUI, « l’instant est une coquille de nacre close ; quand les vagues l’auront jeté sur la grève de l’éternité, ses valves s’ouvriront. » Shoshtari
Un peu plus loin, au milieu du cap Sim, je découvre une plante médicinale du nom vernaculaired’ajebbardou, que deux jours auparavant, ma mère m’avait
réclamée : on malaxe cette plante charnue avec de l’huile d’olive et l’on s’en enduit le corps pour se débarrasser des mauvais esprits — les esprits du vent qu’on nomme ariah — ou on la met sous l’oreiller d’enfants souffrant de cauchemars. Ma mère souffrait d’hallucinations dues à une tumeur au cerveau et elle en a besoin pour cette raison.
Les deux messages cosmiques signifient aussi que mes racines profondes se trouvent dans ces lumineux rivages et que, partout ailleurs, je pourrais peut-être gagner plus d’argent mais serais toujours comme une nacre hors de l’eau, une plante hors de sa terre nourricière.
Essaouira, le 10 août 2003
Face au crépuscule et au hadir (grondement de mer) mon ami Raji me fait de vive voix le récit de ses poèmes dont celui dédié à ces marins que les femmes attendent au rivage et qui ne reviennent jamais :
Chaque vague est un ancien pêcheur
Mort de noyade
La vague peut-elle se noyer en elle-même ?
La mer est plus longue qu’une canne de pêcheur
Ce n’est pas moi qui le dis
Ce sont les fuites d’eau au travers des mailles du filet.
Métaphore des espèces en voie de disparition en ces parages — algues, poissons, arbres, hommes, culture — la grande coupe de forêt à laquelle procèdent des bûcherons aux environs du cap Sim : des mimosas et des eucalyptus qui ne fleuriront plus cette année. Les bûcherons brûlent tout, sauf ce genre de thuya, qui pousse aux abords de l’océan, parce que contrairement au thuya de l’Atlas, dont se servait mon père en tant que marqueteur, il ne repousse jamais après la coupe.

Entre les racines du cœur et l’esprit de la terre
L’arbre déteste la hache
Et le visage du bûcher
Il préfère le serpent multicolore
Qui glisse comme le désir sur sa peau
Brûlure du midi au cap Sim, fraîcheur des algues à la lisière des eaux douces et des eaux salées, envol d’oiseaux de mer au gré des alizés esprit de la terre qui nous rattache aux morts, à nos morts ; brûlure des interrogations, déracinement des hommes.
Lundi 18 août 2003
Journée lumineuse. Abondants arrivages au port. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Essaouira est port méditerranéen sur l’Atlantique. Non seulement en raison de son histoire ancienne de port-relais entre les caravanes de Tombouctou et les caravelles de la lointaine Europe, mais aussi en raison des mutations en cours : tout ce que compte la médina de beaux riads est désormais entre les mains de résidents venus de l’autre rive et de l’autre vent. Le pouvoir brutal et imperceptible de l’argent.
Un sentiment de dépossession semble s’être emparé des natifs de la ville vendue au plus offrant. Ils se sentent marginalisés, expulsés de leur propre ville. Hors jeux. Même la culture — ou plutôt ce qui en tient lieu, en termes de communication version marketing y est désormais animée d’une manière extravertie. Le fait d’être un Ould Blad (enfant du pays), ne vous donne aucune légitimité pour bénéficier des substantielles prébendes du sponsorat que génèrent des festivals forcément internationaux. Au contraire. Tout ce qui dans le local ne peut pas rimer avec le global est exclu. Ainsi les Gnaoua riment avec les musiques du monde, par rapport à ces gens de l’ombre que sont devenus les Hamadcha, les Aïssaoua et autres musiques de l’extase. La reconnaissance de la culture locale est désormais tributaire de la mode et de l’esthétique dominante au niveau mondial. Tout ce qui n’est pas moderne dans le local est destiné au Musée de l’ethnographie, lui-même relégué aux oubliettes de l’histoire depuis 1989. Développement local sans la participation des locaux. C’est cela aussi, la mondialisation.
« On a vendu les clés de la ville », disait mon père.
On a vendu la ville tout court et ô suprême dérision, au nom de la sauvegarde même de la ville ! Le tiers des maisons de la médina est désormais aux mains d’Allemands, de Bretons, d’Italiens, de Danois, d’Anglais, d’Américains. Il y a même une Zimbabwéenne blanche, toujours élégante, par-delà les âges.
Et la vente aux enchères continue ! Ici, les gens sont pauvres, m’explique un courtier de la ville, lorsqu’ils entendent cent millions de centimes, ils cèdent immédiatement leur maison. Des quartiers entiers sont maintenant occupés majoritairement par des Européens. Bientôt, il va falloir un visa aux Marocains pour accéder à la médina…
Pour le moment notre vieille maison n’est pas à vendre. Par le passé, elle appartenait au négociantTouf El Âzz, l’un des actionnaires du bateau à voile Le Prophète qui reliait Essaouira à Marseille.
Avec la bataille dite d’Isly, qui préfigurait au Maroc la pénétration capitaliste et coloniale, les habitants ont pu retrouver après l’accalmie leurs maisons et leur culture. Avec la mondialisation, les nouvelles règles du jeu édictées par l’OMC et l’argent - roi – tout est à vendre l’ethnopeinture des artistes « singuliers » comme les plus belles filles de la ville, les habitants risquent de ne plus retrouver ni leurs maisons, ni leur culture. Quand les écarts de niveau de vie confinent à la provocation, comment les échanges « psychologiques » peuvent-ils être équilibrés entre l’autochtone et l’allogène ? Des Souiris de souche disent qu’ils sont reçus avec moins d’égards que les résidents européens par les autorités de tutelle. Vraie ou fausse, une telle perception est la traduction d’un climat qui rappelle une urbanité de type colonial.
Morts sont les gens du Rzoun, cette compétition chantée, ce charivari carnavalesque, qui opposait jadis, à chaque nouvel an, les deux clans de la ville : les Béni Antar, ces gens de la mer et de l’Ouest, aux Chebanates, ces nomades du désert, du feu et de la terre. Avec la disparition duRzoun, c’est un peu des repères de la ville qui se perdent :
Permettez-moi donc d’avouer
Les soucis qui m’oppressent
Et si je meurs, que personne ne me pleure
Mais quel est votre chef ô Chebanate ?
Osman à la tête bossue
Et à la bedaine serrée d’une cordelette ?
Et qui est votre chef Ô Béni Antar ?
Ali Warsas traînant au port son chien
Éternellement sur son âne ?
Le modèle culturel urbain est menacé de disparition, en tant que corporation d’artisans, en tant que confréries religieuses, en tant que communautés de voisinage et de sentiments.
Devant le chalet de la plage, une sculpture de Miloudi à la signification sans équivoque : « Main basse sur la ville ». Le patron du chalet de la plage n’en revient pas des spéculations en cours :
- Les Européens arrivent ici avec un petit capital, achètent une maison, la transforment en restaurant, et la revendent quelques années plus tard à dix fois son prix. Et dire qu’ils sont venus « investir » !.

Le Mardi 19 août 2003
Ni ciel, ni mer, un seul bleu éclat de lumière. Au fond de la baie, un pêcheur retire son filet vide de l’océan et de l’azur. De mon oncle paternel – Da Omar le coléreux poissonnier adepte de la confrérie disparue des Aïssaoua, mort une aube des années soixante-dix, il se souvient encore. Cela me rassure, que notre nom ne soit pas totalement éteint, puisque la baie s’en souvient toujours. Le vieux pêcheur fournissait mon oncle en captures d’une baie jadis poissonneuse :
- Au lieu-dit « Ma Lahlou » (eau douce, là où une source jaillit à la lisière des vagues, où se désaltèrent les récolteurs d’algues), je pouvais prendre dans mes filets, jusqu’à soixante-dix kilos d’ombrines et de loups. L’ombrine ne coûtait qu’un demi -dirham le kilo, et guère plus de trois pour le loup. La sargala (la bonite) qui a disparu des parages, on la jetait aux chats.
Sous la roue de sa bicyclette jetée à même le sable, gît l’unique capture du jour : une pauvre serelle. Où sont passés les poissons ?
- En vingt-quatre heures, je n’ai rien pêché. Mais celui qui a trouvé sa gana – terme utilisé par les artisans locaux dans le sens de « disposition d’esprit propice à la création » - en travaillant avec la mer, ne peut plus travailler avec les hommes.
Au moment de nous quitter, il m’offrit la serelle :
- Tu trouveras plus loin de quoi la griller.
Je lui offre pour ma part une grappe de raisin. Cette année, les raisins sont certes aussi sucrés et charnus que d’habitude, mais leur taille est anormalement petite. La sécheresse en est la cause, mais aussi les rejets chimiques du complexe phosphatier de Safi, qui auraient affecté les oliveraies de la plaine atlantique et les fonds marins. Un ânier nous offre le feu :
- Ne me remerciez pas, ne sommes-nous pas enfants de la même ville ?
- Nous sommes la ville elle-même, lui rétorque Raji. Nous sommes son sourire amer quand elle se dénude face au miroir. La ville, c’est du ciment mêlé au secret.
- Quel secret ?
- La peur du silence au fond de la nuit. Mon ombre et ton ombre effacées.
La mer gronde sous le vent et déjà l’homme à l’âne n’est plus que mirage au fil des dunes.
« Le monde est tout ce qui arrive », disait Watsenstein.
Et ce qui nous arrive en ce moment est d’être là, face à nous-même et à ce fantomatique cormoran étalant ses ailes noires sur les rochers à la lisière des vagues :
- L’ombre s’efface, constate Raji. Mon ombre et ton ombre effacées. Nous ne sommes que des fantômes invisibles.
Lieu de communication et d’écriture, karkora, le tas de pierres sacrées que la mer couvre et recouvre au gré des marais et des saisons. Parole de récolteur d’algues :
- Il faut récolter une grosse quantité d’algues, pour avoir une galette d’orge.
Et pour retrouver la paix de l’âme, le violon bleu cherchera en vain la femme, pour jouer sur sa poitrine la musique des flux et des reflux des nouvelles lunes… Une musique douloureuse, sur la trace de ceux que nous avons aimés et que nous n’avons jamais retrouvés. La mer et l’amour ont l’amer en partage, m’écrit Falk. Et c’est le légendaire aède berbère qui le dit :
De tous ceux qui sont passés
Hélas, tu te souviens,
Tu connaîtras que la vie n’est rien qu’un chemin…
Au port, le patron du restaurant Coquillages un ami d’enfance me promet une sortie en mer, avec un sardinier ou un chalutier, le vendredi ou le samedi prochain. Un Raïs rifain me recommande vivement le chalutier Azzam II (quelque chose comme « le deuxième souffle »), d’une part, parce qu’il parcourt plus de milles qu’un sardinier, et d’autre part, parce qu’on y mène une véritable vie sociale à bord. Une ultime raison me décide : le chalutier lève les amarres à l’aube.
Le vendredi 22 août 2003
Aux affaires maritimes, on ne voit pas d’inconvénient à ce que je sorte en mer avec le navire de mon choix, à condition qu’on m’enrôle sur la liste d’un équipage…
- Quatre heures du matin largua d’ici éclate de rire Abahhû croisé à la porte de la marine, qu’on encensait jadis pour apaiser les esprits de la mer. Ce nom d'abahhû signifie "gland" en berbère.Dans le subconscient maghrébin, la mer est toujours synonyme de mort.
- C’est quoi « largua » ?
- Larguer les amarres en espagnol.
- Te souviens-tu de sargala ?
- Nous l’appelions « poisson juif », parce qu’il était très apprécié au repas du shabbat. Les Français l’appellent « bonite », je crois.
- Ça fait des lustres que ce sargala a disparu ?
- On le retrouve plus qu’aux rivages du Sahara, du côté de la Mauritanie. Une espèce en voie de disparition au même titre que d’autres poissons migrateurs.
Raji s’enthousiasme pour mes projets d’écriture en haute mer :
Le poisson ne se lave pas le visage le matin,
La mer est son visage lavé.
Depuis ce blanc sel, depuis ce bleu éternel…
Avant que les portes de la ville ne se ferment le soir, une femme grimpait au sommet du vieux figuier pour scruter à l’horizon l’improbable retour du bien aimé, mort de noyade. En vain, elle adressait ses folles suppliques à la nuit et à la mer :
La mer est le marin lui-même
Toi, la veuve, ton mari n’est point mort
Il est redevenu vagues
Car, terrien, il ne l’était que par erreur
L’âme de la lune attire la mer vers les vagues
Ton mari n’est pas mort
Il est revenu au bleu originel des vagues
Il est revenu au blanc-sel originel
À l’infini itinéraire des éternités
Ô veuve, ton mari n’est pas mort !
Terrien, il l’était par erreur
Seule la mer est à même de rectifier
Les généalogies et les origines
Pourquoi grimpes-tu donc au vieux figuier ?
Qu’il soit à Bab Marrakech ou à la porte de la marine ?
Les racines de cet arbre vont te murmurer ses nouvelles
Tel le vieux voyant de la ville
Qu’est moi-même avant de naître
L’arbre est le mirage de l’âme secrète
De la mer dans un coquillage
Ce qui scintille au lointain horizon
N’est pas la chandelle qui illumine ce cap Sim
Mais l’âme éternelle du marin
Au plus profond des vagues…
La peur du grand large, chacun l’exorcise à sa manière, moi par l’écriture, mon frère Majid par l’achat d’une arganeraie, juste avant son départ pour la France. L’écriture et la terre, c’est pour partir sans jamais partir.
Le samedi 23 août 2003
1 h 30. J’ai peu dormi. Le jeune mousse m’avait demandé de me présenter au port à 2 heures du matin. C’est la première fois que j’accompagne un chalutier en haute mer. Et si je n’en revenais pas ? Ces derniers temps un paquebot aurait heurté au Sahara un chalutier : tous les marins sont portés disparus. Je pars avec de l’eau, des raisins et des figues. Il va falloir se couvrir, car froide est la haute mer. La ville dort encore. Elle est silencieuse. Mais une fois franchie la porte de la marine, énormes grondements de moteurs :
Le grondement des navires lointains
Nostalgie de qui à qui ?
La plupart des équipages quittent les cales où l’on s’endort, allument les lumières, s’activent sur les ponts, mettent simultanément les moteurs en marche. Le port s’endort. Le port se réveille. J’arrive à temps : le chalutier Azzam II où je suis enrôlé est toujours à quai. Le jeune mousse vient me souhaiter la bienvenue à bord.
- Tout l’équipage est au courant que je suis du voyage ?
- Bien sûr, on t’a enrôlé in extremis, alors que la Marine fermait déjà ses portes. Sans quoi vous seriez resté à quai…
On ne larguera les amarres qu’à l’approche de l’aube. On ira du côté de cap Sim, qu’on appelle aussi « trou espagnol », parce que les navires s’y mettent à l’abri des tempêtes. Si je retrouve ainsi le cap Sim, c’est signe que je suis en train de prendre le bon cap. En haut des mâts, j’entrevois le croissant de lune. Il fait sombre. De petites barques quittent le port. C’est pour la pêche à la langouste. Les mouettes survolent les bateaux en éternelles gardiennes du port. Et de Raji me survient ce poème :
À l’oiseau couleur d’âme
Des battements d’ailes
En guise d’à-Dieu.
On ira loin, plus loin que le cap Sim.
Légère brise, « cette chevelure du vent » qui scella mon amitié au jeune poète :
Pour apaiser ses gémissements
Elle peignait la chevelure du vent
Le coquelicot n’est que brise
Si son parfum n’était si fort
L’abeille amoureuse l’aurait dédaigné
Ô mon fils, lui a-t-elle dit
Quand on a annoncé au coquelicot
Qu’on doit lui couper la tête
Le coquelicot enlaça et embrassa son propre sang
Au coquelicot les rites funéraires furent des noces
Ô mon fils lui a-t-elle dit
La mer, sa magie et sa grâce
On a cru pouvoir l’enfermer dans un cercueil
Mais sa veine déborda d’une blessure salée
Et brisa le cercueil…
La mer, ne la fait pas monter par une canne
Ne la fait pas monter au bord d’un hameçon
Laisse la mer à la mer
Laisse la mer à sa guise
« Pour la pensée, les signes ont la même importance qu’eût pour la navigation, l’idée d’utiliser le vent afin d’aller contre le vent », écrivait le mathématicien autrichien Gottlob Frege. L’idée d’utiliser le signe pour aller contre l’amnésie et la mort. C’est en cette même heure sombre de la nuit, que mon père nous a quittés : il parvint dans un dernier souffle à prononcer le nom qu’il m’avait donné. Les prières augmentent les lumières des étoiles, et jettent un pont par-dessus la mort.
Quelle idée blessante fait tourner le sable ?
Les vides de son hémorragie
Sont cousus par la montée écumante du sel.
Quelle idée blessante fait tourner le sable ?
Ce qui te fait gronder ô mer
N’est pas la mer
Ce sont les blessures du martyr Hallaj
Quelle idée blessante fait tourner le sable ?
Mille et un clapotis de rames l’apaisent.

On s’active sur le pont. Hormis un marin autochtone Chiadma, tout l’équipage est d’origine rifaine. On prépare les filets, on actionne le treuil, on largue les amarres. Il est exactement 3h30, quandAzzam II s’engage dans la baie sombre. Derrière nous la ville dort encore. Mer calme tant que nous sommes dans la baie protégée de la houle par l’île au large. Mais une fois franchie cette barrière, vertige tant que durera le cap vers le sud. Au sombre firmament, le croissant de lune. L’équipage rejoint à nouveau la cale pour dormir. Le chalutier vogue par-dessus les grosses vagues, en draguant le filet à vive allure : racler les fonds marins de sorte qu’au passage les poissons se trouvent pris au piège.
Tel un cancre aveugle
Le marin libère la lune de ses filets
En point d’interrogation ( ?)
Maintenant la proue ne pense qu’à l’hameçon
La mer est un hameçon
Qui dort
Dans la tête
D’un homme bleu
Il lui arrive de pêcher, des poissons dont il ne connaît même pas le nom
La mer perdue,
La mer qui n’a laissé aucune trace,
Renaît en permanence sous forme de poèmes,
Qui lèvent leur chapeau à sa majestueuse étendu bleu…
Au levé du jour, bleu d’azur, bleu profond, une caravelle se pose sur le mât. Une lourde charge ralentit le dragage. Était-ce une grosse prise ? Une de ces baleines qui hantent les parages ? De soixante-seize brasses de profondeurs, on retira finalement une énorme météorite. Des poulpes, des crabes, des coquillages, des dorades et des sérails frétillants. Le Raïs décide de rentrer au port. Entrer en mer, c’est mourir. En sortir, c’est renaître. De quelle lumière est l’horizon ? La mer l’a surpris de nuit, par un coup de pinceau couleur d’azur.
Le soir de mon départ pour Casablanca, la campagne électorale bat son plein. Elle ne me concerne point. J’apprends le décès d’Abdelaziz, le dernier infirmier des Béni Antar. Il vivait reclus depuis longtemps. On l’a enterré presque incognito, alors qu’il y a quelques années toute la ville aurait suivi son cortège funèbre. Avec lui, c’est un peu d’Essaouira de notre enfance qui meurt. Et puis ce terrible Haïkou de mon ami Raji :
Dans les innombrables urnes
Un seul mort
Le pays
Cette terre où nous sommes nés, nous appartient-elle toujours ? Avant l’écriture et après l’écriture, le silence.
Cap Sim au loin...
Société sans horloge
« Je me suis dit : c’est le moment de l’écriture. J’ai pris en compte dans mes calculs les quatre éléments suivants : le feu et la terre, l’eau et l’âme, ainsi que les sept planètes et les vingt-huit manâzil. Je les ai divisés par les douze astres qui correspondent aux manâzil de bon augure. J’ai compté les sept jours de la semaine qui correspondent aux sept esprits nés de la lumière du trône céleste qui commande aux armées des jnûn !(djinns) »
Il s’agit d’une qasida-talisman d’un certain Haj Saddiq Souiri, ayant vécu à la fin du XIXèmesiècle, où l’amoureux use de magie pour contraindre les démons à lui ouvrir l’une des sept portes du château où se trouve sa bien - aimée. L’auteur cite dans cette qasida, du genre malhûn, tous les livres jaunes de la magie le Damiati, en particulier, les chiffres sept et soixante - six : les sept saints Regraga s’arrêtaient à une etape dite de « soixante six », juste avant d’escalader la montagne de fer. Les vingt-huit manâzil dont il s’agit dans cette qasida intitulée Jadwal (talisman), sont des mansions lunaires. Plus complètement les manâzil al-kamar, sont les mansions lunaires, ou stations de la lune. Elles constituent un système de 28 étoiles, astérisme ou d’endroits dans le ciel près duquel la lune se trouve dans chacune des 28 nuits de sa révolution mensuelle. Le système des mansions lunaires a été adopté par les berbères, à travers des canaux encore inconnus, puisque le mot manâzil figure déjà dans le Coran (X, 5, XXXVI,39) Voici l’identification astronomique de quelques mansions lunaires citées à travers les dictons du calendrier agricol :
- al-nateh, Arietis
- al-boulda, région vide d’étoiles.
- Saâd Dabeh, capricorni
- Saâd al-Boulaâ, Aquarii
- Saâd saoud, capricorni
- Saâd Lakhbia, aquarii.
- Batnou al-hout, andromedae...

Au Maroc, le calendrier agricol est fondé sur ces 28 mansions lunaires. Des calendriers de ce genre étaient déjà connus au moyen-âge. Ils proviennent de traditions astro-agricoles plus anciennes dont on trouve des parallèles chez Ptolémée et à Babylone.
Lors de mon séjour au Haut-Atlas, je me suis rendu compte, que je n’avais pas la même mesure du temps que mes interlocuteurs : ils raisonnaient en termes de calendrier julien, alors que je raisonnais comme tout citadin selon le calendrier grégorien. Il m’a fallu du temps pour me rendre compte, que lorsqu’ils disent par exemple que la saison des fêtes commence au Haut-Atlas le 1er août julien, il faut entendre le 13 août grégorien : il faut systématiquement ajouter 12 jours au Julien pour obtenir son correspondant grégorien. À chaque période de 12 jours correspond unemanzla,qui sont au nombre de vingt huit, au cours de l’année julienne.

Chaque manzla se caractérise par des particularités météorologiques qui ont un impact direct sur le faune, la flore et les activités agricoles. Le fellah dispose d’un répertoire de dictons pour fixer lesManâzil. Ainsi dit-il des trois Manâzil de nivôse et des deux Manâzil de pluviôse dont les frimas sont pénibles mais néanmoins nécessaires au renouveau de la vie :
- Manzla de la Boulda, le 21 décembre : « le froid de la boulda atteint le cœur ».
- Manzla de Saâd Dabeh, le 6 janvier : « Saâd Dabeh, ne laisse au chien aucune force pour aboyer, ni de chair à l’agneau pour être sacrifié, ni de sperme à l’esclavon pour forniquer ».
- Manzla de Saâd Boulaâ, le 17 janvier : « Saâd Boulaâ, envoie-le faire des courses ; il n’entendra pas ; donne-lui à manger, il ne se rassasiera pas ».
- Manzla de Saâd Saoud, le 30 janvier : « à Saâd Saoud, l’abeille gèle sur la branche et l’eau coule dans la moindre brindille ».
- Manzla de Saâd Lakhbia, le 13 février : « à Saâd Lakhbia, sortent les vipères et les faucons ».
Les manâzla, sont donc des étapes dans le temps comme le note Ibn Ârif :
« Les vertus qui s’avancent dans la voie mystique pour arriver à la connaissance parfaite, à la gnose qui couronne l’union divine, sont des manâzil (étapes) ».
L’année se répartit donc en manâzil, période d’une douzaine de jours, toutes portant un nom pittoresque, et dont la succession commande, encore de nos jours, l’agriculture traditionnelle. A ce propos, on lit dans le Qânûn d’al-Ioussi :
« Le printemps, parce qu’il est modéré, les forces ne s’y accroissent, pas plus que les nourritures ne peuvent faire de mal, car la saison les contraint. Pas d’inconvénien à s’y livrer à beaucoup d’exercice, à l’acte sexuel. On y pratiquera la saignée, un jour serein, tranquille, satisfait. On évitera tout souci ce jour-là, la contrariété, la peine, la pensée, l’étude des livres et l’acte sexuel. La veille, le jeûne et les fatigues diverses, on les reservera à la pleine journée, sans qu’il y ait faim ni réplétion... L’été, en raison de sa nature brûlante et sèche, on s’abstiendra de toute chaleur en fait d’aliments et de boissons. Ainsi l’on évitera le miel, l’ail, les oiseaux, les pigeons. On mangera du frais et de l’humide : viande de veau gras vinégrée ou à la courge. On mangera du concombre, de la pastèque. Alléger le vêture, réduire l’exercice et l’acte sexuel (qui joue un grand rôle, décidément, dans cette diététique), éviter la veuille, dormir davantage à la sieste... »
L’automne viendra puis l’hiver. Pour l’automne, il est fait allusion à un pain de ce dhurah qui se prononce en dialecte maghrébin drâ, à savoir le « sorgho », qui joue un cetain rôle dans l’alimentation des foules bédouines.
Les véritables spécialistes du calendrier dans la tribu sont les fquih. J’ai surpris l’un d’entre eux au milieu de planches coraniques en train d’écrire un jadwal (talisman) à l’encre couleur safran, pour une femme qui le lui avait commandé. En guise de calendrier julien, il me brandit un kunnach où je vois écrit au smakh, sept tétrades, mnémotechniques, dont chaque lettre correspond à uneManzla. C’est un véritable calendrier-talisman. Il me récite le même calendrier sous forme deqasidachantée : souci de mémorisation.
Le recours au secret vise à entretenir la profession d’astrologue. Ainsi, le fellah incapable de franchir « l’enclos du temps » qu’il fera et que recèlent les lettres et les chiffres magiques, va recourir au service de celui qui dévoile le secret des astres aussi bien pour l’avenir de ses vaches que pour le sien propre.Dans un manuscrit consacré au calendrier agricol, on peut lire entre autre, à propos du mois de janvier (Yennaïr) : « On fait en ce mois la prière du Dohr quand l’ombre du style atteint neuf pieds, et l’açr, quand elle atteint sept. »
Par pied il faut entendre la longueur moyenne d’un pied d’homme, et non le pied de 33 cm, autrefois en usage en France. Le mot pied traduit ici l’arabe qadam. Ceci nous montre à quel point dans les sociétés sans horloge, le temps était à la mesure de l’homme. Je me souviens d’un jour d’été où khali H’mad mon oncle maternel, en marge de l’aire à battre, nous démontrait l’heure qu’il est en mesurant sa propre ombre par le nombre de ses pieds mis bous à bout. On retrouve là le principe du cadran solaire, qui servait aussi à fixer les heures de prière, le seul moment de la vie sociale où la ponctualité est requise : partout ailleurs, on trouve mille et une excuses, pour battre en brèche la ponctualité. C’est en cela que la société marocaine demeure « une société sans horloge », c'est-à-dire sans ponctualité. Le fameux incha Allah ! Or la ponctualité, c’est la modernité. Ce dérèglement de l’horloge sociale, qu’on rencontre partout y compris dans les entreprises les plus modernes (de la télévision qui ne respecte pas le timing de diffusion à l’avion qui ne décolle pas à l’heure), on peut l’attribuer à cette ambivalence, cette ambiguïté, que mon ami J.P.Hugoz appelle « l’à peu-prêisme » des marocains .Bref, à l’intrusion de l’irrationnel y compris dans les institutions les plus modernes
.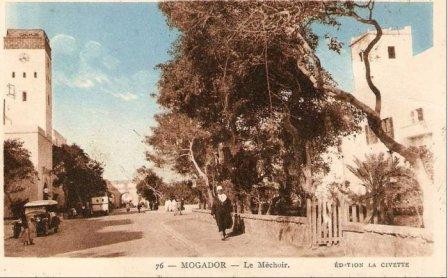
Nous sommes entrés de plein pied dans les temps moderne mais sans régler notre horloge saisonnière sur les fuseaux horaires de la modernité. « Ce décalage horaire » est cause d’immobilisme, de perte de temps et d’argent, comme on le constate d’une manière flagrante durant ce mois lunaire du ramadan 1429 (septembre 2008), où toutes les activités humaine sont au « ralenti », où toute les décisions sont en « instance » c'est-à-dire reportées sine die, et où tout semble suspendu à l’heure de la rupture du jeun, y compris le caractère lunatique des jeuneurs. Société déboussolée, où les repères de jadis ne fonctionnent plus et où les nouvelles règles du jeu ont du mal à se mettre en place. C’est ce dérèglement de l’horloge sociale et des institutions qu’évoque Fatima Mernissi lorsqu’elle parle de « la peur-modernité ». Or sans ponctualité point de modernité : pas de train à l’heure, pas de travail à la chaîne, pas d’exploits athlétiques, pas de capitalisme.Dans les sociétés paysannes, on n’avait pas besoin de l’horloge des villes parce qu’on n’était pas « pressé par le temps ». On ne produisait pas cette abstraction nommée « argent » mais les fruits de la terre-mère, au gré des saisons. Même l’argent est un « don » du ciel, une « offrande » Le temps, c'est-à-dire la vie, n’était pas nécessairement de l’argent, mais ce plaisir convivial que prenait mon père à faire sa sieste à l’ombre d’un olivier, pour régler son horloge biologique sur l’horloge cosmique.C’est ce temps pour soi que j’ai vécu moi-même au printemps de 1984, en suivant le daour (pèlerinage circulaire des Regraga) : « Dans mon ivresse, j’ai complétement perdu la notion du temps, ce qui compte ici c’est le mouvement du soleil et de la lune, c’est de savoir qu’on est dans la période des fèves et des petits pois, au seuil des moissons auxquelles succèdera la période des raisins et des figues. Le reste n’est que bavardage et vent inutile. »
Cette horloge végétale a été également signalée par Malinowski : Pour fixer un rendez-vous, le chef d’une île trobriandaise, offre un cocotier couvert de bourgeons avec ce message : « Lorsque ces feuilles se développeront, nous ferons un sagali (distribution) ».Ces cycles végétaux sont liés au retour régulier des planètes et des saisons. D’où cette conception circulaire du temps, revenant périodiquement à ses origines, fêté par des rites également périodiques et circulaires aussi bien chez les Regraga que chez les Trobriandai.
En cours de route une paysanne m’interpella un jour en ces termes :
- Revenez nous voir au temps des raisins et des figues !
Les fellahs ont donc une autre perception du temps qui n’est pas celle du calendrier grégorien ni de l’horloge des villes, mais celle du cycle lunaire subdivisé en manazil.
Les circumambulations des Regrga coïncident avec l’équinoxe du printemps. Le 21 mars, la « fiancée rituelle », dont l’ancêtre est Achemas (le soleil, cet arpenteur de l’espace qui concourt avec la pluie à la fécondation terrestre) se dirige vers la « clé du périple ». Sauf pour l’année bissextile où les jours néfastes d’Al hussoum coïncident avec l’équinoxe. On reporte alors le départ au jeudi suivant. Car c’est dans ces jours que les peuplades de Âd et de Thamoud ont été anéanties par un vent mugissant et impétueux : « Durant sept jours et huit nuits tu aurais vu ce peuple renversé par terre comme des troncs évidés de palmier » (Coran).
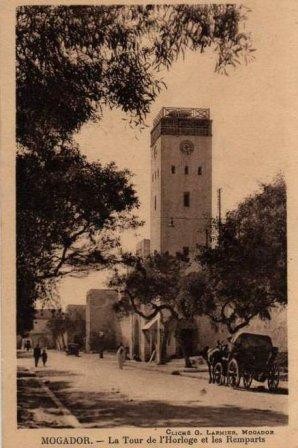 Les derniers jours de cette manzla de mauvais augure sont marqués par l’apparition des cigognes et des aigles. Les pluies qui tombent en ce moment sont déterminantes, pour la croissance des plantes. Le dicton dit : « Si la terre s’abreuve bien à Batnou al-hout (ventre du poisson) dis au Nateh (6 avril) de souffler le tocsin ou le clairon ».
Les derniers jours de cette manzla de mauvais augure sont marqués par l’apparition des cigognes et des aigles. Les pluies qui tombent en ce moment sont déterminantes, pour la croissance des plantes. Le dicton dit : « Si la terre s’abreuve bien à Batnou al-hout (ventre du poisson) dis au Nateh (6 avril) de souffler le tocsin ou le clairon ».
La fin du daour coïncide avec les bénéfiques pluies de Nisân. La période de Nisân s’étend du 27 avril au 3 mai de l’année julienne et le daour est clôturé le 28 avril. L’eau qui tombe à ce moment a des propriétés merveilleuses et guérit une foule de maladies : elle favorise la croissance des cheveux des femmes, elle donne même de la mémoire aux élèves, qui font alors des progrès surprenants dans la récitation du Coran. Les Regraga y procèdent à la vente aux enchères anticipée du tribut sur l’élevage et les Chiadma commencent à tondre leurs moutons. Généralement, à cette période, il faut juste un peu de pluie pour faire pousser le maïs. Ce sont les bénéfiques pluies de Nissane. On en conclut non pas que la clôture coïncide avec les pluies de Nissane, mais qu’elle tombe pour annoncer la clôture.
ays haha comprend en de nombreux endroits des arganiers sacrés gigantesques parce qu’ils ont toujours été épargnés par les coupes successives, ainsi que des tas de pierres sacrées dénommés Karkour. Cela pouvait être le lieu où un saint ou une sainte telle Lalla Aziza s’est arrêté au cours de son errance légendaire
« Une mémoire en devenir »

Lors de mon pèlerinage au Musée de Boujamaâ Lakhdar – placé sous le signe du faucon de Mogador – je me suis mis à l’ombre d’un immense arganier au feuillage luisant, et aux ramifications complexes. La veuve du « magicien de la terre » vint m’y rejoindre pour me raconter que les femmes du pays hahî se rendent en cortège chantant à cet arganier sacré, portant sur la tête des paniers remplis de coquillages, de semoule et de beurre. Une offrande dédiée à l’autel du dieu de la végétation pour qu’il éloigne des champs les nuées de moineaux dévastant les moissons.

Au cœur de l’été de 1989, Boujamaâ Lakhdar le magicien de la terre fut le seul artiste maghrébin à participer à l’exposition internationale organisée à Paris par le Centre Georges Pompidou, sur le thème : les magiciens de la terre. Conservateur et créateur du Musée d’Essaouira, il fut précurseur dans la mise en valeur des expressions populaires.

Boujamaâ Lakhdar
Ce qui importait pour lui, c’était la mémoire d’abord. Une mémoire qui soit, en même temps, le miroir de nos joies et de nos peines, de nos fêtes et de leurs parures, de notre manière de travailler la terre et de transformer la matière. Initié aux manières de faire des « maâlams » et à leur « empire des signes », il en fit la synthèse dans des compositions artistiques fort savantes ; des tables tournantes autour desquelles se créait la communication, un astrolabe musical et d’autres objets ésotériques. Sa toile, le « Bohémien » représente le mystique qui porte un masque d’aigle, rappel lointain des bas-reliefs égyptiens : le dieu Horus. Il porte une huppe qui est un symbole rural : à la campagne quand on rasait pour la première fois la tête des enfants, on leur laissait justement cette longue touffe de cheveux, symbole de la germination agricole. Ce bohémien porte une tunique rapiécée, comme celle du Bouderbala des « Gnaoua ». Toute une graphie vient renforcer cette idée du Bohémien qui marche dans la quête du « hal » : des oiseaux se transforment en écriture, en symboles magiques, en signes occultes. En bas, ployé sur lui-même, un taureau est éventré d’une épée en forme d’épigraphie « Tifinagh » qui le transperce. Un proverbe dit :. « Le taureau a rompu ses liens pour venir au-devant du sacrifice et de la mort ».Un jour Boujamaâ Lakhdar a eu cette formule : « Je veux toujours rester étonné ! »
Et l’on discerne bien ce qui l’inspire : une identification, foncièrement populaire, avec la souffrance, la sienne et celle des autres, qu’il assume. Sa dernière œuvre est un totem, car les artistes marocains sont d’abord des africains. Ils sont beaucoup plus influencés, disait Lakhdar, par tout ce qui est Afrique noire, du Soudan au Sahara, que par les autres civilisations. Ce Totemcouronné d’un masque, voilé de noir, forme une sorte de Trône, pour un prêtre fantôme venu des fonds des âges, ou d’une zaouïa des « Gnaoua ». Chacune de ses œuvres nous déconcerte par sa complexité. L’art était pour lui, un rite du silence qui anime les nuits de pleine lune. Une démarche de recul comme il l’expliqua un jour : « Pour aller plus loin, il faut s’inspirer de la culture populaire. C’est le retour sur soi et sa culture qui va permettre d’avancer. L’inspiration ne peut provenir que d’un recul par rapport à soi-même ».Toute son œuvre en témoigne. Sa démarche a été un parcours du dedans, une quête spirituelle, une initiation à l’esprit d’une culture et à l’âme d’un peuple.

Boujamaâ Lakhdar
Boujamaâ Lakhdar, ce « magicien de la terre » disait à propos de ses tableaux-amulettes et de ses objets ésotériques : « Derrière chaque œuvre, il faut dire qu’il y a une longue histoire, l’histoire de mon discours mimé qui me dérange et celle d’un grand rêve qui n’a ni début ni fin. C’est donc l’histoire d’un thème que j’ai incrusté, peinte, marquetée, brodée, sculptée...chaque fois que je suis en transe ».Pour décoder les messages auxquels recourt l’artiste, il faudrait non seulement faire appel à l’interprétation des rêves, mais surtout à l’archéologie des archétypes ancestraux qui tatouent d’une manière indélébile la mémoire.
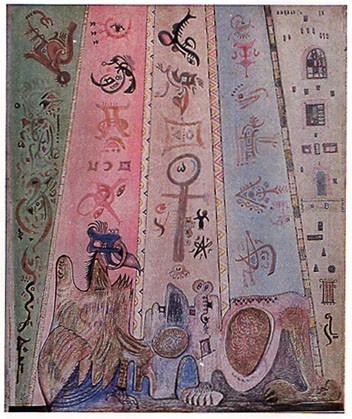
En me rendant d’Essaouira à Casablanca, le lundi 16 mars 2009, je suis profondément bouleversé par l’annonce de la mort de mon ami Abdelkébir KHATIBI. Ce qui m’a le plus bouleversé, c’est d’avoir au bout du fil sa fille éplorée : « Ils vont l’enterré au cimetière des martyres ! » me disait-elle. De lui, j’ai voulu m’entretenir avec n’importe qui. En me disant quelque peu coupable : il faut écrire quelque chose. Mais quoi ? Mon immense tristesse et ma solitude de plus en plus grande. Une amie m’a cependant conseillé de ne pas renoncer à exprimer à chaud, ma tristesse, sans qu’il y ait là ni culpabilité ni narcissisme de ma part : partager – faire part- de notre sensible expérience, et quelles que soient les couleurs qui lui viennent, à notre sensibilité, si tel est le sens de notre humaine humanité. En un mot « faire un travail sur soi » et sur sa « mémoire en devenir », comme me le conseillait Abdelkébir KHATIBI, lui-même.
J’avais travaillé avec lui à la revue Signes du Présent[1] en 1988, où j’ai publié « Sociétés sans horloge », mon étude comparative entre « Les Argonautes du pacifique occidental » de Bronislaw Malinovski et le Daour des Regraga auquel je venais de participer. Dans cette étude j’écrivais entre autre : Dans cette énorme roue qu’est le temps, les vies humaines ne constituent que des jalons qui se succèdent de génération en génération jusqu’à l’horizon des siècles qui se perdent. Les Regraga s’obstinent à tourner autour du printemps : on a du mal à percevoir chez eux, le temps qui passe, les hommes qui s’en vont dans le silence. Il y a donc plusieurs « revenir » : celui des saisons, celui du rituel, celui du mythe et celui des revenants comme le note le romancier marocain Abdelkebir Khatibi :
« La tradition est le revenir de ce qui est oublié. Ce revenir doit être retenu et questionné pour qu’il nous indique le chemin des morts qui parlent. Que dit la tradition – toute la tradition ? Elle dit le séjour du divin dans le cœur et la raison des hommes. Ce séjour, la métaphysique l’a recueilli dès l’éveil de la pensée. La métaphysique est en quelque sorte, le ciel spirituel de la tradition ».
Invité à un colloque de poésie en Italie, Abdelkébir Khatibi, m’avait alors confié son propre bureau à l’Institut Universitaire de la Recherche Scientifique pour y écrire mon étude qui sera publiée cette même année au n°4 de Signes du présent, consacré au temps et à la culture technique. Abdelkébir Khatibi y publiait un intermède intitulé « Jeux de hasard et de langage ». Il m’avait également chargé d’un compte rendu d’ouvrages d’auteurs ayant traité du temps : l’horloge hydraulique de Fès d’après un document arabe d’Al Jazari, l’horloge chinoise d’après Nedham, l’attracteur universel d’après Ilia Prigogine, prix Nobel de Chimie... A son retour d’Italie, il m’avait confié que pour lui « le temps, c’est la vie ».
Cette collaboration qui m’avait permis de publier ma seule étude véritablement scientifique, n’est pas née du hasard : comme il me l’a confié lui –même, mon étude comparative avait pour arrière plan « tout un livre » et surtout tout un travail de terrain qui a duré quatre années auprès des Regraga en pays Chiadma, soit de 1984 à 1988. Mais ma première rencontre avec Abdelkébir remonte à 1987, quand en tant que journaliste, j’ai publié le 12 janvier à Maroc Soir, notre entretien intitulé :« Notre mémoire est une richesse, prenons-la en charge » . On y décelait déjà sa préoccupation du temps qu’il s’agisse de l’eternel retour ou le temps irréversible de la mort et de l’histoire :
Maroc soir. – Dans votre dernier recueil « Dédicace à l’année qui vienne », il y a un rapport au temps cosmique et saisonnier, au temps amoureux. L’année, l’anniversaire, le mois, le jour, la clarté à partir des lois propres de la poésie. Donc dédicace à l’année qui vient. Vous rejoignez un peu les rites de passage qui font partie de notre culture...
Abdelkébir Khatibi : Oui, c’est d’ailleurs une poésie ritualisée. Dans le deuxième poème, il est dit : « Ritualiser chaque mot en son cadre d’or ». Ritualiser, en faire une cérémonie et que le principe de ces poèmes c’est donc fonder la poésie sur des gestes qui existent dans notre société aussi. C'est-à-dire le rite, le retour des fêtes, des années...
Maroc-Soir. – Mais il n’y a pas de rites sans musique. Marcel Mauss disait : « L’homme est un animal rythmique ». Vous parlez vous-même de la musique du silence, je vous cite : « Cette belle idée de l’art rendue humblement au silence des choses »...
Abdelkébir Khatibi : Oui, j’essaie dans la mesure de mes moyens de retrouver ce que j’appelle « une mémoire en devenir ». C’est qu’il y a toute une richesse en nous que nous ignorons. Parce que nous imitons trop vite soit la poésie des autres soit l’écriture des autres. Alors qu’en nous, dans notre sensibilité il y a une part très riche mais à côté de nous. Alors, comment peu à peu découvrir cette mémoire en devenir ? C’est un travail sur soi. Il n’y a pas d’autres voies que de travailler sur soi – je ne parle pas simplement affectivement et au jour le jour, régler les problèmes de l’économie, du travail. Mais je pense aussi au travail sur soi, quand on est artiste. Ce travail sur soi demande de puiser dans sa force et de la reconnaître, de lui donner sa place.
Maroc-Soir.- Dans les pays Arabes les rapports entre hommes et femmes sont entourés de trop d’interdits...
Abdelkébir Khatibi : Il ne faut pas exagérer, il y a des choses qui sont dites, d’autres silencieuses. Chaque société a des règles sur l’interdit, sur la parole interdite. Mais pour quelqu’un qui lit au second degré ; il trouve toujours qu’on parle d’une certaine manière d’une société. Si vous lisez par exemple « L’anthologie de la poésie Esquimau », vous allez trouver partout cette métaphore ; en parlant d’une femme, le poète dit : « Vous êtes belle comme un petit phoque ». Evidemment pour un arabe ça ne veut rien dire le « petit phoque ». Lui, il a parlé de gazelle, d’oiseaux, de colombe ou, de métaphores végétales différentes. Donc la représentation de l’amour sous forme poétique change.
Maroc-Soir.- La tradition n’est pas seulement ces « mort qui nous parlent » ; la tradition retrouvée et travaillée peut devenir une nouvelle source de créativité...
Abdelkébir Khatibi : Ah oui, moi j’irai assez loin – et je crois que j’ai eu l’occasion de le dire devant l’Union des Ecrivains Marocains – que dans la tradition poétique marocaine ( c’est la poésie populaire Arabe, Berbère) est de très loin la plus importante, la plus adaptée à notre imaginaire. Je considère Sidi Abderrahman el-Majdoub comme le meilleur poète Marocain jusqu’à maintenant. La poésie populaire dans ses différentes composantes – la plaine, la côte, la montagne – peut entrer dans une mémoire en devenir. Par exemple l’audio-visuel – qui n’est pas encore techniquement avancé chez nous – s’il veut travailler sérieusement devrait entrer en contact grâce à des artistes, avec l’art et la culture populaire. C’est une chose qui n’est pas encore faite. Donc au lieu que la culture populaire soit simplement décorative ou folklorisée ; elle est partie prenante de l’avenir et de la mémoire en devenir. Elle peut donner naissance – grâce à des artistes et des poètes – à de nouvelles formes artistiques. Je vais vous donner un exemple qui n’est pas Marocain : le grand pianiste Chopin – l’un des plus grands écouté dans le monde – avait écrit la plupart de ses partitions à partir des airs populaires polonais, et il en a fait une musique internationale et mondiale. Il a fait la synthèse entre la musique classique et la musique populaire. A mon avis, c’est un travail sur nous, c’est de prendre en charge toutes les stratifications de notre mémoire qui est une richesse.
Maroc-Soir – Les représentations paysannes sont parfois poétiques comme ce jeune fellah qui me dit : « La coccinelle nait simplement de la rosée du blé » ?
Abdelkébir Khatibi : C’est très beau ce qu’il dit sur la coccinelle. Ça me fait penser à une coccinelle qui a fait tout le voyage du Sud de Suède en train avec moi. Elle était là dans le wagon. On a pris le ferry boat pour traverser et elle a disparu. Une coccinelle qui a donc passé les frontières à sa manière sans passeport. On pouvait faire un conte sur les coccinelles qui traversent les frontières. La coccinelle en arabe, en berbère, en français, est une métaphore d’autre chose.
Maroc-Soir – Un autre fellah me fait cette réflexion : « Il y a deux types d’esprits. Ceux qui sont soit mâle soit femelle sont stériles. Seuls ceux qui sont à la fois mâle et femelle fécondent les idées ». Je vous rapporte ces propos parce qu’ils me font penser à certaines de vos réflexions sur l’androgyne.
Abdelkébir Khatibi : Dans ma tête, l’androgynie c’est une manière de vouloir faire un. C’est l’amour lui-même. C’est la tentation de l’amour de faire un et en fait il y a un et un, ça fait deux. Il y a une sexualisation. Et il y a trois, le troisième étant l’enfant. Donc, l’amour, c’est vouloir faire de trois l’un. Ce qui est évidemment une tentation mythique de l’androgyne depuis longtemps. Il faut bien mettre les choses au point entre la réalité et l’imaginaire mythique. L’androgyne pour moi c’est le mythe de l’unité de l’amour, c’est tout.
Maroc-Soir – Un conteur populaire me dit un jour : Le jour de la résurrection même les analphabètes retrouveront la faculté d’écrire ; l’indexe sera leur plume, la bouche leur encrier et le linceul la page blanche. Comme le miracle coranique avait commencé pour le Prophète par l’impératif : « Lis ! », le miracle de la résurrection commencera pour chacun d’entre nous par l’impératif : « écris ! ». Qu’en pensez-vous ?
Abdelkébir Khatibi : On peut interpréter de différentes manières. Je ne suivrais pas sa manière d’interpréter. Mais par exemple, symboliquement l’enfant apprend la langue, il naît au monde en tant que corps et puis il naît au langage en apprenant le premier mot, son nom propre, le nom propre de sa mère, son père, son entourage et il entre dans le langage comme naissance. Une résurrection dans ce sens là, parce qu’elle permet de rentrer dans un autre ordre du symbolique qui change les choses dans le sens où l’activité de l’écrit a sa loi propre. C’est une activité qui laisse des traces, qui durent et qui entrent dans une mémoire et dans une généalogie de textes, qui se transmet de siècles en siècle. Donc, la résurrection c’est la survie aussi de textes dans ce sens là.
Dans "Mémoire tatoué", Abdelkébir Khatibi évoque Essaouira en amoureux courtois :"Coquille entourée de sable, cette ville s'ébauche en une miniature aux couleurs tendres, et je tais d'autres vibrations".. sa plage "se laisse coiffer gentiment par de petites barques en bois". C'était du temps où on pouvait croiser Orson Welles sur les remparts de la Scala de la mer,dans le rôle du fougeux Othello face à la charmante Desdemone: 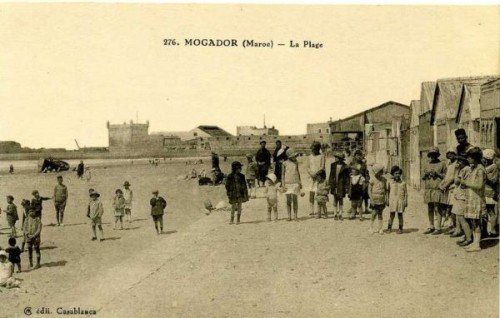
Froide, souvent balayée par le courant des cannaries, la plage monte de l'eau, poussée par un horizon légèrement courbé. Il faut un regard pâle et malicieux pour éviter les grains de sable, qui attaquent quand on tourne la tête, et s'envolent gentiment dans tous les sens.La plage se laisse coiffer par de petites barques en bois, fuguant tranquillement en une série monotone; cela arrange bien les choses si s'habitue le regard, on appuie sur l'oeil et la ligne s'aligne, elles, les barques mignonnes, maisons de poupées, on a affaire à un peu de vent fougeux, qui mord mieux? Pas même les vagues, car elles se bousculent, comme pour s'excuser, elles contournent au loin un îlot, prison dedans, près du port, l'empire portugais avec la marque massive de ceux qui croyaient enchaîner les hommes à la pierre. Ville à vendre disent maintenant les gosses.Il y a dans cet urbanisme costaud, le rêve grandiose des pirates de l'histoire.Là aussi, vent sableux déjouant la majesté de ces forteresses, je pointais vers la mer, à travers les canons enfourchés, le cri.Le Dieu de notre enfance est-il mort, cent fois mort,jeté sur les rochers?Orsen Welles y tourna son Othello, ténébreux, décisif, un couteau.La ville qui y figurait, recrutée à coup de dollars, connait par coeur le drame de la reine assassinée.Ainsi, la jalousie, reine à vendre aussi. Coquille entourée de sable, cette ville s'ébauche en une miniature aux couleurs tendres, et je tais d'autres vibrations: la surprise du soleil, la ville se recrovillant et le parfum d'argan, lieu commun du sud marocain et impression douceâtre d'un vol continu.Le mellah n'est pas loin, d'autres odeurs, un autre dialecte légèrement chantant qui me faisait pouffer.Je happais des calottes de vieux bonhommes, et les vendais.Avec l'argent, on recommençait dans l'autre sens.Il serait dit que lejuif refera l'histoire à rebours, prisonnier d'une différence millénaire.Ce ne sont que légendes d'Anciens. Paix!Paix!Paix!"
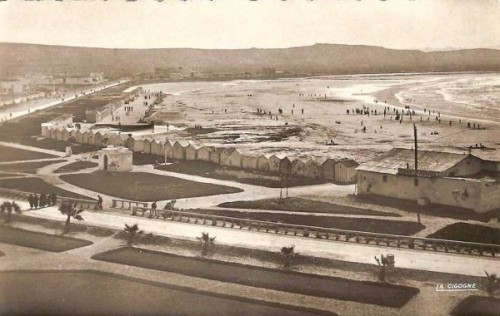
. Les cabines de la plage étaient d'abord en bois puis en pierre de taille s'ouvrant en arrêts de poisson sur la plage avant d'être démolies par le conseil municipal présidé par Tahar Aifii au début des années 1980 : le même qui a résé les vieux cimetières de Bab Marrakech et qui a détruit les marchés du centre de la médina ainsi que le vieux marché des orfèvres et des bijoutiers.Voici le plus récent témoignage sur le cimetière de Bab Marrakech publié sur facebook par un jeune de la ville :
« Le lundi 5 septembre 2011, alors que je rentrais par Bab Marrakech , j’ai vu pleurer amèrement un français âgé de plus de soixante dix ans :
- Qu’est ce qui vous fait pleurer ainsi ? Lui demandé-je.
- Un ami d’Essaouira, me répondit-il. Il s’appelait Brahim et il était enterré au cimetière de Bab Marrakech. Je venais régulièrement me receuillir sur sa tombe. Mais cette fois ci je n’ai trouvé ni cimetière ni tombe pour me recueillir. Qui est responsable d'une telle profanation ? Qui s’est permi d’effacer ce lieu de mémoire ? Puis, aux pas de charge il se dirigea vers la municipalité, probablement pour y trouver un début de réponse à cette question douleureuse qui le tarrode désormais : Pourquoi en terre d'Islam un tel mépris pour la mémoire des morts?
Le centre ville fait maintenant pitié par comparaison à celui d' hier : il n’y a plus ce bel ordonnancement des corps de métiers de jadis, où les marchands des quatre saisons occupaient un segment à part de celui des forgerons et des marqueteurs. Il y avait même un édit municipal du Protectorat qui interdisait le mélange des genres, des torchons d'avec les serviettes comme on le constate maintenant. Aujourd’hui nous constatons avec désolation une indescriptible anarchie où les marchands de pacotilles envahissent allègrement l’allée des bouchers et où plastique et aluminium viennent se placer au beau milieu des vendeurs de fruits et légumes. La ville connaît une alarmante dégradation de son tissus urbain et de sa qualité de vie : elle passe pour ainsi dire du statut d'une ville Méditerranéenne sur l'Atlantique , d'une Cordoue en pays de l’arganier, à celui d' une bourgade rurale décrépie donnant raison à un Orson Welles à qui on demanda un jour au soir de sa vie:
- Maître, pourquoi vous ne revenez pas à Mogador de vos anciens amours?
- J'ai peur que la ville ne soit plus le Mogador que j'avais connu...."Leur répondit-il.

Le chalet de la plage avait ouvert ses porte au tout début des années 1950, c'est à dire en plein tournage d'Othello : Orsen Welles, se rendait souvent à ce nouveau restaurant accompagné du fils aîné des Papes, colons qui possédaient une ferme à Chichaoua et à qui appartenait le bain maure où eut lieu d'ailleurs une des scènes du film....Dans cette lettre Orson Welles explique que c'était le marché au poisson qui tenait lieu de bain turc!
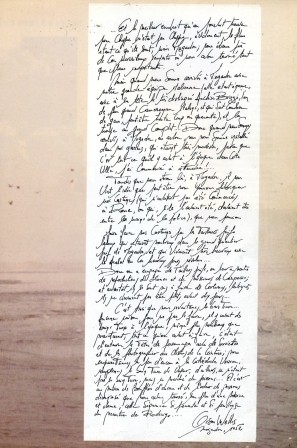 Et le meilleur endroit qu’on pouvait trouver pour Chypre n’était pas Chypre, évidemment, les films étant ce qu’ils sont , mais Mogador. Nous étions près de ces merveilleux remparts où nous avons trouvé tant de plans importants…Mais quand nous sommes arrivés à Mogador avec notre grande équipe italienne (elle était énorme, avec à sa tête le très distingué A.Brizzi, l’un des plus grands cameraman italiens, et qui sait combien de gens, peut-être trente cinq ou quarante) et la troupe au grand complet…Donc quand nous sommes arrivés à Mogador, en avion, nous nous sommes installés dans nos garnisons qui étaient très modestes, parce que c’est tout ce qu’il y avait à l’époque dans cette ville . J’ai commencé à attendre !...
Et le meilleur endroit qu’on pouvait trouver pour Chypre n’était pas Chypre, évidemment, les films étant ce qu’ils sont , mais Mogador. Nous étions près de ces merveilleux remparts où nous avons trouvé tant de plans importants…Mais quand nous sommes arrivés à Mogador avec notre grande équipe italienne (elle était énorme, avec à sa tête le très distingué A.Brizzi, l’un des plus grands cameraman italiens, et qui sait combien de gens, peut-être trente cinq ou quarante) et la troupe au grand complet…Donc quand nous sommes arrivés à Mogador, en avion, nous nous sommes installés dans nos garnisons qui étaient très modestes, parce que c’est tout ce qu’il y avait à l’époque dans cette ville . J’ai commencé à attendre !...
Tandis que nous étions là à Mogador, il nous vint l’idée que peut-être nous pourrions fabriquer nos costumes ( qui n’avaient pas été commencé, à Rome, ou qui, s’ils l’avaient été , devaient être entre les mains de la police) , que nous pouvions faire faire nos costumes par les tailleurs juifs de Mogador qui vivaient très heureux en ces jours révolus…Donc on a engagé des tailleurs juifs , on leur a montré , des reproductions, de Dames et de Messieurs, de Capocco, et aussitôt ils se sont mis à les faire…Il y avait des bains turcs à l’époque ; tout ce qu’on avait à faire , c’était d’entourer les têtes des personnages avec des serviettes et de les photographier au dessus de la ceinture. Nous empruntâmes , un peu d’encens à la cathédrale voisine, remplîmes le bain turc de vapeur(d’ailleurs, ce n’était pas le bain turc, mais le marché de poissons). C’est au milieu des bouffées d’encens et de l’odeur de poissons décomposés que nous avons tourné sur plus d’une bobine et demie, cette séquence si prenante et si périlleuse du meurtre de Roderigo.Orson Welles
Le tournage d’Othello a Mogador a duré exactement dix mois ; soit du 12 juin 1949 au 7 mars 1950, comme en a témoigné l’acteur Micheal Mac Liammoir (qui joue le rôle de Lago dans le film) dans son carnet de tournage. Ce qui suppose u’Orson Welles avait effectué ses repérages à Mogador bien avant cette date :
Marrakech le 21 Mai 1949
C’est pour moi, la principale nouvelle , et de plus celle qui me donne le tournis : nous allons faire Othello à Mogador et , pas du tout à Rome , ou Nice ou Paris, non. C’est la toute dernière trouvaille d’Orson Welles…Mogador possède une forteresse qui a été construite par les Portugais (Dieu leur pardonne !) au seizième siècle …La mer naturellement sera herrlich, mais Mogador étant située sur l’océan atlantique, elle sera aussi beaucoup trop froide pour qu’on puisse s’y baigner même en été. De plus, il y a du vent et du brouillard. Le vent vient aussi de l’atlantique, et nuit et jour, les vagues déferlent par dessus la forteresse : elles provoquent le brouillard qui donnera cette impression de mystère, d’étrangeté, ce climat, cette stimmung quoi ? Si convoitée par der Welles.

Mogador, le 10 juin 1949
Des nouvelles alarmantes nous arrivent : toute la garde robe masculine est bloquée indéfiniment à Rome(les vêtements des femmes sont en sécurité ici). On a procédé à une revue complète des costumes (ils empestent le comphre et évoquent davantage Véronèse que Carpoccio, mais on peut les retoucher). Dans un local loué dans la médina, on a aussi étalé quelques belles armures. Orson a décidé d’ouvrir le feu et de commencer par tourner la tentative d’assassinat de Cassio, puit le meurtre de Roderigo par Lago qui lui fait suite. Orson est sorti d’une nuit blanche avec l’idée ue l’assassinat se passerait dans un bain turc.
Le 12 juin 1949
Il faut se rendre à l’évidence : si les vêtements de Lago pourront être prêts dans quelques jours, le tailleur de la ville ne nous permet pas de tels espoirs pour les costumes de Othello, de Roderigo ou de Cassio. Orson est au désespoir : dans toutes les scènes de l’arrivée à Chypre par lesquelles il voulait commencer son tournage figurent inévitablement ces personnages . 
Le 7 juillet 1949
Merveilleuse journée sur une plage à l’est de la ville. Nous jouons la scène où Othello (dissimulé) n’entend pas. C’est un miracle. Lago dit à Cassio :
- Si l’affaire dépendait de Bianco , comme vous réussiriez vite !
Par contre au moment où Bianco les rejoint, il entend très distinctement la réponse de Cassio :
- Hélas, pauvre coquine, je crois vraiment qu’elle m’aime.
Et toute la conversation qui l’égare et perd Desdémone.
Le 14 juillet 1949
Orson dont les yeux sont à nouveau injectée de sang, a envoyé Betsy à Paris pour de mystérieuses vacances …Apparemment , il est à nouveau à la recherche d’une autre Desdémone.
Le 16 juillet 1949
Nous passons toute la journée à répéter frénétiquement ce fragment de la scène de jalousie . Orson, magnifiquement habillé et maquillé brun - chocolat par Santoli, met Vasco , fait les cent pas pendant des heures pour s’imprégner de la scène. Il va et vient au bout de la tour de garde la plus éloignée, au milieu d’un enchevêtrement de pièces d’artillerie, et donne le frisson aux techniciens inquiets qui voient en bas les rochers noirs et les vagues qui sautent et, au dessus de leur tête, la tempête qui hurle.

Mogador 19 janvier 1950
Orson parait en forme , mais ses yeux sont injectés de sang. : il a dû avoir des soucis. Nous commençons à travailler mardi(Orson ne doit pas être au courant ou bien l’aura oublié sa résolution inébranlable de ne pas commencer quelque chose un mardi, ce jour portant malchance en Espagne).
Le 7 mars 1950
Quand tout fut fini et que , une fois de plus, le soleil eut disparu dans la mer ; Orson procède à l’habituelle cérémonie d’embrassade, inévitable quand il a déchargé d’un poids son esprit, sa poitrine ou tout autre partie de son corps, puis il me dit :
- Monsieur Marc Liammoir je suis heureux de vous annoncer u’à présent vous êtes un acteur en congé, vous en avez terminé avec Lago.
Après nous avons bu du champagne au club. J’étais mi-triste , mi-joyeux. Joyeux parce que c’était agréable de retourner passer une semaine ou deux à Paris , de faire des plans pour de prochains films et d’entendre les tous derniers projets d’Orson. Mais ce sera triste parce que nous sortirons d’une aventure , Hilton et moi, et nous deux nous aimons les aventures ( avec ou sans raison et celle-ci a été la nôtre).En outre cela va être éprouvant , pénible, déchirant, de faire ses adieux à Mogador, où, pour moi, le film commença et se termina.Et par-dessus tout ça sera triste de voir s’estomper le souvenir de ses amis, de ses compagnons, qui sont restés jusqu’au dernier jour…
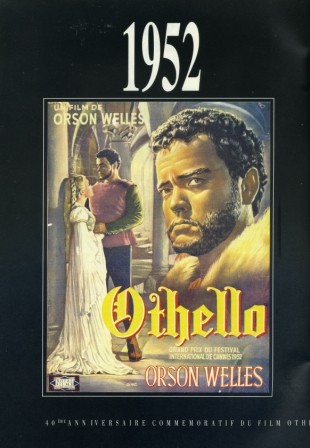
Dans son témoignage à Mogador en 1992, Beatrice Welles – SMITH , la fille d’Orson qui a travaillé à la restauration du film disait que quand son père parlait d’Othello, il le faisait avec un profond amour : « Il se rappelait toujours avec bonheur du tournage du film au Maroc , pays qu’il admirait énormément. Au point que quand il est allé présenté Othello au festival du film à Canne, il le fit sous le drapeau marocain. Je suis fière de dire que c’est pour son film marocain qu’il avait obtenu la si convoitée « Palme d’or »…C’était l’un des plus grands artistes de tous les temps. »

Affiche réalisée en 1992 par Hucein Miloudi
pour le 40 ème anniversaire du tournage d'Othello à Mogador
Le décor joue un rôle essentiel dans la mise en scène de la tragédie d'Othello. Ceux de Mogador avec sa forteresse dans les brumes avec une telle découpe sur le ciel qu'elle convient le mieux au complot Shakespearien de Lago. Au début des années cinquante, le souvenir était encore vivace du tournage d’Othello par Orson Welles à Mogador. Le soir on le voyait souvent méditer sur la grande place du syndicat d’initiative.
Ô toi qui s’en vas vers Adouar
Emporte avec toi le Nouar
La rime est un jeu de mot entre « Adouar » (le nom de la sombre impasse supposée cacher les belles filles de la ville) et le « Nouar » (le bouquet de géranium et de basilic).
Mon père me racontait qu’un jour Orson Welles se présenta à son atelier alors qu’il était en train de terminer une magnifique table en bois d’arar, décoré de dessins géométriques complexes et de rinceaux d’inspiration andalouse. Quand mon père dit à Orson Welles le prix de la table en question, le cinéaste américain en fut offusqué :
- À ce prix-là, lui dit-il, je briserais cette table sur ma tête plutôt que de la vendre !

L’atelier fermé de mon père
Maintenant,dans une ville-bazar, partout s’installent des bazaristes venus du Grand Sud. . Il n’y a plus d’artisans incrustant la nacre dans les essences de l’Atlas. Les artisans meurent, émigrent ou noient leur chagrin dans le vin. Je passe devant l’atelier de mon père : fermé. Celui d’Amseguine, le maître des rebouteux, également. Celui de Ba Antar avec ses tables d’arar aux dessins géométriques et floraux complexes, aussi. Les grands maîtres de l’artisanat local morts, ne reste plus qu’un immense bazar. Les Rifains en nouveaux seigneurs du port, les Sahariens pour les bazars, et les Européens pour les riads, voilà la nouvelle configuration du peuplement d’une ville où il faut être désormais du tourisme ou ne pas être. De « carrefour culturel », Essaouira n’est plus qu’une station balnéaire, où la plage – le convivialtaghart de notre enfance, jadis dédié aux compétitions sportives entre quartiers est désormais vendue aux résidents d’hôtels de luxes et quadrillée de policiers, à moto, à cheval et à pied, et le soir venu, violemment éclairé par de puissants projecteurs : surveiller et punir… Il est loin le temps où les femmes venaient se débarrasser du mauvais sort, aux sept vagues de l’aube, le temps où des devineresses berbères prédisent l’avenir en écoutant des térébratules fossiles, le temps où l’on n’osait pas s’approcher des vagues les nuits obscures, de peur d’être frappé par les déesses de la mer. Bref, il est loin le temps des ensorcellements et des mystères. Voici venu le village planétaire des marchandises… et des rencontres virtuelles des solitudes.Seul le mellah,le quartier juif, taudifié

et en partie effondré, échappe encore à cette balnéarisation mondialisée, parce que trop exposé aux embruns. Mais guère pour longtemps…(on peut lire en bas de la photo en noir et blanc: "Street in JewsTown,Mogador).Au mellah un flot de touristes est invité par un guide à visiter une vieille maison juive sur laquelle est écrit :« Cette maison est à vendre : porte ouverte à l’acheteur ».

La maison et le bain "Papes"
Les Papes étaient nos voisins et leurs enfants nos amis. En leur compagnie nous avons connu les moments de bonheur les plus intenses de notre enfance. Charles, Michel et Patricia Papes, de petits français en plein quartier arabe! Ensemble nous explorions à la lisière des vagues, de petits coquillages dissimulés sous le sable, nous construisions nos châteaux éphémères sur la plage, et plus loin encore nous rejoignions les ruines du palais ensablé au fond de la baie où au milieu des algues et des rochers aux eaux limpides nous recherchions les frétillantes crevettes grises ainsi que les têtards de l'oued ksob et les escargots que nous récoltions sous les pluies battantes à l'ombre des mimosas en fleurs de Diabet…
Des années plus tard j’ai appris que Michel Papes, mon ami d’enfance avec lequel je jouais dans les sombres ruelles de Mogador et que je retrouvais avec un immense plaisir à chaque retour de l’été, serait mort d’un accident de voiture en France. Ce jour là j’ai rêvé que je courrais après lui sur la plage immense et lumineuse et qu’au moment de l’attraper il s’est envolé au ciel comme s'envolent les oiseaux de ces rivages….
La mort violente qui vient ainsi briser l’élan de la jeunesse est des plus insupportable.Le souvenir de mon ami défunt Larbi Slith me revient avec la mue de chaue printemps et le départ de « la fiancée de l'eau » des Regraga, qu'il visitait à la fin des années 1980 en espérant que leurs prières apaiseront les douleurs du cancer qui le tenaillait à la gorge et qui a fini par l'emporter. Les premiers rudiments de l'art islamique, il les a appris à l'école coranique : en lavant sa planche d'une sourate apprise pour la remplir d'une sourate nouvelle, il fit le lien entre le chant sacré qui illumine son cœur et la belle forme qui éblouit son regard. Les belles lettres ne sont jamais muettes ; elles sont la voix céleste qui illumine le monde, le sens sans lequel la vie n'a pas de sens. L'artiste garde ainsi, au fond de lui-même, cette nostalgie du paradis de l'innocence, cette première découverte inouïe du divin. La calligraphie orne ainsi le ciel de la toile comme une nuée d'oiseaux migrateurs, empreintes de caravanes errantes dans le désert, odes arabes rythmant le déhanchement des chameaux, procession cosmique dans les hauteurs stellaires, célébration de l'aube du temps, stèle funéraire :
« J'écris sur ma toile, disait le peintre mystique Larbi Slith, en miniature, les mots qui ouvrent chaque sourate et qui représentent l'invisibilité et la puissance de Dieu. J'orne mes toiles d'un alphabet dansant, chantant, un alphabet qui parle, il parle d'horizons lointains, il parle de moi, embryon au milieu de la sphère tendre et chaleureuse. »
Vue d'Essaouira depuis les ruines du palais ensablé(ph.Abdelmajid Mana)
L'art est ici proche de ces pratiques mystiques où l'on pensait que la perfection nominale consiste à conjurer les esprits des sphères et des astres. Plus une forme est belle, plus elle a de la chance de faire sortir l'artiste de son île où souffle un vent de crabe, pour le livrer à l'univers éblouissant des idées.
Né au cœur - même de la médina d'Essaouira - qu'il a rarement quitté- Larbi Slith était un oiseau de mer, un être fragile au milieu des tempêtes. Il portait en lui, l'extrême sensibilité du musicien, la tendresse du peintre et la détresse de l'artiste. Il incarna, pour nous, l'éternelle jeunesse des « fiancées du paradis », leur errance sauvage, leur douleur solitaire. Après avoir raclé les guitares des années soixante dix, il s'était mis à communiquer avec les formes cosmiques : il peint la rumeur de la ville, la baie immense et lumineuse, les haïks immobiles, les sphères de la marginalité et du silence, les prières de la nuit et le soupire de l'océan. Chaque toile était pour lui une épreuve de la purification et une prière. Son art était une lutte continue contre les souillures de ce monde et l'épaisseur de son oubli. Son microcosme de signes et de symboles archaïques sont la « trace » de la transfiguration du monde par les visions oniriques. Pour lui, la peinture fut une trace, et la « trace » est la forme suprême de la lutte contre la fuite du temps. Il était habité par l'urgence de créer, par le désir d'éternité. Chez lui, la peinture devenait un tatouage de la mémoire par les couleurs du destin, une procession des saints vers les soleils éclatés...Et les lumières énigmatiques du rêve émanaient de ses couleurs étranges. Les couleurs que prend l'âme à l'approche des énergies telluriques de la montagne. Mais la douleur retira avec les énergies vitales, les couleurs chaude de sa dernière toile ; il y mit un éclipse du soleil, un ciel de linceul, des racines aériennes emportées par le vent vers l'au-delà des êtres et des choses. Il était notre Rimbaud de la peinture, une fleur de la morte saison pour qui les aubes d'hiver sont cruelles et navrantes entre toutes : « Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes... ». Peintre mystique, l'art fut pour lui, une secrète hégire vers Dieu. Par nos larmes intérieures, au cœur de l'hiver - le 4 octobre 1989 - nous confiâmes une part de nous-mêmes, à la colline du bon Dieu. « M'cha zine Oukhalla H'roufou » : le beau est parti mais il a laissé ses alphabets , ses traces...
Pavillon encore debout du palais ensablé au fond de la baie(ph.Abdelmajid Mana)
Sur la trace de l’aube
Ph.Abdelmajid Mana
Ma première rencontre avec Georges Lapassade remonte à la période où il enquêtait sur Ben Sghir pour répondre à une double commande : celle du caïd Bassou de la division économique et sociale de la province d’Essaouira, qui voulait publier les travaux du colloque de musicologie (1980-1981)dont les actes sont parus par la suite dans la revue Transit de Paris-VIII, sous le titre Paroles d’Essaouira. Il s’agissait aussi de répondre à la demande de son ami Dominique Bedou, petit éditeur de poésie qui voulait publier un recueil sur la poésie d’Essaouira en tant que « carrefour culturel ». J’enseignais alors au Lycée Akenssous de la ville. Un jour, au tout début des années 1980, le proviseur m’invita à une réunion prévue vers 16 heures à la Chambre du commerce, entre Georges Lapassade, et les connaisseurs du Malhoun de la ville. La réunion était provoquée par Georges qui enquêtait alors sur Ben Sghir. Il comptait ainsi sur la dynamique du groupe pour faire avancer sa recherche.A l’origine de cette enquête, un article où Hachmaoui et Lakhdar, résumaient la qasida de Lafjar (l’aube) de Ben Sghir sans donner le texte. C’est après cette réunion que Georges m’embarqua dans l’enquête sur les traditions poétiques et musicales d’Essaouira et sa région qu’il menait à l’issue du premier festival d’Essaouira « la musique d’abord » (1981-82). Une fois à Paris il me faxa ce qui suit :
Toute la démarche de l’enquête ethnographique de Georges Lapassade réside dans ce texte : alors qu’il demandait des informations sur Ben Sghir, au bazariste Ben Miloud, celui-ci était assis sur un vieux coffre qui contenait plein de qasida, dont celles de Ben Sghir ! C’est pour contourner cette rétention d’informations, ces réticences locales qu’il se voyait obligé de se rendre à Marrakech pour obtenir la fameuse qasida de Lafjar (l’aube) ! Lors de cette enquête sur les paroles oubliées d’Essaouira, Ghorba le cordonnier d’Essaouira, refusait lui aussi de transmettre le contenu de sa « khazna »[1] à Georges Lapassade jusqu’au jour où après sa mort, sa vétuste boutique de cordonnier s’effondra engloutissant à jamais sous les décombre, tout le trésor poétique qu’il conservait si jalousement.En participant ce printemps 2009 à Essaouira au colloque de musicologie de la deuxième édition du festival du Malhûn, les musiciens de la ville m’ont parlé d’une seconde mort de Ben Sghir avec la disparition de Georges Lapassade, son découvreur. C’était une flamme qui s’était éteinte. C’est à Georges Lapassade en effet, que revient, le mérite d’exhumer et de diffuser « Lafjar » (l’aube), la qasida de Mohamed Ben Sghir, le poète du melhûn d’Essaouira, qu’on avait retrouvée dans un cahier daté de 1920 :
De Mohamed Ben Sghir

Hucein Miloudi
Les habitants de la terre ne peuvent l’atteindre
Vois Mars, toi qui es indifférent
Sa beauté apparaît au monde clairement
Vois Mercure qui vient à toi, ô voyageur
Au dessus du globe, de l’ignorance étonnante
Vois Neptune qui illumine les déserts
Il a mis dans la création, le riche qui a tout.
Vois Saturne qui vient visiblement vers toi
Au-dessus des sept du secret parfait
Guerre des hommes, ô toi qui dort,
Vois le mouvement des astres
Ils ont éclairé de leur lumière éclatante, les ignorants.
Et sache la vérité si tu veux être pur
Lafjar (l’aube) qui t’advient d’une science illuminée
Prends ô toi qui m’écoutes Yabriz et Nikir
Celui qui règne sur le plus rusé des loups
Celui qui répond très vite au défi
Doit protéger les fauves
Est-ce que le hérisson peut aller à la guerre contre l’ogre ?
On connaît l’aigle parmi les faucons
Il craint le moindre bruit et les fauves au sommet des montagnes
En passant par les grottes Bendir Telemsani et son beau cortège
Dites à celui qui n’est ni faible ni vantard
Que Mohamed Ben Sghir est une épée dégainée.

Hucein Miloudi
Je suis depuis quelques jours à Essaouira pour participer au colloque sur le Malhûn - une tradition instituée par Georges au festival de 1980. Je participe par une communication sur le poète Ben Sghir, "une énigme" sur laquelle Georges avait enquêté à Essaouira pendant de nombreux étés.
Je vous écris sans accent; parce que le clavier n’en contient pas; mais aussi parce que je n’en n’ai pas pour raison d’émotion: au colloque sur le malhûn, tout le monde était stupéfié par la beauté céleste d’aurore de Ben Sghir que Georges avait aidé à exhumer et à traduire! Les autres intervenants qui ont utilise la "langue du malhûn" entaient inaudibles et sans voix parce qu’ ils ont parlé dans une langue morte et inusitée depuis longtemps: seuls les chanteuses lui rendent vie; arrivent à en communiquer le sens oublie: c est donc Georges qui avait rendu vie à Ben Sghir en le faisant traduire en une langue vivante et moderne comme le français! Il faut que les gens comprennent que les manuscrits du malhun _ que les khazzanes(leur conservateurs) tiennent jalousement dans leurs counnaches (cahiers dissimules dans de vieux coffres) sont les seuls inities capables d’en déchiffrer le sens: Georges avait donc aidé à faire parler un poème cosmique écrit dans une langue morte; lui qui est féru de Paul Valery : il était capable de me réciter de long poèmes de ce fiévreux penseur français tout le long de la plage...
C'était pourtant une recherche : recherche d'un poème perdu, "Lafjar", de Mohamed Ben Sghir, tout en sachant déjà que lorsque je l'aurais retrouvé, je serais incapable de le lire, de le traduire, de le comprendre. Plus j'avançais dans mon enquête, plus les portes se fermaient, plus les gens devenaient hostiles, plus ils mentaient et brouillaient les pistes. Et plus je devenais obsédé, par le fantôme de Ben Sghir : ce poème perdu me fascinait par son absence, par sa perte (alors qu'il se trouvait, mais je l'ai su trop tard, dans le coffre d'un antiquaire chez qui j'allais chaque jour pour le supplier de m'aider à recomposer ce poème perdu.)
Il y avait là quelque chose d'excessivement douloureux, comme une "obsession" au sens fait à ce mot par les théologiens de l'exorcisme. Cette douleur naissait de l'obsession elle-même, de ce fantôme de poète oublié qui me fait courir, dans l'hostilité grandissante de la ville ; j'aimais cette ville et je croyais en être aimé. Mais mon enquête me montrait jour après jour, qu'elle ne m'aimait pas, et qu'elle n'aimait pas non plus son passé, ses poètes. Tout cela lui était indifférent."
J'ai passé la nuit à errer, à rechercher avec angoisse ce Mohadmed Ben Sghir dont j'ignore tout. et voilà qu'aujourd'hui, qu'à peine sortie de mon errance, vous m'écrivez son nom !
J’ai maintenant les mêmes problèmes de traduction avec les chants des femmes(les haddarates) que jadis avec les chants oubliés du malhûn, mais je suis tellement content de retrouver en plus complets leurs chants de mariage dont j’avais recueilli des lambeaux à l’aube des années 1980; lors de ma première rencontre avec Georges où ce dernier m’avait embarqué à son enquête sur la "Parole d’Essaouira' (en tant que parole sociale s’entend). Je me rends compte maintenant à quel point mon enquête d’alors était larvaire; mais je suis content de voir a nouveau fonctionner le dispositif de recherche que Georges avait installe il y a déjà si longtemps. Non seulement cela, mais cette enquête ressuscitée m’a permis de retrouver vivace les souvenirs de Rbatia une amie de ma mère; morte il y a déjà fort longtemps - au milieu des années 1970- que j’aimais beaucoup et dont l’image me hante toute ma vie sans savoir pourquoi ? Or hier les haddarates m’ont appris que ce fut une des figures emblématiques qui ont émaillé leur histoire secrète et qu’en plus, elle était sage-femme. Je suis maintenant convaincu que c’est elle qui avait aidée ma mère à me mettre au monde! Elle était en fait ma seconde mère et je la chérissais pour cette raison sans le savoir...Cette en- quête s’est révélée comme une nouvelle naissance pour ma propre mémoire; une sorte de re-naissance de Rbatia; de ma mère; de Geeorges; mais aussi de ma mère nous apportons à moi et à Georges le thé et les gâteaux lorsqu’au salon de chez nous il m’aidait à mettre en forme mes contributions à son enquête.
Selon Rabiâ haïl, dont le grand père maternel, Ba-Zaïd, était le moqadem des Aïssaoua d’Essaouira dans les années 1950 :
« Rbatia était la grand-mère de toute la ville. Elle était à la fois sage-femme et moqadma de la zaouïa du Hadi Ben Aïssa. Au Mouloud, on y organisait un moussem où se retrouvaient les Aïssaoua et où étaient également conviés les Hamadcha.. Après le sacrifice, on offrait tête et tripes à la moqadma. Au troisième jour des festivités, arrivaient les haddarates. C’était la moqadma qui organisait la hadhra. »
Cette enquête s’est révélée comme une nouvelle naissance pour les" paroles oubliées d’Essaouira"...
Latifa Boumazzourh qui a maintenant 54 ans, se souvient encore, qu’à l’âge de quatre ou cinq ans, elle tenait le bendir recouvert de tissus de sa grand-mère , qu’elle accompagnait à la zaouïa des Aïssaoua où la hadhra se déroulait jusqu’à l’aube : elle me cite comme Haddara, entre autre la femme de Moulay Omar le célèbre hautboïste des Hamadcha, et Fatima Kit-kit, que j’ai connu au début des années quatre vingt lorsque j’enquêtais sur le chant des femmes, à l’instigation de Georges Lapassade. Elle résidait à derb adouar , une sombre impasse où elle m’avait récité ce chant de femmes :
Pourquoi je suis partie et pourquoi je revienne ?!
Que le chemin est long, les chameaux sont fatigué
Mais mes pas continuent à le parcourir...

Au plus profond de l’hiver, en cette période de la saison morte où les nuits sont les plus sombres et les plus longues, et où le froid de la boulda atteint les cœurs, Regraguia Benhila nous a quitté ce mardi 10 novembre 2009 sur la pointe des pieds, au milieu de cette arganeraie des hrarta aux environs d’Essaouira où elle s’est retirée ces dernières années pour vivre dans la dignité loin des regards et des incompréhensions. Loin d’une ville où les solidarités traditionnelles qu’elle y a connues dans sa jeunesse, n’existent plus.

La peinture de Benhila est d’une générosité exubérante. D’une grande fraîcheur. La fraîcheur du ciel et de la mer. Elle peint l’aube à la fois étrange et belle lorsque les brouillards de la nuit font danser la lumière du jour. C’est le monde qui renaît au bout du rêve. Elle peint le ciel de la fertilité quand le jour enfante la nuit :

« Au moment où la nuit pénètre dans le jour, dit-elle, je te jure au nom d’Allah tout puissant que je vois défiler tout l’univers. J’adore le ciel quand le soleil décline. Je vois les nuages qui se meuvent et j’imagine un autre monde au dessus de nous. Je vois dans le ciel comme des arbres, des oueds, des oiseaux, des animaux. Les labyrinthes que je peins sont comme les ruelles de la vieille médina : tu vas dans une direction mais tu aboutis à une autre. Je peins les chats qui rodent sur les terrasses. Les enfants qui jouent dans les ruelles étroites, les femmes voilées au haïk , leurs yeux qui sont les miroirs des hommes et notre « mère – poisson » qui est une nymphe très belle, une gazelle qui mugit de beauté avec ses cheveux balayant la terre. Je n ‘oublie pas l’île et les monuments, symboles d’une histoire révolue. Tout cela m’apparaît dans les nuages ou me revient dans les rêves. » Ses tableaux, elle les voit d’abord dans le spectre des couleurs qui illuminent le crépuscule au dessus de l’île et de la mer. Elle fixe ces projections poétiques dès qu’elles réapparaissent sur la toile blanche, dès qu’elle en saisit le bout du fil. Ce sont souvent des représentations symboliques du rêve, aux connotations très freudiennes :

« Quand je peins, je me sens malade comme une femme sur le point d’accoucher. Ça m’arrive à des moments de silence. L’enfantement est la seule sensation que je n’ai pas encore expérimentée. J’exprime l’idée du foutus dans ma peinture. Inconsciemment, je peins la matrice des femmes et leur état de grossesse. Je peins le diable que j’avais vu dans une forêt lorsque j’étais toute petite : j’arrachais avec mes dents le palmier nain dont j’aimais le cœur, quand il m’apparut sous la forme d’un chameau à cornes. Il était de très grande taille croisant les bras sur la poitrine. Il me regardait avec des yeux fissurés au milieu et qui louvoyaient dans tous les sens. Je m’éloignais en rampant sur mon ventre. Je rêvais souvent d’un chameau qui me poursuit. Il se transforme en une boule qui rebondit de colère jusqu’au ciel lorsque je me dérobe à sa vue. Je peins aussi le serpent, parce que, dans les temps anciens, les gens avaient peur du serpent. Les hommes étaient très beaux. Les serpents aussi. Mais, s’ils te foudroient, tu ne peux plus guérir. C’est le serpent de l’amour, car l’amour ressemble au venin. Mais je prie Allah pour que les cœurs des hommes soient aussi blancs que les colombes. »
La mer est peuplée d’esprits. C’est delà que provient Aïcha Kandicha, symbole démoniaque de la séduction féminine, que les hommes rejettent aussitôt dans le brouillard de l’oubli et des flots. Le dialogue avec la mer est zébré de craintes chimériques que l’artiste exprime sous la forme de la « mère - poisson » - sirène mugissante de beauté avec sa chevelure d’algues balayant la surface de l’océan – de piranhas et de monstres marins. Pour l’imaginaire traditionnel, l’océan est un cimetière où vient se jeter l’oued en crue avec ses cadavres de végétaux et d’animaux. Notre imaginaire n’aborde la mer, qu’en y ajoutant notre propre effroi, que véhiculait la procession carnavalesque de l’achoura La palette magique aux couleurs des jours finissants s’est retirée à l’intérieur des terres pour s’éteindre dans la dignité comme ces oiseaux qui se cachent pour mourir.

La qasida du Gnaoui

Lors de la soirée musicale, je découvre, la qasida du Gnaoui que je ne connaissais pas : Elle est ducheheïkh Thami Mdaghri (de Mdaghra au Sahara), qui a vécu( au 19ème siècle )de longues années à Fès et Marrakech : elle raconte l'histoire d'un Gnaoui à scarifications sur les joues qui tombe amoureux d’une gazelle et surtout qui tombe en transe par dépit amoureux La maladie d’amour comme possession par le bien-aimé auquel on aspire à s’unifier. Et pour le soigner, on fait appel entre autre à une voyante médiumnique !
Al harba (le refrain)
Ma bien-aimée me reproche mon état, sachant bien ce qui m’arrive
Mes joues sont scarifiées et les siens rayonnent
Elle me charme par son tempérament de feu et son grain de beauté.
Al qism al aoual( première partie) :
Qu’il est terrible le jour où les miens sont partis
Me laissant pleurant sur les ruines,
Que Dieu apaise les flammes de celui qu’abandonnent les siens
Ils ont décampé sur la trace des étoiles
Ah, si je pouvais accompagner le rubis scintillant de mille feux
Au désert mon cœur erre désormais seul derrière les mirages !
Perdu à jamais , s’il n’y avait ce tintement de cloche,
Ce chant, ces grands tambours et ces cymbales d’or !

Al qism al tâni (deuxième partie) :
Que ma désolation est grande, le jour où la caravane est partie
Derrière les lointaines rumeurs du désert
Le moindre bruit attise mes soupirs
Les gazelles errantes sont dispersées par le vent
Me trouvant perdu m’ont dit : « Qui es-tu ? »
« Esclave Gnaoui aux joues scarifiées sans remède pour son mal» leur dis-je
Sillons creusés sur mes joues, par le flot des larmes
Par amour, elles ont asservi , ma peau noire
A leur service, j’attiser les cendres éteintes
J’irrigue les champs assoiffés et j’ajuste la mesure
Je consolide l’encrage des tentes
Je redresse les étais de celles qui s’affalent
Elles se dirent alors : « Cet esclave est utile, pas si cher pour ce qu’il vaut »

Al qism al talet (troisième partie) :
Elles m’ont mis à prix en augmentant les enchères
Tirant au sort les bâtonnets sur le sable
Le mien a désigné une autre que celle que j’aime
J’en suis tombé en transe,
Ecumant par la bouche, sans prise sur mon état
Elles se dirent alors : « Celui-là est un possédé »
Al qism al rabiâ (quatrième partie) :
Ma maîtresse m’a rapproché d’elle
M’encensant de benjoin et de bois de cantal
C’est alors que le melk qui me possède s’adressa à elle
« Pour qu’il guérisse, il faut un sacrifice » lui dit-il.
Lui conseillant une voyante ou un homme-médecine
Ou encore un devin prescrivant les écritures
A elle mes secrets se dévoilèrent
Souriante, sur moi elle exhala son musc
Que Dieu me fasse de son parfum délivrance
Al qism al khamis (cinquième partie) :
A cause d’elle, j’ai oublié tout ce que j’ai appris
Et quand j’ai retrouvé mes esprits, elle l’a à nouveau ensorcelé
J’en suis tombé malade et rien ne peut m’en guérir
Le poète du malhûn était souvent considéré comme un mejdoub, et les connaisseurs du melhûn sont ses « adeptes », dans le sens où ils n’ont pas un simple rapport esthétique avec cette poésie, mais un rapport mystique proche de la possession rituelle. C’est une poésie ritualisée, me disait Abdelkébir Khatibi, qui considère Sidi Abderrahman el-Majdoub comme le meilleurs poète marocain jusqu’à maintenant. Vagabond mystique et poète, el – Mejdoub a vécu au XVIe siècle dans le Gharb. Ses pouvoirs magiques ainsi que ses quatrains, souvent caustiques, le rendirent célèbre. Parmi ses célèbres quatrains celui où il prédisait l’engloutissement de la ville sous le déluge:

Hucein Miloudi
Un vendredi ou un jour de fête,
Marrakech est un tagine brûlant,
Fès, une coupe transparente.... »
En guise de commentaire à ce quatrain, un pèlerin tourneur du printemps m’a dit un jour : « On raconte que le Mejdoub était fou. Mais tout ce qu’il disait arrivait. L’œil verra ce que l’oreille entend. On raconte qu’il était fou, mais il voyait avec « l’œil du cœur ». L’œil – la vision du Majdoub – n’est pas simple regard ; il est « l’œil du monde », comme disait Schopenhauer : « le pur connaître »...Il pratiquait donc la voyance en état de transe !
Le 31 août 1983, je participe pour la première fois au moussem des hamadcha, en tenant sur les conseils de Georges Lapassade, un journal de route où je découvre en la décrivant la transe et ses adjuvants rituels. Le soir j’accompagnais ârabi ,le tambourinaire noir au yeux exorbitants en notant ceci à propos de leur adjuvent rituel :
Hamdouchi, tourneur sur bois de son état, rencontré à Sidi Mogdoul, me dit en préparant sa pipe de kif : « Tout ce qui brûle au feu n’est pas impur. Jadis, on cachait le kif dans le tambour. Le moqadem disait : « Fumez où bon vous semble, sauf dans la salle de prière. »Nous gens du hal, nous avons besoin de fumer jusqu’à ce que nos yeux soient hors des orbites pour pouvoir chanter et faire monter le saken (l’habitant surnaturel) ».
Et c’est en ces termes que je décrivais les scènes de transe :
Pour la première fois des gens du public tombent en transe. Un jeune homme de 18 ans perd le contrôle de ses gestes. Une autre jeune fille se roule par terre en pleurant. Elle retire son peignoir que prend sa sœur qui l’accompagne et qui paraît plus étonnée d’être parmi les hommes que de l’état de sa sœur. Un boucher me dit plus tard que la possession de cette fille cessera avec le mariage. Le public l’observe avec sympathie et compréhension. Non pas en tant que cas pathologique, mais en tant que personne en contact avec le surnaturel. La jeune fille s’effondre dès que la musique cesse. Le public se précipite autour d’elle. Dakki, le jeune hautboïste d’Essaouira leur dit :
« Eloignez-vous, elle n’a rien, c’est seulement le hal, apportez le brasero et l’encens… »
.Après avoir respiré ce parfum, elle sort de sa transe et va se reposer.
En participant à ce moussem, j’ai rêvé moi-même que je suis tombé en transe. En le rapportant le lendemain à Georges Lapassade, il me dit : « Tu résistes à la transe en état de veille parce que tu es occidentalisé, mais au sommeil tu cèdes à ta culture profonde qui est fondée sur le hal. » .
Dans le langage populaire marocain, la transe se dit hal , c’est à dire l’état de celui qui est « saisi » qui est « possédé » par les esprits et qui tombe en transe pour cette raison. Un chant de la confrérie des Ghazaoua évoque le hal en ces termes :
Le hal, le hal, Ô ceux qui connaissent le hal !
Le hal qui me fait trembler !
Celui que le hal ne fait pas trembler, je vous annonce ;
Ô homme ! Que sa tête est encore vide
Ses ailes n’ont pas de plumes
Et sa maison n’a pas d’enceinte
Son jardin n’a pas de palmier
Celui qui est parfait, la calomnie ne l’effleure pas
Sidi Ahmed Ben Ali le wali
Prends-nous en charge, Ô notre cheikh !
Sidi Ahmed et Sidi Mohamed
Ayez pitié de nous. »
Le hal est cette énergie supérieure qui dictent aux Gnaoua en état de transe le choix de telle ou telle couleur, et qui dictaient à Sidi Abderahman el- Mejdoub en extase ses fameux quatrains. Le « Mejdoub », est celui qui est possédé par le hal.Et lors de ses séjours à Essaouira, Georges Lapassade aimait souvent se rendre à ce borj el baroud lieu de ralliement du mouvement hippie dans le sillage duquel il avait découvert pour la première fois Essaouira en 1968 avec le Living Théâtre :
 « 19 h 30. La sirène du ramadan a hurlé, ce soir pour la première fois. Il fait presque nuit. Tristesse maintenant sur la ville déserte. Je retrouve l’angoisse de l’année dernière. Les lumières de la rue s’allument lentement....Le soleil s’est levé tard ce matin. Il faisait froid, un petit vent mauvais courait sur la plage, au ras du sable, jusqu’aux grandes dunes qui entourent, là-bas, le borj el baroud. Il m’a semblé tout à l’heure que j’allais enfin me décider à écrire le récit chronologique de mon enfance, puis de ma jeunesse, jusqu’à mon départ définitif d’Arbus et mon installation à Paris. J’ai cru que j’avais retrouver le courage nécessaire pour me lever à des heures fixes et travailler. J’étais convaincu que ce moment tant attendu était enfin arrivé, après une longue attente. La chaleur de l’été est enfin revenue. J’ai retrouvé ma chambre d’autrefois inondée de soleil tout le jour. Je peux contempler le mouvement incessant des bateaux dans la baie, et dans le port. Hier j’avais décidé d’écrire le récit de mon enfance. Mais je ne trouve que des bribes de souvenirs. Je ne sais comment les souvenirs arrivent à ce moment-là, ni pourquoi tel souvenir plutôt que tel autre...La journée sera chaude comme hier, j’irai à la plage, je marcherai jusqu’au borj el baroud, j’irai m’étendre dans les dunes. Je reprends goût à la vie. Je n’ai plus envie de travailler, je dois faire un assez grand effort pour écrire seulement quelques lignes chaque jour. »
« 19 h 30. La sirène du ramadan a hurlé, ce soir pour la première fois. Il fait presque nuit. Tristesse maintenant sur la ville déserte. Je retrouve l’angoisse de l’année dernière. Les lumières de la rue s’allument lentement....Le soleil s’est levé tard ce matin. Il faisait froid, un petit vent mauvais courait sur la plage, au ras du sable, jusqu’aux grandes dunes qui entourent, là-bas, le borj el baroud. Il m’a semblé tout à l’heure que j’allais enfin me décider à écrire le récit chronologique de mon enfance, puis de ma jeunesse, jusqu’à mon départ définitif d’Arbus et mon installation à Paris. J’ai cru que j’avais retrouver le courage nécessaire pour me lever à des heures fixes et travailler. J’étais convaincu que ce moment tant attendu était enfin arrivé, après une longue attente. La chaleur de l’été est enfin revenue. J’ai retrouvé ma chambre d’autrefois inondée de soleil tout le jour. Je peux contempler le mouvement incessant des bateaux dans la baie, et dans le port. Hier j’avais décidé d’écrire le récit de mon enfance. Mais je ne trouve que des bribes de souvenirs. Je ne sais comment les souvenirs arrivent à ce moment-là, ni pourquoi tel souvenir plutôt que tel autre...La journée sera chaude comme hier, j’irai à la plage, je marcherai jusqu’au borj el baroud, j’irai m’étendre dans les dunes. Je reprends goût à la vie. Je n’ai plus envie de travailler, je dois faire un assez grand effort pour écrire seulement quelques lignes chaque jour. »
De cette période hippie où Georges Lapassade,encore dans la force de l’âge est arrivé à Essaouira avec sa pipe et ses fréquentations assidues à Bijou-bar, restent des réminiscences : « L’autre jour, j’avais fumé un peu d’herbe, assez pour ne pas tenir debout tout à fait. Je me suis allongé sur une banquette au café hippie, et Majid, qu’ils appellent Speed, m’a interpellé ; je l’ai regardé, et j’ai vu en même temps, sous le masque de son rire, un autre visage, plus sombre, fermé, immensément triste, comme on voit chez les Grecs, le masque des rires avec le masque des pleurs. Et cet autre visage qui est toujours derrière les mouvements de la vie, c’est déjà, j’en suis persuadé, le visage de notre mort.
Ph.Abdelmajid Mana
- Et si tu mourrais maintenant, dit Mourad. Si tu devais dire ce que tu regrettes de n’avoir pas fait dans ta vie, qu’est-ce que tu pourrais répondre ?
J’ai répondu que je n’avais pas de réponse. J’en avais une pourtant : que mon seul regret serait d’avoir manqué ma vie à force de penser à la mort, de n’avoir pas vécu chaque instant de ma vie comme un moment possible de bonheur. »
Pourtant nous avons connu des moments de bonheur, au printemps des Regraga, lors de nos dérives communes à la vallée d’Aïn Lahjar (la source de pierre). C’est là qu’on avait découvert ensemble, lui et moi, « la fiancée pétrifiée » du Sahel, et le concept de faïd comme débordement de l’eau et de la baraka. Un jour on est même partis ensemble, en autocar jusqu’à la vallée heureuse de Tlit, entre le mont Tama et le mont Amsiten, en pays Haha, pour enquêter sur le chant des moissonneurs. Mon oncle maternel nous reçu alors avec le cérémoniel du thé, avec des amandes, et des galettes de seigle, à tremper dans l’huile d’argan et le miel de thym . Mon oncle maternel disait alors à ce Béarnais que je croyais parisien et qui a toujours gardé une âme paysanne lui venant de son enfance passée dans ces « Pyrénées-Atlantiques », comme on les appelle si joliment en France. Mon oncle donc disait à Georges:
« Le poète et la hotte sont semblables, personne n’en veut
s’il n’y a pas de pluie et donc de récolte. ».
Et Georges qui avait aidé jadis son père à la scierie dans la forêt béarnaise comprenait parfaitement ce langage et en avait même la nostalgie. En lisant maintenant son Autobiographe, je comprends à quel point son intérêt pour notre culture était sincère, car tant d’affinités électives reliaient secrètement les traits culturels de son Béarn natal au mouillage d’Amogdoul où chaque été il jetait l’ancre pour écrire : « Dans le temps du carnaval, entre le premier de l’an et Mardi-gras, nous allions danser chaque dimanche dans le quiller de l’estanguet, sur la terre battue. Les musiciens s’installaient sur un petit balcon de planches, pour jouer des marches et des javas, avec quelques guigues et quelques sauts basques. D’autres souvenirs reviennent : le jardin de l’école, les grilles rouillées du portail. Un phono avec des disques ébréchés dans un placard. Ce vieux phonographe, posé sur une petite table dans la salle à manger de ma grand-mère, remplaçait un phonographe plus ancien muni d’un grand haut-parleur en entonnoir qui traînait dans le grenier au milieu des toiles d’araignées. »
De là, me semble-t-il, sa passion pour le carnaval d’Essaouira, cette compétition chantée, ce charivari, qui opposait jadis, à chaque Nouvel An, les deux clans de la ville et surtout le couplet du rzoun de l’Achoura relatif au phonographe :
« Permettez-moi donc d’avouer
Les soucis qui m’oppressent
Et si je meurs, que personne ne me pleure
Mais quel est votre chef ô Chebanate ?
Osman à la tête bossue
Et à la bedaine serrée d’une cordelette ?
Et qui est votre chef Ô Béni Antar ?
Ali Warsas traînant au port son chien
Éternellement sur son âne ?
Pourquoi donc avez-vous remplacé,
Les chanteurs du malhoun par le phonographe ? »
Georges Lapassade et maâlem Omar Hayat en 1979
C’est lui qui, le premier, par ses nombreux articles, avait vulgarisé l’idée selon laquelle « Essaouira est la ville des Gnaoua ». Il avait longtemps enquêté sur leurs rites de possession, sur ceux des gens de l’ombre, ces Hamadcha et ces Aïssaoua, ces musique sacrées auxquelles on avait consacré tout le colloque du premier festival et dont les actes ont été publiés dans le deuxième numéro de la revue Transit de Paris-VIII, tandis que le premier numéro avait été consacré aux chants profanes intitulés Paroles d’Essaouira.
A la veille de sa mort survenue au printemps de l’année 2007, le sculpteur et luthiste Mohamed Bouada, m’avait appelé pour me dire en guise d’adieu, qu’il se portait très mal. La communication était courte mais poignante. Et voilà ce qu’il me disait à la fin des années 1980, à propos de son expérience artistique de la sculpture et de la peinture :« Au début, c’était un peu le dessin fantasmagorique. J’ai cherché à m’exprimer par la peinture aussi, mais il m’a fallu trouver autre chose que cette expression commune. Alors, j’ai opté pour la sculpture, cette dimension qui change selon l’espace où elle est posée : c’est un espace dans l’espace environnant. Une pièce, quand tu la poses entre deux murs, ne s’efface pas, mais tu la sens autrement que quand elle est posée dans un espace ouvert : elle est comme une sonorité, sa résonance s’étend en fonction du clos et de l’ouvert. Fils des arcades, la main de l’artisan graveur m’inspire. Musicien, comment oserais-je dire que j’interprète la musique en la gravant dans la pierre ? Mais il y a toujours un rythme, un harmonique des formes communes à la musique et à la sculpture. Elles sont en ronde-bosse et en bas-reliefs avec des courbes entre le plein et le vide. Je ne travaille ni les lignes ni les ongles droits. L’exploitation de mon espace reste une courbe douce comme une coulée, c’est presque une vague volcanique avec des ondulations et des vagues océaniques. Il y a eu la main de l’artisan qui m’a révélé le grès, qui est au fondement géologique de notre ville, une roche vivante qui soutient le site flottant, citadelle des condamnés à la rêverie inspiratrice, au rythme des vagues. Elle est constamment prise entre l’érosion des embruns et des flots, vouée à la reconstitution des alluvions et des algues. Mes empreintes rejoignent ainsi la forte sensation du flux et du reflux éternel ».
Quand on s’éloigne d’Essaouira, c’est toujours sous forme de mouette qu’on la retrouve ! Leur envol au crépuscule, leur envol au ras des vagues et au-dessus des mâts, sont la réincarnation des légendes et des mythologies marines , comme le souligne si bien Moubarek Raji, le jeune poète arabophone contemporain de la ville :
« Les mouettes sont des vagues qui prennent leur envol
Et les vagues, des mouettes qui grondent
Quand on brise une vague
Une aile vous pénètre profondément
Et quand on brise une aile
Une vague vous pénètre profondément
Ecoutez les trois mouettes briser leurs oeufs
Comme si la mer surgissait du sable pour la première fois
Avec comme notes musicales : l’éclosion d’œufs de mouettes »
Pour ce poète comme pour le magicien de la terre qu’était Boujamaâ Lakhdar, une mouette n’est pas une mouette, elle est pour l’artiste peintre le symbole même de la ville. Le dernier tableau peint par Boujamaâ Lakhdar, avant sa disparition en 1989, représentait une mouette fantastique portant sur ses ailes les signes et les symboles magiques de la ville. Georges Lapassade était l’une des figures emblématiques de la ville, l’un de ses principaux auteurs, son regard fut un limpide miroir pour la mémoire de la ville. Un de ces oiseaux marins au regard perçant survolant les rivages de pourpre. C’est toujours sous la forme d’une mouette que nous rendent visite nos chers disparus.

Café - Théâtre Mogador
Le dramaturge Tayeb Saddiki
Ce vendredi 29 octobre 2010, au moment - même où se déroule à Essaouira le festival des Andalousies Atlantiques, où je ne suis convié ni moi ni Tayeb Saddiki, je me rends à Casablanca au café théâtre Mogador pour y assister à l’hommage au comédien Salamat, compagnon de route de Taîb Saddiki depuis près de quarante ans. J’y arrive en début de soirée, une demi heure à l’avance. Le jeune fils du dramaturge, me dit que son père ne tardera pas d’arriver. Tout autour des montages photos qui retracent la carrière théâtrale de l’artiste ainsi que de vieux costumes dont il s’est servi pour ses pièces successives. Comme la revue Horizon Maghrébin m’a interrogée sur le premier festival d’Essaouira « la musique d’abord », j’ai pensé interroger son instigateur au début des années 1980. Il arrive enfin , habillé d’une djellaba du vendredi, entouré d’une nuée de journalistes et d’admirateur. Je me porte au devant de lui en lui disant :
- Je prépare un article sur toi pour Horizons Maghrébins.
- C’est ce qu’on appelle une menace ! Twahachtak, (tu me manques). Il y a un âge où on connaît plus de morts que de vivants…
- C’est terrible !
- Quoi ? C’est normal. C’est la vie.
Une fois installé à table à gauche de la scène, il me demande :
- D’où vient le mot tableau ? C’est le mari de la table !
Je l’interroge alors sur ses souvenirs du premier festival d’Essaouira en 1980 :
- C’est à cette occasion que vous avez présenté pour la première fois iqad sarira fi tarikh saouira (lumière sur l’histoire d’Essaouira), en tant que pièce de théâtre à souk laghzel (le marché de la laine, plus précisément « le souk des quenouilles ») ?
-D’abord, il fallait faire ce festival me dit-il. Natif d’Essaouira, je me dois de rendre hommage à ma ville natale.Comme nous sommes une famille d'artistes mogadoriens : mon père a écrit sur l’histoire d’Essaouira, Azizi mon frère l’a adapté, Saddik et Maria se sont occupés des décors et des costumes. Un jour quelqu’un est venu demander à Azizi de lui traduire un texte qu’il a trouvé mauvais : « Ce texte, lui dit-il, on ne peut le traduire qu’en justice ! »
- Vous étiez né à Essaouira en 1938…
- J’ai quitté Essaouira à l’âge de sept ans. La moitié de la population était juive. On parlait hébreux sans faire de différence avec l’arabe.A Essaouira, on parlait l’Arabe, le Français et l’hébreux Pourquoi je parle l’hébreux ? Parce que je respecte le dicton qui dit : « Il ne faut jamais mettre la charrue devant l’hébreux ! » J’ai eu la chance d’apprendre le Grec et le Latin. C’est pourquoi, j’en suis devenu un obsédé textuel ! Quelle est la capitale la plus virile du monde ? Dakar ! Le mot « photographie » vient de « Photo » qui signifie lumière et « graphie » , « écriture » : c’est écrire avec la lumière…
- En 1980, vous êtes donc revenu à Essaouira pour y organiser son premier festival que vous avez intitulé « La musique d’abord »…
- Car la vie sans musique serait d’une grande tristesse. J’ai ouvert tout le théâtre en pleine aire. La ville se prête merveilleusement à la mise en scène théâtrale avec ses différentes places qui constituent autant d’endroits de spectacles : « La musique d’abord », le théâtre vient après même si je suis moi-même un homme de théâtre.
Ville - spectacle , Essaouira se prête, en effet, merveilleusement à la mise en scène avec ses différentes places intra muros : marché au grains, marché de la laine, Joutia (place de la criée), place de l’horloge, chemin de ronde de la Scala de la mer, son immense baie dévolue à la fantasia régionale….Contrairement à une ville éclatée comme Safi où il fallait toute une logistique de transport pour les musiciens où tout était éloigné du cœur palpitant du festival au château de Mer, à Sidi Boudhab et à la colline des potiers.
A Essaouira les différentes manifestations du festival étaient réunies pour ainsi dire dans un mouchoir par la structure même de la ville : c’est au cœur de la médina que se déroulaient l’essentielle des manifestations : nuits bleues des Gnaoua à la Joutia, celles des Hamadcha , au marché aux grains, Ahouach d’Imine Tanoute et du pays Haha sur la Scala de la mer, le folklore portugais, celui de Bretagne ainsi que les derviches tourneurs de Turquie, à la place de l’horloge….C'est au cours de ce premier festival qu'eut lieu le premier colloque de musicologie que dirigeait Georges Lapassade, à l'origine de l'enquête ethnographique intitulée "Paroles d'Essaouira" et plus tard de la série documentaire "la musique dans la vie", que l'auteur de ces lignes supervisa pour le compte de la deuxième chaîne marocaine durant pratiquement onze années(de 1997 à 2008).
Mais ce qui distingue incontestablement ce premiers festival, c’est la participation de tous, ce qui explique tout le mouvement culturel et artistique qu’il avait induit durant les années 1980. Les festivals qui viendront ensuite auront un caractère plus officiel et seront surtout entièrement extravertis : les boites de communications de Casablanca, de Rabat et d’ailleurs se chargeront désormais à livrer des festivals clés en main, qui se déroulent le week end. Mais une fois les lampions éteints ils ne laissent aucun effet d’entraînement culturel au niveau local. A force d’être exclus les acteurs culturels ont fini par quitter la scène locale…C'est une politique qui a fini par momifier culturellement la ville, en la maintenant dans un rôle passif de simple receptacle de spectacles...
Autant en emporte le vent

Le soir même du samedi où la télévision devait transmettre en direct d’Essaouira son show musical j’y ai fait un saut[1]. Les musiciens de la ville m’ont parlé d’une seconde mort de Ben Sghir, le poète du malhûn de la ville. On m’a dit que Souhoum, grande autorité en la matière a supprimé la qasida de la « chamaâ » de Ben Sghir qui était prévue au programme. C’était une flamme qui s’était éteinte. D’autres ont invoqué le facteur temps pour expliquer cette suppression. Je me suis rendu compte du manque de culture de ces musiciens de la ville qui ne connaissent ni Ben Sghir ni son aurore (Lafjar). Ce qui les intéresse c’est d’apparaître à la télévision. Ils ont une vision commerciale de la culture. Ils n’ont pas l’amour du Malhûn comme l’ancienne génération qui vivait au temps où il n’y avait ni phonographe ni télévision comme le chantait le Rzoun de l’Achoura :
Pourquoi donc avez-vous remplacé,
Les chanteurs du malhûn par le phonographe ?
Nous avons demandé à M. Souhoum pourquoi il a supprimé le melhûn souiri du programme ? Et voilà ce qu’il nous a répondu :
- Le chanteur qui devait présenter la qasida a une voix faible : nous voulons ressusciter Ben Sghir, faire revivre le patrimoine mais sur la base de règles saines et de belles voix.
Khalili, un chanteur du malhûn local réplique :
-Essaouira, n’est pas seulement un simple entrepôt, c’est aussi une ville de culture qui a connu en son temps le malhûn. La raison qu’invoque Souhoum concernant la mauvaise voix du chanteur, ne justifie pas la suppression de la qasida. De toute manière, c’est au public de juger.

On veut faire connaître les provinces à travers la télévision, mais on étouffe la culture locale. On a finalement assisté à un show de variétés nationales avec les vedettes habituelles, mises en scène par le charqi (vents alizés) : le vent qui balaie les odeurs semblait balayer ce soir la mauvaise musique. Une soirée surréaliste, avec des images abstraites qui défilent de temps en temps sur l’écran, et quand c’est au pire on montre le lorgnon dela Scala. Si on veut présenter un défilé de variétés, ce n’est pas la peine de les déplacer à Essaouira ; ils seraient mieux dans un bon studio à Rabat. Jusqu’à 23 h 10, toujours pas de culture régionale.
On critiquait le vent d’Essaouira et maintenant, on s’en réjouit parce qu’il est devenu le vent de la critique qui balaie ce qu’il ne lui convient pas, c’est-à-dire ce qui échappe à sa culture. De même que le vent d’Essaouira n’existe que dans le microclimat d’Essaouira, sa présence frondeuse était la manifestation permanente de l’âme de la ville. Comme une sorte d’ironie permanente, de moquerie, un téléspectateur de la ville me dit en montrant la chanteuse étoilée avec le diadème de perles : « celle-là, vient du mellah ! »
Dans la ville, certains disent que Sidi Wâsmîn, dans sa sainte colère, faisait trembler le djbel Hadid pour secouer le pilon de la télévision, empêchait la transmission de la soirée. Cela donnait un spectacle étonnant sur le petit écran : les chants de nos vedettes nationales, cheveux au vent, étaient constamment entrecoupés de formes abstraites, de zébrures, et autres désordres. Puis réapparaît le lorgnon fixe dela Scala.
Mohamed El Idrissi nous chanta deux longues chansons dont l’une s’intitule : Mazal al hal(encore le temps). Le chanteur crispé sur scène, se voûtait sur son luth, chantant des paroles insipides, comme un défi lancé par l’ignorance des métropoles à la culture profonde du pays. On attendait l’Aïta des Chiadma et l’Amerg des Haha comme trésor culturel des plaines enserrées entre la montagne et l’océan. On ne soulignera jamais assez la beauté intense des vieux chants populaire de notre patrimoine.
Au lieu de faire apprécier le Rzoun plein de trouvailles poétiques, on nous déversa ce qu’il y a de plus plat dans le menu quotidien de la télévision. Quand on voit miauler et racler les violons orientaux ils font durement regretter le kamandja de Badenni chantant à khobbaza son éternel refrain :
« L’amour, l’amour,
C’est pour toujours ».
Quelqu’un me réplique :
- Mais non, Idrissi est très bon, et Badenni n’est qu’un sauvage du Mellah.
Grâce à Nass el Ghiwane, l’ambiance musicale change complètement. Tout a en effet changé vers minuit avec l’arrivée des jeunes Ahouach . Sidi Wasmin était très content dans sa montagne. Il arrêta le vent. Lalla Beit Allah tendit l’oreille à une musique aussi belle. Enfin, le décore est devenu sobre : on dirait que les cadreurs ont changé de regard ; ils ont retrouvé le port. On retrouve enfin Essaouira et sa musique. Mais les Hamadcha et les Gnaouafurent vite expédiés du plateau de la télévision.
La télévision a un pouvoir hégémonique fondé sur la technique. Je quitte l’écran pour aller au port. La ville est vide. Tout le monde est devant son écran. Enfin, on voit le port autrement que ce qu’à la télévision . L’œil de verre de la télévision impose sa vision des choses. Elle produit la nouvelle culture de masse, avec une « écurie » de chanteurs et chanteuses. La télévision se livre à un travail d’homogénéisation en éliminant les particularités locales, en imposant un système de valeur aseptisé et médiocre. À Essaouira comme partout, c’est la télévision en tant que monstre machinique qui a pris le pouvoir.
Le metteur en scène, expédiant rapidement les Gnaoua et les Hamadcha du plateau, les traite comme des sauvages . La culture pour eux, ce sont les permanents de la télévision. Ils sont à la remorque d’une égyptianisation que le mouvement folk des années soixante-dix n’a pas réussi à exorciser. Le pouvoir médiatique a tendance à figer la réalité en la momifiant. La télévision unifie la diversité des cultures locales en la gommant et en la folklorisant. La folklorisation est une muséification de la vie. Comme dans un musée, on a une espèce d’épouvantail à moineaux à la place d’un être vivant qui portait un costume au passé. De la même manière la musique locale est dévitalisée.
La méconnaissance des fonctionnaires déracinés des médias, à la fois du cadre et des acteurs de la culture locale conduit à une présentation décolorée et sans attrait du produit local. On expédie lesHamadcha en une minute, comme si on montrait dans une foire agricole une rondelle de saucisson à déguster. Pour eux, vu de Rabat, Essaouira est un petit patelin perdu avec des nègres qui font du tapage nocturne à l’aide de tambours et de castagnettes en fer. Ils opposent leurs violons monotones qui font regretter le Ribab des Raïs de la montagne. On retrouve là, la problématique soulevée au colloque de Taroudant sur le statut de la culture populaire où l’on a vu des clercs énoncer quelques énormités du genre : « Les chikhates et compagnie, ce n’est pas de la culture ».

La télévision crée un nouveau système culturel : une standardisation de la culture, une vedettarisation des acteurs et des chanteurs et un regard médiatisé. Exemple : au port, le beau décor était fait pour être fixé par l’œil de la caméra, pour des plans de coupe et non pour être regardé par les gens au port. La télévision domestique le réel. Elle l’ajuste aux exigences du récepteur. Et alors, ce qui ne rentre pas dans ce cadre est éliminé. Surtout la culture populaire qui est un spectacle total, qui n’est pas fait pour être directement appréhendé par la télévision.
La culture populaire doit être consommée sur place et sans médiation. Elle passe mal à la télévision, même modernisée comme le folk. Les cadreurs sont entraînés à prendre et à faire ressortir sur l’écran, les violons d’un orchestre de la Radio TélévisionMarocaine. Alors qu’ils ne mettent pas en valeur ces instruments populaires. Une musique rituelle est massacrée par la télévision, parce qu’elle ne supporte pas d’être mise en scène par les autres, qu’il lui faut du temps pour faire monter le hal (transe). Le temps du rituel est cosmique, mesuré par les astres et non par les horloges. Mais le temps de la télévision est chronométré. On donne une minute aux Hamadchaqui ont l’habitude de créer un climat par une lente progression.
Un Souhoum expert en culture populaire est venu spécialement pour commenter ce spectacle, selon le projet de mise en valeur des cultures régionales, est lui-même éliminé avec sa verve au bénéfice dune starlette télégénique et stéréotypée, rodée à l’art de présenter les spectacles de variétés à la télévision. Cette série d’émissions voulait en principe valoriser les pratiques culturelles et musicales localisées. Mais tout cela est déclassé par un même spectacle de variétés qui se déplace d’une ville à l’autre. La part du lion revient ainsi fatalement à « l’écurie musicale » de la télévision.

Dans le port, samedi soir, certains spectateurs tournaient le dos à la scène pour regarder l’écran d’une télévision placée pour le contrôle. Ils regardaient alors et avant tout la « télévision ». Comme le dit McLuhan : « le message, c’est le médium ». Ce n’est pas le contenu du petit écran lui-même, en tant qu’il a capté et digéré l’événement. Tout devient spectacle télévisé contemplé par l’œil tyrannique de la caméra, qui vous impose son regard. On voit désormais les choses à travers l’œil de la télévision.
À Safi, pendant le festival, j’ai vu un halaqi sur une place populaire racontant les événements du jour. À un moment donné, il nous a dit :
- Maintenant, j’ai fini ma journée, je vais rentrer chez moi dire à ma femme de préparer le thé et regarder tranquillement les gens qui se tuent à la télévision.
Il nous a confessé ensuite que, naturellement, il était trop pauvre pour avoir la télévision et que, s’il l’avait, il ne serait pas sur cette place à nous proposer son beau spectacle. Quand tout le monde aura la télévision, il n’y aura plus de halaqi, et bien sûr, plus de halqa.
[1] Le lundi 8 septembre 1986, je publie dans Maroc-Soir cet article intitulé « Autant en emporte le vent » à propos d’une soirée télévisée en direct d’Essaouira.
Les nuits bleues de Sidi Boudhab
Autant que faire se peut, Georges Lapassade pratiquait de l’observation participante auprès de ces confréries de la transe. Il provoquait même des « nuits bleues » pour contribuer à les observer, comme ce fut le cas pour les nuits bleues des Gnaoua à Essaouira(festival de 1980-1982) et au premier festival de Safi(1983), avec les nuits bleues de Sidi Boudhab (le marabout de l’or)..Cette animation était comme un dispositif de visibilité selon l’expression des ethno-méthodologues ou encore un analyseur culturel. Pour comprendre la culture de Safi, il fallait l’organiser, y participer. Dans l’entretien paru par la suite à Maroc-Soir du lundi 1er septembre 1986, Georges Lapassade faisait le bilan de cette expérience en ces termes :

Georges Lapassade et Gianni de Martino devant la zaouia des Hamadcha, sis rue Ibn Khaldoune
Maroc soir. – Il semble que vous avez joué un rôle imporant de conseiller dans la définition du 1erfestival de Safi. Comment l’avez-vous envisagé ?
Georges Lapassade. – J’avais en tête, plusieurs modèles de festivals déjà existants comme ceux d’Asilah-Safir en 1978, d’Essaouira en 1980. L’idée générale était la mise en scène de la ville comme on l’a tenté en son temps à Essaouira. Cela suppose un dispositif permanent d’animation éclatée, de manière à faire bénéficier du festival, tous les quartiers de la cité. On est même allé plus loin en organisant une annexe du festival quasi-autonaume, pour le village de vacances à Souira Kdima et une autre à Youssoufia. Un autre principe était de mettre en valeur la culture populaire locale et régionale, ce qui nous a conduit à enquêter sur cette culture, à rencontrer beaucoup de Halaki sur les places de la ville, ainsi que les acrobates de Sidi Hmad Ou Moussa, dont certains habitent à l’entrée de Safi. Ainsi que les Jilala, les Ouled Bouchta Regragui, les Hmadcha, les Aïssaoua de Safi, qui sont d’une grande qualité musicale dans le Dikr et tous les groupes des Gnaoua. Le modèle souiri du festival, implique plusieurs activités complémentaires : la musique,la danse, le théâtre, le colloque, le cinéma et le journal du festival.
Maroc soir. – Mais ce modèle souiri, pouvait-il s’appliquer à Safi ?
Georges Lapassade. – Oui et non. Formellement oui. Car il est assez facile d’installer des lieux de spectacle un peu partout, d’organiser un colloque, ou même de tirer un journal du festival. Mais Safi n’est pas Essaouira. Par exemple, il fallait à Safi, une organisation assez complexe de transport pour déplacer continuellement les troupes d’un quartier à l’autre et jusqu’à la plage lointaine de Souira Kdima. L’essence de la culture de Safi n’est pas celle d’Essaouira. Chaque ville a ses pratiques culturelles localisées.Ainsi celle d’Essaouira est plutôt mystique avec un rôle dominant de la musique des confréries. A Safi par contre, c’est l’Aïta qui domine dans la culture populaire etla Halkay est plus forte. On s’en est bien rendu compte, quand on a voulu installer à Sidi Boudhab (le seigneur de l’or) des nuits de musiques confrériques avec Gnaoua, Hmadcha et Aïssaoua sur le modèle de ce qui avait fait la partie belle du festival d’Essaouira.
Maroc soir. – Qu’est-ce qui s’est passé à Sidi Boudhab ?
Georges Lapassade. – Une expérience assez étonnante et qui vaut la peine d’être racontée. Nous avons obtenu, non sans peine dela Directiondu Festival, qu’on organise chaque soir à Sidi Boudhab, à l’entrée de la vieille médina, après le spectacle donné dans le château de la mer, une nuit confrérique. Et très vite les difficultés se sont accumulées : on devait chaque soir, avec Abdelkader Mana, qui était invité au colloque, mais qui était avant tout militant de la culture populaire, on devait dis-je chaque soir balayer les poissons pourris qui jonchent la place que protège le marabout. Ensuite, nous devions transporter des nattes avec l’espoir que les gens viendraient s’asseoir selon la tradition de la lila. Hélas, le premier soir, la place était envahie dans une énorme confusion par les curieux. Mais nous n’avions pas à les faire asseoir. Nous avions oublié que Sidi Boudhab à Safi, est avant tout un haut lieu dela Halka, y compris celle des Gnaoua. Et les gens de Safi ne pouvaient pas comprendre immédiatement que les mêmes Gnaoua venaient maintenant à minuit pour tenter d’y instituer le rituel dela Derdebaavec ses transes et ses danses de possession. C’est seulement à la fin du festival, comme par miracle que les jeunes de la médina ont compris le projet et l’ont soutenu. Une immense Jedba animée par les Hmadcha s’est installée vers minuit sur la place de Sidi Boudhab.
Maroc soir. – Quelles conclusions avez-vous tirées de cette expérience ?
Georges Lapassade. – J’ai appris beaucoup dans cette affaire de Sidi Boudhab. Il m’a semblé que cette animation était comme un dispositif de visibilité selon l’expression des ethno-méthodologues ou encore un analyseur culturel. Cette expérience rendait visible la permanence à Safi comme probablement ailleurs, d’une vieille culture de médina, dans laquelle la transe et le Soufisme populaire ont une part de choix. C’est ce qui explique d’ailleurs l’immense succès qu’ont connu dans le Maghreb, les « Jil » par exemple Nass El Ghiouan. J’ai retrouvé cela à Tunis, à Constantine où pourtant la vieille culture maghrébine semble moins vivante qu’au Maroc. Je l’ai aussi constaté à Casablanca après Safi. Là, à Casablanca, dans une vieille médina rétrécie, cette culture reste vivante et enracinée. Peut-être, faudrait-il décrire un jour cette culture de médina à Casablanca dans le contexte offensif de la modernité comme une contre-culture. Pour toutes ces raisons, je me réjouis de constater d’une année à l’autre, que le Festival de Safi continue. Mais ce qui me fait plaisir par-dessus tout, c’est de savoir qu’on a gardé dans le programme du festival, les nuits de Sidi Boudhab. (Entrtien réalisé par Abdelkader Mana)
Les Festivals d'Essaouira
André Azoulay a fondé toute son action pour la ville sur le tourisme et la culture.notamment par l'organisation de nombreux festivals musicaux. Bien entendu toutes ces passions musicales ne sont possibles que grâce au mécénat d'entreprise, des banques en particulier et aux sponsors qui déploient à cette occasion leur logo tel des pavillons battus par les vagues et le vent sur un navire d'Essaouira emporté par la houle des vents alizés. Mais sans l'intervention discrète mais certaine d'André Azoulay le bateau de la musique de ce festival comme des autres festivals et autres colloques n'auraient pas jeté l'ancre dans ces rivages ô combien beaux mais ô combien désargentés aussi...
Vendredi 30 avril 2010:Jour de musique classique à Essaouira. Affiche du talentueux Hucein Miloudi. Au programme J.S.Bach, F.Chopin, F.Liszt, Maurice Ravel et Johannes Brams : les classiques de la musique classique. Rien de moins.En une seule journée avec des musiciens virtuoses à porter d'oreilles, aux sources de la musique la plus raffinée de l'occident.
La patience de l'écoute; un art que partagent mélomanes et diplomates: il faut beaucoup de patiences et d'écoutes attentives pour mieux savourer une sonate; beaucoup de patiences et d'écoutes pour dénouer les écheveaux complexes du monde en tant que jeu d'échec...
La matinée débute par un Don Quichotte romanesque de Maurice Ravel, interprété merveilleusement par le ténor Belobo et la pianiste Larjarrige...Se laisser transporter par cet Othello incarné, retrouver les émotion primordiales du compositeur d'il y a des lustres: une communion mi-religieuse, mi-mondaine.L'esthétique de la science des harmonie entre notes celestes et transport amoureux..Dieu seul sait que derrière cette apparente improvisation se cache des années de travail sur la voix et ses possibilités accoustiques; la voix en tant qu'instrument musical. Et puis qu'est ce que la musique si non ce mystère qui nous met au diapason des beautés celestes.On ne se rend vraiment compte de l'existence d'un langage musical qu'en écoutant les note translucide du piano qui emplii l'espace comme une pluie d'étoiles se deversant sur nos tête depuis la nuit eternelle du cosmos...
Au colloque "Identités et migrations"
André Azoulay, s'entretenant avec les animateurs de la dernière séance consacrée à l'oeuvre de l'écrivain tunisien Albert Mémmi: la conférencière dira que son expérience d'écrivain a commencé lorsqu'elle a pris conscience que les instants vécus sont périssables et de l'urgence de témoigner de moments de notre vie qui risquent de disparaître à jamais... Le Conseiller Royal a rappelé à cette occasion le mérite du premier gouvernement d'après l'indépendance de Abdellah Ibrahim qui avait ouvert aux juifs marocains les plus hautes sphères de l'Etat y compris au sein de l'armée. C'était le temps où un jeune et brillant ingénieur dénommé Abraham Serphaty était le directeur de Cabinet d'un Abderrahim Bouabid alors ministre de l'Economie dans le dit gouvernement. C'était le temps où le brillant mathématicien Mehdi Ben Barka pouvait rêver et réaliser ses rêves, juste avant la scission entre l'Istiqlal de Allal El Fassi et ce qui deviendra l'UNEFP...Une période à marquer d'une pierre blanche parce qu'elle sélectionnait les Marocains en fonction de leur compétences réelles et non en fonction de leur seule allégeance au pouvoir établi ou en fonction de leur appartenance familiale ou religieuse...
L'écrivain Ami Bouganime, et André Azoulay
André Azoulay, comme à son accoutumé abolit toutes les formes de protocole au colloque "identités et Migrations", pour mettre à l'aise tout le monde et donne l'exemple du Festival des Andalousies Atlantique, qui repose sur un concept simple: la rencontre entre poètes, chanteurs et musiciens juifs et musulmans dont la fusion avait fait le succès de l'Andalousie d'Averoès et de Maïmonide.Le festival a pour thème musical le Matrouz,(le brodé) genre musical judéo andalous que défini ainsi le regretté Haim Zafrani, lui-même fils de Mogador: « Dans la trame des poésies hébraïques de style traditionnel, le poète juif insère de temps à autre des strophes ou des vers de langue arabe. Cette juxtaposition, ce passage d’une langue à l’autre, c’est la réalité culturelle et linguistique du Maghreb juif. Mais ce tissu langagier, cet habit dégradé, a aussi une valeur esthétique ; il n’est pas sans évoquer l’art de la broderie, comme l’indique le nom même de ce genre poétique désigné par le terme Matrouz ou poésie brodée. Le trésor artistique des sociétés méditerranéennes modernes connaît des exemples de cette mosaïque, de ce collage non dépourvu de nostalgie, et chargé d’émotion esthétique. »
Aux Carnets nomades de France Culture, André Azoulay déclare :
«Je ne vois pas d’autres cénacles, d’autres festivals, d’autres espaces dans le monde d’aujourd’hui, où cette relation du Judaïsme avec l’Islam , en terre arabe, au Maghreb, puisse trouver cette forme et cette réalité. Essaouira, c’est ce navire amiral qui envoie en code et en lumière et en signaux tout ce qui nous manque tellement, tout ce que nous avons perdu. Cette modernité qu’Essaouira exprime est celle de cet humanisme qui était tout à fait banale ici depuis des siècles. Mais nous sommes en octobre 2010et cette humanisme a déserté nos rivages. Mais ici, il fait escale Vous avez entendu le rabbin Haïm Louk invoquer Allah, invoquer le Prophète Mohammed, c’est quasiment surréaliste pour certains. Les invoquer de la façon la plus sereine, joyeuse et tellement érudite. Alors que partout dans le monde, chez les musulmans comme chez les juifs ; on est ici sur la planète Mars. Mais quelle planète ! Quelle beauté ! Quelle chance aussi ! »
Dans tout le Maghreb, les zaouia citadines, ont servi de conservatoire pour le Modèle Musical Médini d’origine andalouse. Ce modèle a été introduit à Essaouira par les artisans d’origine andalouse aussi bien musulmans que juifs.Il semblerait qu’on venait de loin à Mogador pour consulter David Iflah et David El Qayem sur les noubas andalouses disparues. Et mon père me racontait comment le grand chantre du samaâ d’Essaouira – le père d’Abderrahim Souiri – s’asseyait dans sa jeunesse aux escaliers des maisons juives où avait eu lieu un mariage pour écouter les modulations vocales des pyutims juifs de Mogador, qui sont l’équivalent des bayteïnes dans l’oratorio des confréries de l’extase.
Charivari et feux de joie
Le Rzoun de âchoura

Personnages du carnaval de l'achoura à Mogador au début du xx ème siècle
Pour Marcel Mauss, la notion d'art est intimement liée à celle du rythme :« Dès qu'apparaît le rythme, l'art apparaît. Socialement et individuellement, l'homme est un animal rythmique ». À la veille du 1er Moharram, jour de l'an musulman - annoncé par la nouvelle lune - le rythme de la Dakka envahit les rues de la ville. C'est le rythme à l'état pur. Au dixième jour de ce mois sacré, on chante le rzoun. Dans le carnaval de l'achoura, il y a enchevêtrement de pratiques sacrées et profanes.

Hier, le mercredi 26 mai 2010, l'artiste Hamza Fakir m'a invité à déjeuner dans son atelier pour discuter de ses toutes dernières oeuvres qui portent sur l'arganier, symbole d'enracinement local. Nous avons évoqué tout les deux l'intérêt que porte Aïcha Amara à son art, à son style et à sa peinture: nous ne savions pas encore qu'elle n'était plus de ce monde! Hier Aïcha est morte, aujourd'hui, nous recevons sa terrible nouvelle...Le vieux chant du Rzoun évoquait ainsi la mémoire de son homonyme "Aïcha Bali" :
Trônant sur son fauteuil
Agitant l'éventail : Aïcha Bali.
Parée de bijoux, diadème magique
Sur le front : Aïcha Bali.
Aïcha, Aïcha, soit heureuse
Nous sommes partis.
La belle a dit :
Compagnon, je t'en prie,
Que me veulent ceux qui m'interpellent ?
Il n'y a rien à dire,
Il est temps que je m'en aille...

Que disait le chant oublié de la ville ? Il parlait d'amour et de mort. Je revois encore les Hamadcha restituant pour une dernière fois ce chant. C'était en 1983 : mon père eut une occlusion qui faillit l'emporter, et à laquelle il a surviécu vingt ans parce qu'il avait une constitution physique solide. Son corps était sculpté par le bois qu'il n'avait pas cessé de travailler sa vie durant. Il se souleva péniblement pour écouter à la fenêtre la rumeur du Rzoun qui montait de la ville. Les mille voix des Hamadcha scandant le chant de son enfance retrouvée. Ce soir-là, les Hamadcha étaient beaux comme dans un rêve, tristes comme dans un linceul..

Durant la séquence de la Dakka, le clan Ouest de la ville, celui des Béni Antar se retrouvait à la porte de la mer (Bab Labhar), alors que leurs adversaires du clan Est des Chebanate se retrouvaient au seuil de Bab Marrakech.La première porte était dite hantée par Aïcha Qandicha,(la démente de la mer). La seconde porte se situait entre les deux vieux cimetières de BabMarrakech (rasés au court des années quatre-vingt). Le tapage nocturne des uns vise à exorciser les génies, et celui des autres à réveiller les morts.

Après le repas du jour de l'an, les femmes et les enfants allument des bûchers dans chaque quartier. Les femmes stériles qui désirent un enfant ou celles qui espèrent marier leur fille, effectuent des rondes autour des feux de joie et sautent au-dessus des flammes par trois fois en chantant avec les enfants. Le brasier symbolise le bûcher dans lequel les païens avaient jeté le prophète Abraham : obéissant à l'ordre divin, les flammes se refroidirent. Le rituel de l'Achoura dure toute la nuit et vise à exorciser le chaos naturel ou humain qui menace l'ordre de la cité. La cérémonie prend un caractère particulièrement organisé dans les anciennes villes du Sud à forte population berbère.
La Dakka est en effet une phase chaude qui se déroulait du crépuscule jusqu’à minuit. Autorités et notables participaient également au rituel : le carnaval abolit les barrières sociales le temps d’une nuit :
C’est l’Achoura mois des folies,
Même le juge frappe son tambourin !
[/i]C’est une fête de libération et de transgression des interdits. Pour les femmes, c’est l’opposé de la fête du Mouloud qui célèbre la naissance du prophète et avec lui la canonisation des tabous :
C’est l’Achoura, nous sommes libres, ô madame !
C’est au Mouloud que les hommes commandent, ô madame !
[/i]Le Rzoun que chantent les sages est une théâtralisation de conflits réels qui opposaient les deux clans de la ville : ce chant inachevé et improvisé est une production collective. Chacun y va de son couplet afin de contribuer par sa verve à l’affaiblissement du clan adverse. La force d’évocation vient des milles voix, de cette répétition sur plusieurs registres mélodiques, tantôt tristes, tantôt nostalgiques, traduisant une cassure quelque part.Le chœur est réparti en deux : la partie orientale (la natte) et la partie occidentale (la couverture). Le haut et le bas reproduisent ici symboliquement le ciel qui recouvre la terre, soit le plan humain et le plan extrahumain. À tour de rôle les deux parties du chœur chantent la mélopée, tandis qu’ils font résonner lentement leurs tambourins. La phase musicale chantée par une partie hésite en son milieu en une longue modulation vocale au terme de laquelle elle est « saisie » par l’autre partie qui enchaîne. Cette modulation hésitante entre la natte et le linceul, la terre et le ciel, symbolise d’une façon tangible la transition marquée par cette nuit de l’Achoura entre le cycle écoulé et celui qui s’ouvre.Ainsi à la phase agitée de la Dakka succède la phase paisible du Rzoun, à la dialectique de la violence où prédominent les célibataires, succède la sagesse des vieux. La Dakka se déroule en position debout et sans parole ; le Rzoun se déroule en position assise, et le rythme lent et faible des tambourins n’est plus qu’un simple support au chant .La compétition chantée était encore vivace entre les clans de la ville. :

Essaouira la belle n’a pas de pareille
Jusqu’au Yémen
Ses hauts remparts sont bénis
Par la protection des saints
Par Sidi Mogdoul qui a une citerne
Devant sa coupole
Permettez-moi donc d’avouer
Les soucis qui m’oppressent
Et si je meurs que personne ne me pleure
C’est pour toi mon bel amour
Que j’en appelle à la muse
Sois donc sans réserve
Et sers-nous les coupes de cristal.
Sois donc sans réserve
Et sers-nous la fine fleur à fumer.
Trônant sur son fauteuil
Agitant l’éventail : Aïcha Bali.
Parée de bijoux, diadème magique
Sur le front : Aïcha Bali.
Aïcha, Aïcha, soit heureuse
Nous sommes partis.
La belle a dit :
Compagnon, je t’en prie,
Que me veulent ceux qui m’interpellent ?
Il n’y a rien à dire,
Il est temps que je m’en aille.
Vaillant compagnon, frappe ton bendir
La nuit est encore longue.
Vois donc les Béni Antar qui s’essoufflent
Avant même que ne vienne l’aube.
Mais quel est votre chef, ô Chebanate ? !
Ossman à la tête bossue et à la bedaine
Serrée d’une cordelette ?
Et qui est votre chef, ô Béni Antar ? !
Ali Warsas traînant son chien
Éternellement sur son âne ?
Qu’est-il donc arrivé aux Béni Antar ?
La mer les a emportés, que Dieu nous en préserve.
Vaillant compagnon frappe ton bendir
Et porte les amendes sur les barcasses
Les voiliers attendent au large.
Comment se fait-il que le gerch d’argent
Devienne le dirham de papier ?
Voilà l’origine du profit et du vol
Commerçant spéculateur,
Artisan grâce à sa bourse mais sans métier,
Est de dire : donne !
Lune ronde toute grande, faites la ronde
Moi, je ne veux pas du vieillard
Mais c’est la volonté de Dieu
À Derb Laâlouj, j’ai vu des yeux d’un tel noir
Si tu savais ô mon frère, combien ils m’ont ravi !
Ô toi qui s’en vas pour Adour,
Emporte avec toi le Nouar !
Je ne veux pas me marier
Mon compagnon m’offre
La coiffe rouge de Marrakech
Comme tu es belle !
Le beau garçon aux yeux brillants
Qui valse dans la salle
C’est le fils d’Alhyane
Il porte un poignard
Ô madame, au cordon de soie…
Vaillant compagnon, frappe ton bendir
Vois donc venir l’aube
Que le maladroit qui ne sait point parler
Ne vienne pas en notre compagnie.
Quant à nous, nous ne bougerons pas d’ici
Nous resterons assis calmement
Ahna gaâdine asidi ba’Rzounou.

Orchestre de Malhun au marché aux grains avec khalili au micro 1983

Juste à côté de la porte de la marine, il y avait une grue aujourd’hui disparue. C’est du haut de cette grue qu’Ali Warsas serait tombé en se brisant irrémédiablement une jambe. Depuis lors, il ne se déplaça plus que sur son âne au point de devenir l’objet d’un fameux couplet du Rzoun le chant disparu de la
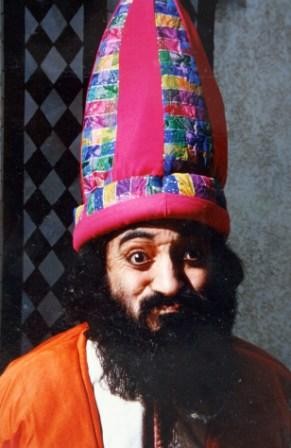 ville. Le clan des Chebanate, le quartier Est de la ville chantait :
ville. Le clan des Chebanate, le quartier Est de la ville chantait :Qui est votre chef ô les Béni- Antar ?
Ali Warsas, toujours sur son âne suivi de son chien !
Ce à quoi le clan Ouest des Béni- Antar répond :
Et qui est votre chef, ô les Chebanate ?
Osman à la tête bossue,
Et qui avait en guise de ceinture, une cordelette ?!
[/i]Ali Warsas qui avait émigré en Angleterre, en était revenu marié avec une Anglaise. À sa mort cette dernière l’avait enterré au cimetière chrétien de Bab Doukkala. Si bien qu’il est le seul musulman enterré parmi les chrétiens ! À l’époque, l’Eglise anglicane était très active à Essaouira, au point que les juifs de la ville avaient organisé une manifestation au quartier des forgerons — manifestation immortalisée par une vieille photo en noir et blanc — pour exiger le départ du chef de l’Eglise anglicane accusé de vouloir convertir les juifs au protestantisme.L’aïeul Ahmed, qui avait disparu au large, était menuisier de son état : il se chargeait de confectionner l’arche de Noé du carnaval de la fête abrahamique d’Achoura.

Sur les décombres d’Essaouira que nous évoquons est en train de naître une ville flambant neuve, faite de kit surf, d’hôtels pour jet-set, de festivals parachutés clés en main par des boîtes de communication et de marketing, lieux de rendez-vous politico-mondains, de villas hors de prix en bordure d’un immense terrain de golf, autour des ruines du palais ensablé du sultan.
Abdelkader MANA
 Autoportrait du temps qui passe...
Autoportrait du temps qui passe...Le 18 décembre 2009, soit le 1er Mouharram 1431, commence le nouvel an musulman. A Essaouira rien ne l'annonce si non le tappage des tambourins par les enfants de notre quartier et le soir venu j'ai croisé à derb Laâlouj des enfants qui sautent par dessus un feu de joie.Hier, le 26 décembre, partout je croise des groupe de dakka, adolescents et enfants parcourant la ville avec leurs tambourins. En me rendant à la zaouia des Hamadcha j'y découvre Dabachi en train de diriger une séance de Rzoun de âchoura où figure entre autre le tambourinaire Larabi des Halmadcha et maâlam Hayat des gnaoua. La partie était très belle et bien maîtrisée. Ils ont chanté en ma présence le couplet sur Alhyan qui valse dans la salle, celui sur le pèlerinage et celui sur la brassée de kif et la coupe de cristale. Après le chant tout le monde s'est levé pour jouer le pur rythme de la dakka. En les observant, je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas de technique, mais d'un don inné que relève de la fougue et du tempéremment de la personne: on a ou on a n'a pas le rythme dans le sang, dans les tripes. C'est pourquoi on a chanté aussi le couplet: "Mais que vient faire parmi nous le maladroit qui ne sait point rythmer la mesure?".
Le crépuscule de Mogador…

Il était une fois Mogador... "Were Manschester cotton is sold, Mogador"
Quand le cotton de Manshester était vendu à Mogador
C'est curieux que les tissus soient vendus à souk jdid jusqu'à nos jours! On y vendait non seulement les tissus de Manschester mais ceux aussi de Gêne et de Lyon comme le soulignait en 1867, Auguste Beaumier consul de France à Mogador dans un rapport sur les importations du Maroc : "les tissus de soie qui entrent dans le Maroc sont le satin, le velours, le Damas, les brocarts, les mousselines dorées, fil et galons d'or. Les velours à trois poils de Gênes sont les plus recherchés, et de la meilleurs vente et les couleurs préférés sont la couleur cramoisie de violette, vert bleu, bleu éclatant. Les mousselines dorées blanches et colorées proviennent des fabriques Lyonnaises."(in le Maroc du Bulletin de la Société de Géographie de Paris de 1867). Le temps est passé et de port international par où transitaient les caravanes de Tombouctou et les caravelles de la lointaine Europe, Essaouira n'est plus qu'un petit port de pêche où les goélands tissent le ciel avec la mer. Comme disait mon père: "Essaouira est une veuve déchue qui se souvient de sa gloire".
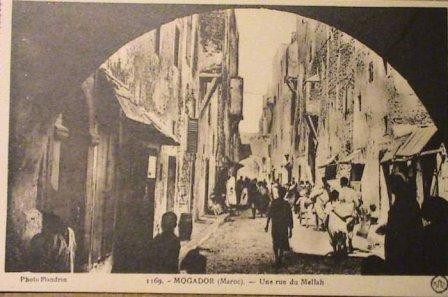
Principale artère du Mellah d'Essaouira
En 1807, Moulay Slimane envoya une lettre ordonnant la création d'un Mellah (quartier juif) . Car la kasbah ne pouvait plus contenir les courtiers (bassaria) , les bijoutiers, les selliers, et autres colporteurs qui sillonaient la région et qui étaient venus des Mellahs pré-sahariens dans le sillage des négociants de leur religion.La ville abritait autant de juifs que de musulmans comme l’atteste le recencement de 1921 : sur une population de 20.309 qui habitaient alors Mogador, 10.080 étaient musulmans et 9.487 israelites. Le reste, soit 1440, étaient européens. Les juifs étaient minoritaires dans le pays, mais pas à Mogador. Et puis un jour ils sont tous partis.

Prière pour la pluie en une année de sécheresse comme le Maroc en connait depuis toujours d'une manière cyclique.Cette photo date de 1922 : les juifs étaient encore nombreux à Mogador.Mais voilà qu'en peu de temps, les vississitudes de l'histoire les ont arraché pour toujours à ce pays qu'ils aimèrent et où ils vécurent depuis deux mille ans: es-ce qu'on s'arrache de sa terre natale, même pour la terre promise, sans blessure de l'âme et sans nostalgie?
Le témoignage de maâlem Mtirek,ami de mon père que j'ai rencontré presque centenaire en 2010, et dont la mémoire reste étonament vigoureuse : "Les juifs avaient leur propre orchestre de musique andalouse: Chez eux un dénommé Solika faisait office de joueur de trier, il y avait aussi un rabbin qui jouait de la kamanja et un autre du luth. On allait aussi écouter les mawal chez la communauté israélite de la ville. Une fois alors que j'étais au mellah, au vestibule d'une maison juive où se déroulait un mariage, je me suis mis à déclamer un mawal à haute vois - j'avais alors une voix très forte qui porte au loin - et tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens en disant : « Venez écouter cette belle voix d'un musulman ! ». A l'époque il y avait un tailleur parmi les musulmans dont j'ai oublié le nom, qui avait une voix tellement attendrissante, qu'elle paralysait quiconque venait à l'entendre. ».

Orchestre de musiciens juifs de Mogador
Au beau milieu de derb laâlouj, le siège du consulat de France, ongle rue Mohamed Diouri, est toujours marqué par une plaque commémorative rappelant que l'explorateur Charles de Foucault s'y est arrêté le 28 juillet 1884; là il fut convié à un dîner par un négociant juif : Soirée musicale animée par un orchestre mixte juif et musulman. Toutes les maisons juives de la kasbah disposaient d'un piano importé de Londres.Les consuls étaient souvent invités à des soirées, animées tantôt par les juifs, tantôt par les musulmans.Dans toutes les médinas, par opposition à la campagne on trouve un modèle musical médiniste (MMM) qui se pose en s’opposant à la campagne. Aujourd’hui, la médina, investie par la modernité et marginalisée par sa périphérie, perd à la fois son caractère communautaire et sa culture traditionnelle. Les nouveaux apports de population avec de jeunes fonctionnaires et des ruraux, ignorent la culture médiniste et ne peuvent la reproduire.
La présence juive de Mogador en images

La rue de Mellah Qdim en 1916
Le samedi soir,le cœur de la médina, que constitue cet ancien mellah, grouillait de juifs grignotant des amuse-gueules, en se rendant au cinéma Scala – consulat d’Allemagne jusqu’à la fin du XIXe siècle – tenu par le Sieur Kakon, où ils assistaient en première, aux films muets de Charlie Chaplin. Les négociants juifs tenaient encore les entrepôts de l’ancienne Kasbah (fondée en 1764) et de la nouvelle Kasbah (fondée en 1876). On appelait ces entrepôts lahraya diyal lagracha : les entrepôts de la gomme de sardanaque (gomme prélevée sur le thuya de l’arrière-pays, mais aussi sur l’acacia du Sahara, ainsi que sur les autres essences forestières de l’Afrique subsaharienne).
Bab Sbaâ , vue de l'extérieur-photo de 1910
"Toujar sultan" devant "dar Makhzen" dans la kasbah à la veille du Protectorat

Souk el Attara dans les années 1920

Orfèvre jusque dans la rue
Dans mon enfance, quand je me rendais en vacances au pays Haha, je me souviens d'unbradiî (bâtier) juif, qui nous rendait alors visite sur son petit âne,et mon oncle l’installait sur une hssira (natte de jonc), à l’ombre de notre figuier préféré, lui offrait du thé et il se mettait à rafistoler les bâts éventrés d’où sortaient les touffes de pailles dorées.La récolte de l’arganier se faisait alors au prorata des ayants droit avec sacrifice de bouc et festin. Et le soir on assistait à de magnifiques fêtes de mariage avec chants de femmes aux caftans bariolés et fantasia

Rue Attara en 1933
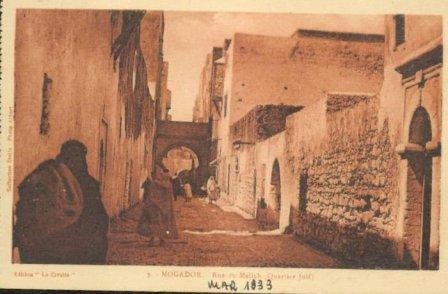
Le Mellah en 1933

Le Mellah dans les années 1950
Employés de l'usine Carel(années 1950)
De gauche à droite: Mr.Josephe Ohayon,Mr.Salomon Bouhadana, Mr.Mayer Bensmihen,Mr.Simon Bouhadana,Mr.Baba Zrihen
David Bouhadana et Michel Piccoli lors du tournage de "la poudre d'escompette" à Mogador dans les années 1970
Josephe Sebagh, l'inamovible libraire de la kasbah de Mogador
Les juifs de la kasbah et ceux du Mellah
La kasbah vers 1913 : on venait à peine d'y planter les nymphéa
Mon père me disait que les juifs du Maroc n’ont jamais accepté au fond leur statut de minorité dominée politiquement par la majorité musulmane : cela explique pourquoi en 1912, lorsque les Français ont débarqué à Essaouira avec le navire Du Chayla, et que les soldats se sont rendu au nord de la ville, où ils ont fermé le fuseau à Bab – Doukkala, l’un des juifs qui sortaient du mellah pour observer la prise de la ville demanda surpris à un congénère :
- Que se passe-t-il ?
Et l’autre de lui répondre :
- Ce que le bon Dieu fasse durer pour nous !
Il émettait ainsi le vœu que la domination française se perpétue au Maroc. D’ailleurs, bien avant l’arrivée des Français, de pauvres juifs du mellah étaient protégés français tandis que de riches négociants de la Kasbah étaient protégés anglais. Ils jouaient de leur statut d’intermédiaires entre le Makhzen et les puissances étrangères.

A gauche l'école Anglaise, commissariat ultérieurement.Les enfants d'indigènes doivent se contenter de l'école coranique...
À l’époque, l’Eglise anglicane était très active à Essaouira, au point que les juifs de la ville avaient organisé une manifestation au quartier des forgerons — manifestation immortalisée par une vieille photo en noir et blanc — pour exiger le départ du chef de l’Eglise anglicane accusé de vouloir convertir les juifs au protestantisme.Si dans la plupart des ports marocains, la majorité des Européens installés est catholique, dans celui d'Essaouira il y a une forte proportion de protestants anglicans.Ce qui explique que la première mission protestante à s'implanter dans le pays soit celle entreprise par l'Anglais J.B.C.Ginsburg, en 1875, à Essaouira.Celle-ci s'est attachée très vite à l'évangilisation des juifs de la ville.Dès le premier mois de sa fondation, le grand rabbin d'Essaouira exprima ses craintes au consul de France.Il demande aux autorités marocaine et au consul d'Angleterre d'expulser ce missionnaire de la ville.Les juifs menacèrent de faire appel aux Arabes de l'intérieur pour parvenir à leurs fins.Le gouverneur de la ville fut amené en janvier 1877, à la suite de la manifestation organisée par les juifs, à prier le consul angla.is d'expulser Ginsburg.Les juifs d'Essaouira considéraient les protestants anglais comme des rivaux; les problèmes qui résultent de la cohabitation des juifs avec les protestants étaient plus d'ordre économique que d'ordre religieux

Ecole Française, Bibliothèque Publique
L'école de Mogador en 1910
A la veille du Protectorat, les juifs de la kabah étaient protégés anglais et ceux du Mellah protégés français:les enfants des juifs de la kasbah fréquentaient l'école anglaise et ceux du Mellah l'école française...
Lieux de mémoire

Vue générale actuelle du même "Mellah Qdim"
La vieille médina est maintenant transformée en une énorme hôtellerie comme on le voit avec cette enseigne annonçant un "Riad"....
En traversant le vieux Mellah (mellah QDIM) on aboutit à "jamaâ Bihi" l'école coranique où chaque matin, mon père maâlem Tahar MANA, devait quitter son atelier de marqueteur en face du cinéma Skala pour nous ramener des baignets tout chaud en guise de petit déjeuner. Le fiqih Si Bihi qui nous enseignait alors avait une longue barbe blanche et la mine sévère: il recourait souvent à la bastonnade en guise de correction : un jour il m'ordonna d'épeler l'alphabet arabe tandis que les autres enfants devaient répéter après moi. Mais je n'arrivait pas à aller au-delà de la lettre "JIM" et invariablement il faisait tomber son énorme baton sur mon crâne. Depuis lors je me suis mis à fuire l'école coranique pour aller écouter le savoureux conteur de Bab Marrakech : ma mère avait toutes les peines du monde à me faire revenir à cette école coranique.qui représentait pour moi le chatiment Elle devait me trainer au point de voir son haïk défait en pleine rue : j'en ai gardé pendant des années une bosse au sommet du crâne....
Le mur où je devais épeler l'alphabet Arabe
A l’alliance israélite où j’étudiais, on m’accorda alors de beaux livres pour enfant, que je n’ai pu recevoir à l’estrade, mais que Zagouri, mon institutrice, me remit chez le pâtissier Driss, où elle m'avait fait venir : j’ai eu alors droit et aux Beaux Livres et à un gâteau au chocolat ! Je lui ai menti, en lui disant que je n’ai pu assisté à la remise des prix parce que j’étais parti àChichaoua ! En réalité l’appel de la plage et des vacances étaient plus forts, surtout quand les élèves se mettaient à chanter à la récréation dans la cour :
« Gai gai l’écolier, c’est demain les vacances...
Adieu ma petite maîtresse qui m’a donné le prix
Et quand je suis en classe qui m’a fait tant pleurer !
Passons par la fenêtre cassons tous les carreaux,
Cassons la gueule du maître avec des coups de belgha (babouches)
Allée des araucarias que nous traversions pour rejoindre nos écoles
Maintenant que tout ce que nous aimons n'est plus là-bas, maintenant que nos retrouvailles avec notre villes sont peuplés de déceptions...Maintenant que le passage devant notre école et notre vieux cimetière ne nous fait plus frémir de nostalgie...Maintenant.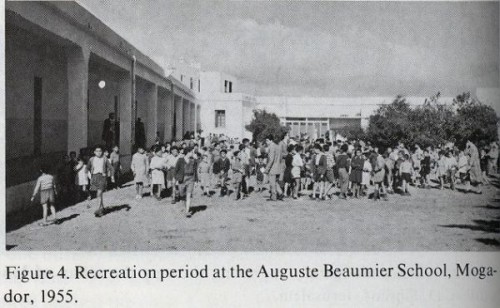
A L'alliance on accordait aux enfants un petit déjeuner fait de soupe de semoule et de lait au chocolat et l'après midi une tranche de pain et un morceau de fromage Américain. C'était à 16 heures, où notre sévère institutrice Mme Bensoussan, toujours muni d'un fouet en queue de boeuf, épulchait son orange tandisqu'on nous distribuait le goûté. Elle aurait quitté l''école et Essaouira en l'année scolaire troublée de 1965 et serait morte, dit-on autant d'avoir perdu sa fille dans un accident au promontoire d'Azelf que d'avoir quitter définitivement Mogador où son mari était le fleuriste qui égayait le marché par ses couleurs ensoleillées..
Comment de la plaine surgirait Mogador?
Comment pourrait-on haïr qui l'on aime?
L'alliance portait le nom d'Auguste Baumier, consule de France à Mogador au XIX ème siècle. A l'époque les juifs du Mellah étaient protégés français et ceux de la kasbah protégés anglais.
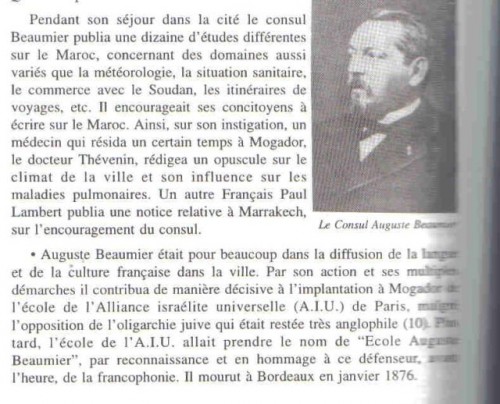
Classe de première année de l'école primaire de l'Alliance israélite de Mogador où étudiaient juifs et musulmans : 1961 - 1962
Ma tante maternelle habitait alors dans la médina d’Essaouira du côté de la Scala de la mer — la maison même où était né Bouganim Ami, l’auteur du « Récit du Mellah », comme il me l’a indiqué lui-même lors de son bref séjour de 1998. Une maison avec patio où la lumière venait d’en haut. Et moi tout petit au deuxième étage regardant le vide à travers des moucharabiehs et répétant la chanson en vogue à la radio :
C’est pour toi que je chante
Ô fille de la médina !
J'écris à Bouganim Ami: " À cause de ton frère cadet; Jojo mon copain de classe chez notre maîtresse Benssoussan, j'ai un rapport très mystérieux avec les Bouganim. Disons un rapport fraternelle . Quand tu m'avais conduit à la maison où tu étais né à Mogador ; il s'est trouvé que c'est dans cette même maison que j'ai passé les plus heureuses années de mon enfance...Quand plus tard j'ai pleuré d'émotion en lisant ton récit du Mellah... " De Mogador, m'écrit-il aujourd'hui, je conserve surtout le souvenir d'une maison lézardée qui menaçait de céder et de s'écrouler. Les marches étaient si vieilles qu'elles craquaient sous nos pieds. Les monter ou les descendre relevaient d'une prouesse acrobatique. L'escalier était si obscur, de jour et de nuit, hanté de gnomes, de démons et de génies qu'on ne savait qui l'on croisait. Les carreaux de la verrière, contre laquelle le vent s'acharnait, ne cessaient de casser et de s'écraser dans la cour. Les balustrades des fenêtres étaient si fragiles qu'il nous était interdit de nous y appuyer. Les portes et les volets ne cessaient de claquer, secouant toute la bâtisse. Les souris et les chats s'introduisaient librement par la porte entrouverte en permanence ; les hirondelles ne se glissaient malencontreusement par la verrière que pour se heurter aux murs en quête d'une introuvable issue de secours. Les mouches, les abeilles et les hannetons voltigeaient tout autour jusqu'à ce que, par distraction, ils échouent dans l'une des nombreuses toiles d'araignées qui dentelaient les coins. Pourtant, c'était le paradis, ça l'est resté, malgré la riche galerie des esprits ou grâce à eux, et à l'occasion du tournage d'un documentaire sur Mogador, j'ai découvert sans grand étonnement que des promoteurs sagement avisés s'apprêtaient à en faire une maison d'hôte."

Le minaret de la mosquée de la kasbah et le clocher de cette même église
L'église où l'hôtelière juive "Messaouda" avait institué dans les années cinquante,une sorte de "restaux du coeur" avant l'heure, y recevant à table ouverte tous les nécessiteux de la ville. c'est là aussi qu'était venu en 1884, le père de Foucauld en provenance de Taroudant déguisé en Rabbin: il a assisté à une soirée musicale d'un orchestre mixte de la ala andalouse animée par des musiciens juifs musulmans

15 janvier 2003 : Hier, j’étais à la municipalité pour y rencontrer Hallab, le chef du groupe folk local. Il m’a dicté une qasida de Souhoum où l’on parle du Barzakh, cette station céleste des âmes mortes.Le soir Ben Miloud m’a parlé du récit que me racontait mon père sur son grand - père l’imam dela Grande MosquéeBen – Youssef :
« Le prêtre de l’église locale avait l’habitude de se rendre tôt à la plage de Safi, au nord d’Essaouira. Un jour il perdit un gousset plein de louis d’or, non loin de Bab Doukkala. Le grand- père de Ben Miloud, qui était imam à la Grande Mosquée, et qui avait lui aussi l’habitude de faire sa promenade matinale au bord de la mer, découvrit le gousset de louis d’or. Le jour même, il fit appel au crieur public pour annoncer au travers les artères de la ville, que « quiconque avait perdu un gousset ; doit se présenter devant l’imam de la Grande Mosquée pour donner son signalement et son contenu, afin qu’elle lui soit restituée. Le prêtre se présenta devant l’imam et retrouva effectivement son gousset de Louis d’or intact ».

Cette anecdote sur la cohabitation des religions me rappelle un souvenir d’enfance : au cours d’un été, alors que j’étais encore en culottes courtes, le bruit courut que « Jmia » s’était noyée, que son corps avait été recueilli sur les rivages de Sidi Mogdoul et que les pompiers l’avaient déposé à la morgue de la ville. Je ne me souviens plus comment je m’étais retrouvé en train de regarder par la serrure de la morgue : c’était la première fois de ma vie que je voyais le corps nu d’une jeune femme morte. Un corps doré mais inerte. « Jmia » m’aimait beaucoup, et me chantait souvent une chanson alors en vogue :
Ô flammes brûlantes qui me dévorent les entrailles…
Le lendemain, j’ai eu une autre surprise : à son enterrement était présent le mari juif de notre institutrice, Mme Cohen. Que faisait donc ce juif à l’enterrement de Jmia dans un cimetière musulman ? On avait l’impression que toute l’assistance était pleine de respect et de gratitude pour ce geste du Sieur Cohen pour l’enterrement de Jmia. Il n’y avait plus ni juifs ni musulmans, quand il s’agissait d’enterrer une part de la mémoire commune de la ville.
Le Sieur Cohen a émigré par la suite avec sa famille au Canada comme ce fut le cas du bijoutier Nessim Loeub : dans les années soixante mon père m’avait envoyé faire une commission chez ce dernier qui habitait alors rue Théodor Cornut : sa salle à manger disposait d’un piano importé d’Angleterre comme dans toutes les maisons des négociants juifs de la kasbah. Au milieu une immense table en acajou, où sont servis des mets variés et raffinés, où s’entremêlent produits de la terre et ceux de la mer.
La dernière année de mon enseignement à l’école primaire de l’Alliance Israélite, nous avions comme instituteur d’Arabe, un safiot sec comme une allumette avec des dents entièrement ravagées par la carie à force de fumer du kif. C’était une véritable terreur, qui en état de manque soumettait les élèves récalcitrants à de véritables séances de tortures. Un jour le père de l’un des élèves, policier de son état, est venu se plaindre à Monsieur Moïse Ohanna, le directeur de l’Alliance Israélite, paisible et rondouillet homme à la calvitie prononcée et au eterrnel costume gris, féru de mandoline et qui se substituait aux maîtres en mathématiques en cas d’absentéisme. Le lendemain de son entrevue avec le parent policier, il se pointa à la première heure à notre cours d’Arabe et apostropha ainsi notre instituteur colérique :
- Mais Monsieur, nous ne sommes pas ici en commissariat de police ! Vous n’avez pas à pratiquer la torture sur mes élèves ! Suivez –moi à mon bureau…
Depuis lors, nous n’avons plus jamais revu cet instituteur au grand soulagement de tous les écoliers. Et maintenant Josephe Sebag m’apprend que notre directeur d’école d’alors avait quitté Mogador à la fin des années soixante pour finir ses jours en solitaire dans une chambre d’hotel en Espagne, où il vivait de quêtes en jouant de sa mandoline à la gare de Barcelonne !
A sa mort, au début des années 1990, le seul bien qu’on avait trouvé sur lui, était une théière de Mogador ! Elle appartenait probablement à sa mère. Il était né d’une grande famille de négoçiants de Mogador qui trafiquaient dans le henné – d’où le nom d’Ohanna- et exportaient les amandes et la gomme de sardanaque. Moïse Ohanna vivait avec deux autres frères qui ne s’étaient jamais mariés comme lui, dans une demeure de Derb Laâlouj et leur père était vendeur d’épices à Attarine
Une vue du Mellah datant de 1935

Mogador - Rue du Mellah

Mogador-Rue du Mellah

Attaqué par les embruns et par les vague le Mellah a fini par s'effondrer

Les remparts du Mellah avant 1918

Le cimetière français et les remparts qui jouxtent le Mellah
.C’était l’époque de l’exode massive de la communauté juive d’Essaouira vers Israel . Les juifs du Mellah vendaient tout leurs biens et prenaient pour la dernière fois l’ autocar de Bab Doukkala, quittant ainsi définitivement la ville qui les a vu naître. Il y avait parmi eux Rahèel, la couturière de notre quartier, que j’ai connu toujours assise à même le sol, activant sa vieille machine à coudre « Singer », pour confectioner des habits traditionnels, qu’elle vendait ensuite à la Joutia ou aux colporteurs juifs qui sillonaient les campagnes environantes. On l’appelait khiyata d’el-melf, couturière spécialisée dans la coupe et la couture des vêtements de drap et de toile. J’ai appris beaucoup plus tard qu’elle serait morte lors de la traversée de la Méditérranée, sans avoir jamais atteint « la terre promise »...
.Le Sieur Cohen a émigré par la suite avec sa famille au Canada comme ce fut le cas du bijoutier Nessim Loueb.Ce dernier faisait partie du premier conseil municipal de la ville d'après l'indépendance qui se composait en majorité de juifs .Je devais avoir huit ans et j’étais le seul de mes frères et sœur à fréquenter l’alliance israelite, où on étudiait aussi bien l’Arabe et le Français que l’hebreu. Mon voisin de banc n’était autre que Jojo Bouganim, le frère cadet de l’auteur du « récit du Mellah », où celui – ci raconte cet émouvant départ sans retour de la communauté juive de Mogador : "Ma dernière journée à Mogador, quand le vent se mit à souffler, l’océan à déborder, les palmiers à se tordre et que, comme dans un cauchemar, les sionistes se présentèrent, la nuit tombée, pour nous embarquer. ». L’exil, la nostalgie, le crépuscule de Mogador ..
L’exil, la nostalgie, le crépuscule de Mogador ...
Souk el Guezzara (le marché des bouchers)
Ce matin je rencontre un banquier, ex-footballeur d’Essaouira installé à Agadir au début des années soixante-dix (période charnière dans l’histoire de la ville : en 1967, les derniers juifs d’Essaouira quittent la ville à la suite de la guerre israélo-arabe, 1968 : arrivée massive des hippies qui s’installent au village de Diabet ; 1970 : départ massif des Souiris vers Casablanca, Marrakech et Agadir). Les « Souiris » d’Agadir sont restés les plus nostalgiques de la belle époque de Mogador du fait qu’Agadir les a moins dispersés qu’une ville comme Casablanca. Ce matin, donc, l’ex-footballeur, né en 1948, me parle de ses souvenirs d’enfance, c’est-à-dire d’Essaouira des années cinquante et soixante : des jardins potagers qui entouraient la ville — en dehors des remparts il n’y avait que des cimetières et des potagers — , des pêches fabuleuses des sardines et de thon ; de « l’Océan Sandillon » avec son rocher aux pigeons et son rocher aux plumes (Sidi Bou Richa) où les femmes venaient sacrifier aux génies de l’océan ; poules et coq aux sept couleurs des esprits : les Gnaoua leur recommandaient de se nourrir de la chair non salée de la volaille pour apaiser les entités surnaturelles qui les possédaient.
- Les « possédées » venaient déposer là en offrande poules et coq pour Sidi Bou Richa raconte l’ex-footballeur ; et nous profitions de l’occasion pour détourner les offrandes à notre profit en préparant de succulents tagines.
Il me raconte par la suite comment à ce même endroit réputé hanté par Aïcha Qandicha (Kadoucha, la déesse de la mer ?), la mer en se retirant laissait derrière elle, dans les interstices des rochers, de petits poissons couleur d’algues dénommés « boris » probablement par la population d’origine africaine de la ville parce qu’il existe effectivement une divinité africaine du nom de « Bori » et parce qu’au cours du rituel dela Lila, il existe un esprit possesseur (melk) où le possédé danse avec un bol d’eau de mer contenant ce petit poisson des rochers .
- Enfant, poursuit notre ami, après les avoir capturés, on les vendait au juif dénommé Ishoâ. J’avais décidé un jour de l’épier pour voir ce qu’il pouvait bien faire avec de si petits poissons de roches. Je l’ai suivi jusqu’au Mellah où il tenait une boutique en face du dépôt de vin, où on fabriquait, à base des raisins charnus du pays chiadma — dénommés « tétons de jument » (bazzoult al âouda) — un vin rouge qui était célèbre pour son nom d’« arche de Noé ».
Cette même arche de Noé avec laquelle la ville accueillait le nouvel an musulman, car le subconscient du port a toujours été hanté par la crainte du déluge. Sidi Abderrahman El Majdoub ( mort en 1569) ne prédisait-il pas dans ses quatrains qu’« Essaouira verra ses richesses venir de pays lointains et qu’elle périra sous le déluge, un vendredi ou un jour de fête »? À force de boire de cette arche de Noé, pour faire face au froid glacial du Gulf stream et des vents alizés, les marins étaient toujours ivres en montant à bord :
- En épiant le soir cet Ishouâ, je me suis rendu compte qu’il vendait les boris en petits morceaux aux juifs qui en nourrissaient leurs chats.
C’est pour cette raison que les chats et les mouettes disputaient aux humains depuis lors, les terrasses et les ruelles de la ville !

De menus travaux où tout se récupère, où rien ne se perd
Les juifs travaillaient à mille et un métiers : ils étaient celliers et colporteurs sillonnant les campagnes environnantes sur leurs ânes ; ils étaient tailleurs et orfèvres, cordonniers et frappeurs de monnaies. Il y en avait même parmi les marqueteurs me disait mon père : il fabriquait pour les mariées juives un secrétaire en mohagné (lacajou) dénommé « skitiriou ». Pour survivre, les juifs faméliques du Mellah acceptaient n’importe quelle rétribution :
- Je me souviens de deux aveugles qui acceptaient de nous vendre du poivron vinaigré contre de la fausse monnaie ! Et l’on pouvait se faire coiffer à deux sous chez Afriat !
Qu’on ne s’étonne pas qu’une telle communauté ait pu donner naissance à un Abraham Serfaty ; le chef du marxisme marocain, qui a payé son engagement politique par la paralysie de ses deux jambes sous la torture ; et don’t Yveline la sœur a payé de sa vie le fait d’avoir refusé, au début des années soixante-dix, d’indiquer aux policiers qui la torturaient où se trouvait caché son frère ?

La principale allée du Mellah, qu'on vient de faire disparaître après qu'elle soit tombée en ruine
Ca y est, j’ai retrouvé le nom de l’unique marqueteur juif d’Essaouira selon mon père : il s’appelait David El Qayèm (son nom de famille signifie en arabe le « redressé »). Et aujourd’hui même j’ai rencontré à Imine – Tanoute, un paysan berbère du haut Seksawa qui se dénomme « Afriat », je lui demande :
-Pardon, comment se fait-il que vous portez ce nom d’Afriat, célèbre à Essaouira comme étant le nom d’un luthiste juif, amateur de Malhûn, originaire de Goulimine ?
Mon interlocuteur d’Imine –Tanoute, m’explique que le nom d’Afriat n’a rien à voir avec la langue hébraïque ; c’est en fait un mot berbère qui désigne la personne dont les gencives sont disjointes. Nous avons une autre famille d’Essaouira qui porte un nom ayant la même signification en arabe : El Form (le « disjoint »). Donc ce n’est pas le berbère qui porte un nom hébreu, mais c’est le juif qui portait un nom berbère ! « Afriat » est un mot berbère et non pas hébraïque.
J’ai retrouvé au Haut-Atlas, en remontant vers le mont Toubkal, un hameau à la lisière de Tifnoute qui était anciennement habité par des judéo-berbères. Tifnout désigne ces montagnes dénudées qui entourent le lac d’Ifni : Tifnout en tant que haut lieu inhabité s’oppose comme le vide au plein, aux zones de moindre altitude où l’habitant vit à l’ombre de gigantesques noyers. Le hameau dont il s’agit est le dernier lieu habité, après quoi on pénètre dans le vide sans vie des montagnes rocheuses de Tifnout, l’équivalent du « Khla », en arabe ; c’est à dire lieu sans habitation, sans végétation et sans vie.
Chaque année les juifs s’y rendent en pèlerinage, comme ils le font au hameau d’Aït Bayoud de la tribu Meskala dans la région d’Essaouira. Et comme ils le font à « Moulay Ighi » dans la fraction de Tisakht-Ighi, des Glawa –Nord. Ces observations que nous avons fait nous-mêmes lors de dérives au Haut-Atlas, sont confirmés par les témoignages rapportés par Haïm Zafrani :
« Nous avons recueilli auprès d’un vieux rabbin, divers renseignements sur les communautés judéo – berbères de Beni-Sbih, dont notre informateur est originaire, celle de Ktama, de Glawa, de Tifnut et de Tamgrut. »
Deux mille ans de vie commune sur la terre marocaine ont laissé des traces. Mais ce qui est étrange, c’est comment toute cette communauté s’est évaporé d’un seul coup après la naissance d’Israël ?
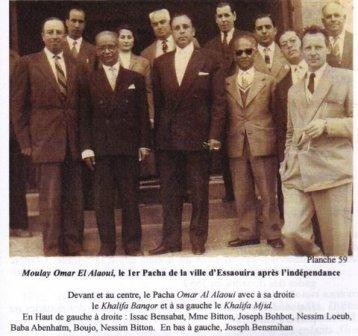
Devant et au centre, le Pacha Omar Al Alaoui avec à sa droite le khalifa Banqor et à sa gauche le khalifa Mjid.En haut de gauche à droite: Issac Bensahat, Mme Bitton, Josephe Bohbot, Nessim Loeub, Baba Benhaïm,Boujo, Nessim Bitton, et en bas à gauche: Josephe Bensmihan.
Avec de tels élus, la ville avait prise sur son destin. Mais à partir de l'indépendance, le pouvoir municipal sera transféré au Pacha, fonctionnaire nommé par le ministère de l'intérieur.Dès lors les élus locaux n'avaient plus aucun pouvoir de décision.Juste un pouvoir consultatif.Or le Pacha est systématiquement nommé et vient surtout d'ailleurs: Essaouira avait désormais affaire à des fonctionnaires incompétents ne connaissant ni l'histoire ni la culture de la ville, n'ayant aucun scrupules à raser ses jardins et à ne pas tenir compte des doléances de ses habitants .
Le protectorat nous a légué un conseil municipal parfaitement occidentalisé, à majorité juive et avec la participation d'une femme! Pas une djellabah blanche ni de fez hypocrite à l'horizon!De tous ces personnages, c'est du khalifa Banqor et de Nessim Loeub dont je me souviens le plus.Le premier parce qu'il nous a pris "marjane"(coraîl), notre chien préféré qui nous accompagnait sur la plage jusqu'à l'embouchure de l'oued ksob et sa forêt de mimosas. Poumon de la ville, c’est dans ce bois ombragé que se déroulaient chaque vendredi les pique-niques rituels des artisans , et c’est là aussi qu’accompagnés en calèche avec mon père et ma mère, nous nous perdîmes un jour des années 1960, ne sachant plus trouver d’issue, tellement la végétation était dense… et le second parce qu'il faisait commande à mon père d' écrins en bois de thuya pour ses bijoux.

On louait les calèches au méchouar pour rejoindre le bois de mimosas au bord de l'oued ksob.
Orfèvres de Mogador : des artisans/artistes

Nessim Loeub, le grand orfèvre d'Essaouira
Que des ruraux, que des ruraux, du côté Nord de la ville : où sont passés les visages connus ? Que des ruraux, que des ruraux déambulant au milieu de la pacotille ! Tel est le nouveau destin de la ville ; d’un côté, la clientèle touristique de la baie, et de l’autre ce peuple anonyme déambulant dans la ville. Des hordes hilaliennes perdues. Des citadins, mon père disait : ils ont vendu les clés de la ville.En ce moment à Essaouira, c’est le temps de la foule des vacanciers : autant dire le vide. Rien à lire non plus dans les journaux, y compris dans la presse française. Il est loin le temps où les intellectuels français se manifestaient dans la presse, on dirait qu’ils ont choisi de se taire. Au Maroc, les intellectuels des années 1970, sont maintenant devenus ministres des finances et de l’enseignement, et à l’université, les islamistes ont pris la place des marxistes. Et en lieu et place des revues de réflexion s’est substituée la culture du papier glacé. Autant raconter l’histoire ancienne : lutter contre le silence et l’oubli.
Dans les années soixante mon père m’avait envoyé faire une commission chez Nessim Loeub qui habitait alors rue Théodor Cornut : sa salle à manger disposait d’un piano importé d’angleterre comme dans toutes les maisons des négoçiants juifs de la kasbah. Au milieu une immense table en acajou, où sont servis des mets variés et raffinés, où s’entremêlent produits de la terre et ceux de la mer. Mon père disait souvent qu’en ce bas monde, il ne nous restera que ce que nous avons mangé et bu….Et à Mogador, les juifs étaient très férus des plaisirs de table, au point que certaines variétés de poissons, comme la morue, sont appelés localement « poissons juif » (ou « Iskran » en berbère ).L’air distingué, chapeau melon gris sur tête, Nessim Loueb, m’invite au partage comuniel :
- Il faut d’abord honorer ma table, on parlera de la commission de ton père par la suite....
C’était à la veille d’une mémorable visite que feu Mohamed V devait faire à la ville : Nessim Loeub avait confectionné à cette occasion, un magnifique sabre en filigrane d’or sur fond d’argent incrusté d’émeraudes et autres pierres précieuses où s’exprimait tout l’art des orfèvres juifs de Mogador – le fameux « dagg souiri » - et mon père devait fabriquer le coffret en bois de thya tapissé de velours où devait reposer le sabre royal . Traditionnellement la hadiyya de la communauté juive consistait en pièce d’orfèvrerie.. Avec leur beau sabre, et son coffret en bois de thuya, Nassim Loeub et mon père s’inscrivaient ainsi dans la vieille tradition marocaine de la hadiya.
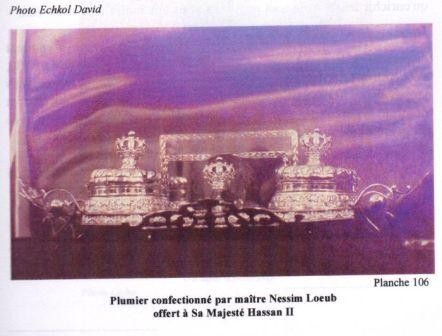

Avec leur beau poignard berbère, et son coffret en bois de thuya, Nassim Loeub et mon père s’inscrivaient ainsi dans la vieille tradition marocaine de la hadiya.Nessim Loeub était en réalité « Chkâ’yrî » (bailleur de fonds) en métaux précieux. Il faisait travailler les artisans bijoutiers grâce à ses capitaux. Il y en avait deux sortes : les dhaybya qui travaillaient l’or, et les syaghaqui travaillaient l’argent.Abdelhamid, mon frère aîné m'apprend maintenant que le dit cadeau était remis à Eisenhower, le président des Etats-Unis lors de sa rencontre avec Mohamed V à Marrakech en 1960.

Bijoutier juif de Mogador
Il y avait comme une division de travail: les métaux précieux pour les juifs, la marqueterie du bois de thya pour les musulmans. L’unique marqueteur juif d’Essaouira selon mon père, s’appelait David El Qayèm (son nom de famille signifie en arabe le « redressé »). C'était aussi un calligraphe qui déssinait les actes de mariage et un connaisseur de la ala andalouse qu'on venait consulter de loin pour les modes musicaux disparus.

Atelier d'orfèvres, le fameux "daj souiri"
Evoquer le travail des métaux précieux Haïm Zafrani, qui a enseigné longtemps à Mogador et sa région avant de s’établir en France, écrit à sujet : « Dans la division du travail qui semble s’être instauré, de longue date, entre artisans juifs et musulmans, certains métiers sont traditionnellement reservés aux juifs particulièrement ceux où l’on manipule le plus de matière de valeur : or, argent, pierres précieuses et perles fines. »
Nessim Loeub était en réalité « Chkâ’yrî » (bailleur de fonds) en métaux précieux. Il faisait travailler les artisans bijoutiers grâce à ses capitaux. Il y en avait deux sortes : les dhaybya qui travaillaient l’or, et les syagha qui travaillaient l’argent.
Même lalla, notre marraine, habile cuisinière, participait aux préparatifs. Finalement cette visite royale n’a jamais pu avoir lieu puis que feu Mohamed V fut appelé au chevet des sinistrés du tremblement de terre qui frappa Agadir à vingt trois heures 40, le 20 février 1960. En dix secondes, les trois quarts de la ville sont détruits et 10 000 à 12000 personnes perdent la vie. Le poète berbère Ibn Ighil s’est fait l’écho de ce terrible tremblement de terre :
Agadir a été détruit, des milliers y sont enterrés
Quelle pitié ! Tous sont morts, aucun sauvé
Tous ceux qui y sont des tribus totalement anéanties
Ils n’ont pas atteint leurs buts, ils n’ont rien accompli
L’Arabe comme le berbère, personne n’a été épargné
Quiconque y est entré, n’en n’est plus sorti
Les juifs sont morts ce jour-là, les chrétiens aussi
Tout comme les musulmans maudits et ceux du droit chemin
Les enfants sont morts ce jour-là, les femmes aussi
Quelques mutins, tirés des décombres, gardaient encore leurs âmes
Ils espéraient se réveiller, reprendre conscience
D’autres tirés des décombres,en direction de la mort, l’eternelle....
L’onde de choque s’est propagée jusqu’au coeur d’ Essaouira, à plus de 170 kms au nord de l’épicentre du séisme. Arraché à son profond sommeil, mon père avait cru que le vacillement de notre vieille maison était dû à la violance du vent. Ne sachant pas ce qui lui arrivait, il s’est levé , tatonnant dans l’obscurité, en répétant :
- lbard ! lberd ! lberd ! (Le vent ! Le vent ! Le vent ! ).
Pendant plusieurs nuits de suite les gens ont dormi dehors : nous passions la nuit à la belle étoile,avec nos voisins, au marché aux grains ! De surcroît le désastre est survenu le jour de l’Aïd El Kébir,si ma mémoire est bonne : c’est cela « le déluge un jour de fête » dont parlait le Mejdoub !

La conception mentale est toujours plus rapide que la maîtrise gestuelle et le maître est justement celui qui est parvenu à transmettre de l’intelligence à ses gestes. L’apprentissage avec ses rites d’initiation qui ponctuaient le passage du statut d’apprenti à celui de compagnon et, enfin, de maître, visait cette pleinitude du geste où la main devient « pensée ».
Les marqueteurs d’Essouira

Maâlem Tahar Mana, dans son atelier de la Scala .
« La forme du bois est changée si l’on en fait une table. Néonmoins,la table reste bois, une chose ordinaire et qui tombe sous les sens. Mais dés qu’elle se présente comme marchandise, c’est une tout autre affaire. A la fois saisissable et insaisissable, il ne lui suffit pas de poser ses pieds sur le sol, elle se dresse pour ainsi dire sur sa tête de bois, en face des autres marchandises et se livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser ». Karl Marx
Le négociant Touf El Âzz, dont nous avons hérité de la maison, faisait partie des actionnaires du voilier « Le Prophète », qui rapatria le cercueil du consul vers l’Allemagne. Et Abdessalam, le tuteur de mon père, avait vu partir le cercueil du consul d’Allemagne du port de Mogadors. Car il était l’une des sentinelles du port ou s’amoncelait les marchandises en partance vers l’Europe : blé, amandes, caroubes, plumes d’autruches, gomme de sardanac etc. Une nuit, le chef de la patrouille du port l’a interpellé ainsi en plein sommeil :
- Alors Abdessalam !
Et lui de répondre en sursautant :
- La gâchette est à mi-pente !
Depuis lors, on surnomma notre famille « Nass Talaâ » (mi-pente).
D’un précédent mariage, Mina, ma grand-mère paternelle avait eu le coléreux poissonnier Omar, le demi-frère de mon père. Son père s’appelait Ahmed et il était originaire d’une famille tunisienne du nom de « Mana ». Un jour, après avoir fait le marché, il entendit du vestibule, le chant des chikhate à l’étage : il déposa alors son couffin et revint sur ses pas au port où il embarqua vers une destinée inconnue. Des années plus tard il revint à Sidi Mogdoul, saint patron de la ville, et de là demanda à voir Omar son fils : on se refusa à se plier à sa volonté de peur qu’il n’enlève l’enfant. Depuis lors, on ne l’a plus revu, mais il nous a laissé le nom de famille « Mana » plus élégant à porter que celui de « Nass Talaâ » (Mi-pente).

Le transit de personnes et de biens de la Méditerranée et pour le pèlerinage à la Mecque était, à cette époque, affaire courante . Il prolangeait un commerce caravanier important qui reliait Mogador au Sahara jusqu’au bord du Sénégal et du Niger.
Deux ans après la défaite retentissante de la bataille d’Isly et des bombardements de Tanger et de Mogador,soit 1846, le caïd, El Haj Abdellah Ou Bihi qui commandait une grande partie de la confédération des Haha, et dominait la plaine du Sous au nom du Makhzen, aurait obtenu du sultan Moulay Abderrahman, l’autorisation d’effectuer le pèlerinage à la Mecque en embarquant du port de Mogador par où transitaient les pèlerins à l'allée comme au retour :
« Le 25 chaâbane 1271 de l’hégire (1846), El Haj Abdellah Ou Bihi embarqua dans un babbor (vaisseau) qui lui était propre. Il y transporta, à ses propres frais, toute une compagnie de gens d’Essaouira et de Haha. Après le pèlerinage, il effectua une tournée au Hidjaz, y achetant des propriétés, dont il fit couler les eaux, avant de les léguer toutes en main morte aux deux Lieux Saints. Dépensant des sommes considérables, il fit aumône aux pauvres et aux handicapés. Après une absence de près de trois années, il accosta à Essaouira, le lundi 14 rajeb1274/1849, avec sa nombreuse suite,. Le pèlerinage à la Mecque ayant agrandi son prestige et sa réputation. »
Porte de la Marine - Clichet Garaud, 1913
Barcasses reliant les navires au large à la porte de la Marine Clichet Garaud, 1913
C'est du port de Mogador que Ma el-Aynine s’est embarqué, le 17 novembre 1906 pour Cap Juby, avec une partie de sa suite, un chargement de madriers de thuya destiné à la toiture de sa mosquée de Smara, ainsi que ses bagages entiers, ses meilleurs mulets, chevaux, chameaux etc. Une véritable arch de Noé ! Un paquebot espagnol a amené les hommes bleus, au Cap Juby, où il les a débarqué. Ils ont regagné par mer Terfaya, puis delà à dos de chameau, la ville de Smara.
« Le fils de Ma el-Aynine est resté à Mogador avec 50 hommes, soulignent les renseignements coloniaux de 1906. Il attend le complément d’une somme de 85 000 francs que son père devait recevoir à Marrakech. On assure que le sorcier-marabout veut construire un fort à Smara pour se protéger contre une incursion possible des troupes sahariennes françaises... »
En 1906, les renseignements coloniaux rapportent que « les nègres de la suite de Ma el-Aïnin, ont molesté un certain nombre de boutiquiers marocains avant de quitter Mogador. Le passage du grand marabout saharien a ruiné Mogador, qui s’était astreinte, suivant les instructions formelles du sultan, à dépenser chaque jour 1500 pesetas pour subvenir à l’entretien des « hommes bleus ». Il est de plus en plus admis que les voyages annuels de Ma-el-Aïnine aux provinces du Nord ont un caractère purement commercial, auquel les tendances religieuses ne s’adjoignent que comme accessoire. Le vrai motif de ces déplacements réside dans un rôle de pourvoyeur de negresses à la cour du sultan et chez les grands du Makhzen. En fait Ma el-Aïnine remonte toutes les maisons des gros notables marocains, sans oublier la maison de Moulay Abd el-Aziz. »
Je viens d’avoir de ma tante maternelle toujours vivante, les précisions suivantes : en fait c’est le père d’Abdessalam — qui portait le nom de « Hajoub Nass Talaâ » (Hajoub « mi-pente ») qui était la véritable sentinelle du port. De sa femme Zahra, il avait deux garçons : Abdessalam le marchand de farine de la minoterie Sandillon qui a élevé sévèrement mon père — il l’interpellait uniquement du surnom de « carross » (bghel) — et son frère Si Mohamed qui avait un jour embarqué sur un voilier en partance de Mogador pour ne plus revenir.
Tante Fatima me raconte aujourd’hui :
- Jusqu’à sa mort, la mère du disparu avait scruté l’horizon sous le vieux figuier de la porte de la marine, en espérant son retour à en devenir folle. Elle consultait souvent à ce sujet les voyantes : pouvaient-elles lui dire si, un jour, son fils allait revenir avant sa propre mort ?

Ma grand-mère paternelle Mina serait morte en 1919 de la diphtérie, affection qu’on appelait « Hnicha » (serpentine), qui tue par étouffement au niveau de la gorge. Mon père n’avait alors que dix ans, quand sur son lit de mort elle le confia à Abdessalam, le fils aîné de sa sœur, en ces termes :
- Tahar, mon fils est orphelin du père et bientôt il le sera de mère : il n’a que faire du cléricalisme, il faut lui trouver un travail manuel pour vivre.
C’est ainsi qu’Abdessalam allait confier mon père à l’un des premiers marqueteurs d’Essaouira : c’était juste à la fin de la première guerre mondiale. Ce maître confectionnait service de thé et cross de fusils en bois de noyer incrustés d’ivoire, pourla Maisonroyale et les consuls de la ville, comme en témoigne mon père dans un enregistrement de 1980 :
« L’un des pionniers de la marqueterie fut le cheikh Brik. Il était le maître de Hâjj Mad, mon initiateur à ce métier. Le père de ce dernier le voyant un jour traverser l’artère des forgerons, au retour d’une partie de chasse, en compagnie d’un autre chasseur, avec leur tenue de chasse et leurs sloughis, s’exclama :
- Et dire que je voulais en faire un clerc ! Le voilà qui traîne maintenant des sloughis derrière lui ! Que faire ?

Haddada,l'artère des forgerons en 1912

Les caravanes arrivaient à Haddada
Quelques jours plus tard, il le retira de l’école coranique, et le confia à cheikh Brik, pour qu’il apprenne le métier. Le jeune apprenti qui avait vu auparavant, en passant devant l’atelier, cheikh Brik, en train d’administrer une fessée à un apprenti, sur le madrier, fit tout pour ne pas mériter le même châtiment. Mais il ne fut jamais puni, pour la simple raison, qu’en tant qu’ancien étudiant d’école coranique ; il s’était rendu indispensable, en déchiffrant les missives que son maître recevait dela Maisonroyale. Ce dernier confectionnait des coffrets ornés de nacre, des services de thé, et des crosses à fusils en bois de noyer, aussi bien pourla Maisonroyale que pour les consuls qui vivaient alors à Essaouira. Je me souviens d’une réception que m’avait accordée le pacha de la ville, dans les années 1930, pour me demander de reproduire en thuya, ces anciens modèles en noyer. Il me disait alors que ces ustensiles appartenaient au sultan Moulay Abdelaziz. Au début la marqueterie se faisait au feu qui laisse des traces noires — semblables à l’encre de Chine — qui restent pour toujours. »
Des traces qui restent pour toujours : épreuve du feu, traces indélébiles, tel est le désir d’éternité, qui habite tout créateur.C’est pour nous les vivants que cette mémoire est importante, si tant soit peu que le deuil soit possible… Je ne sais plus, pour ma part, quel penseur grec avait donné cette définition de la mort : quand je suis là, elle n’est pas là, et quand elle est là, je ne suis pas là. Une consolation ? Peut-être. Mais les blessures de l’âme, l’absence de l’aimé, qui peut les soigner ? Cette éternelle quête du sens ?

La barchla de Sidi Mogdoul le saint patron de la ville
Bien avant l’apparition de la marqueterie, ses fondateurs étaient ceux-là même qui ornaient les toits des mosquées et ceux des demeures caïdales, et qu’on appelait les Brachlia. Mon arrière-grand-père paternel était de ceux-là. Il avait effectué à au moins deux reprises le pèlerinage à La Mecque à pied. À son retour au pays Chiadmi, trouvant sa maison dévastée, il était allé se réfugier dans la tribu voisine où on lui accorda femme, bergerie et terre à labourer. C’est là que naquit mon grand – père paternel, qui sera cordonnier de son état et qui mourra assassiné sur une plage déserte entre Essaouira et Safi, attaqué probablement par des coupeurs de route, qui lui enviaient sa charge de babouches. Mais sa disparition demeure toujours un mystère. Son père Hâjj Thami le Marrakchi, aurait été non seulement un paysan et un pèlerin, mais aussi un Brachliade Marrakech, c’est-à-dire un décorateur des toitures en bois peint ; il aurait été le décorateur de la toiture de Sidi Mogdoul, le saint patron d’Essaouira.
Peinture sur bois du mokhazni Bentajer
Peinture sur bois du ferailleur,Asman Mustapha
L'apparition de la galerie Frederic Damgaard au début des années 1980,a favorisé l'éclosion de talents d'autodidactes qui font éclater les formes traditionnelles de l'esthétique, tout en s'en inspirant comme on le voit dans ce tableau
La peinture avait donc précèdé l’incrustation du bois. Alors que les dessins géométriques sont incontestablement d’inspiration islamique, le recours aux rinceaux (ou Tasjir) est d’inspration occidentale comme l’indique son autre nom Ârq Aâjam (racine chrétienne). Ce dernier modèle s’inspire de la nature dont l’Islam prohibe l’imitation. Quant aux motifs ornementeaux, ils résultent d’une créativité locale : la marqueterie est donc la synthèse obtenue par des générations d’artisans, à partir de la combinaison de modèle d’emprunts et de créativité locale.
Sur la table circulaire du marqueteur, comme dans la voûte intérieur d’une coupôle peinte par un Barchliya, tous les dessins sont organisés autour d’un noyau central et se basent essentiellement sur le principe de la symétrie. Une khotta (dessin géométrique) , rayonne à partir du centre et se caractérise par le nombre de rayons dits Isftown dans le jargon de la corporation des marquéteurs d’Essaouira, et l’espace entre deux rayons est dit Kandil (lanterne). On peut définir la Khotta – peinte par mon arrière grand père le Brachliya, puis incrustée par mon père le doyen des marquéteurs – comme étant un cercle formé de deux ou plusieurs carrés en rotation autour d’un même centre, dont chaque angle est traversé par deux rayons parallèles. Nous avons au total quatorze Khotta possible de la plus simple (l’hexagonale) à la plus complexe ( la Stinia) qui donne son nom au château du Glaoui à Marrakech. On retrouve là tous les chiffres magique rencontrés chez les Regraga : les quatre point cardinaux du carré magique, la forme circulaire du cycle temporel, comme me le disait souvent mon père :
Le temps tourne pour ceux qui obéissent comme pour ceux qui se révoltent
A lui, seuls les ignorants se fient,
Combien de peuples y ont vécu dans le bonheur et l’insouciance
Et un jour, il les a poignardés sans poignard !
C’était un véritable rite d’initiation que le passage du statut de compagnon à celui de maître. A cette occasion se réunissait un conseil : l’Amine avec ses deux conseillers, le compagnon candidat et son ex-maître. On ne se cotentait pas des jugements qu’émettait ce dernier à l’égard de son disciple, on procédait à un examen municieux des ouvrages fabriqués par le candidat. On se renseignait sur sa moralité, le fameux Maâkoul.Ce n’est que lorsque ces conditions étaient requises que le titre de MAÎTRE, qui confère en même temps le droit d’ouvrir un atelier autonaume, lui fût atribué. On pourrait penser que ce système rigoureux était lié à l’intérêt qu’avait la corporation de limiter les candidatures possibles. Il était plutôt choisi pour une grande part par la qualité des ouvrages qui se faisaient naguère. La conception mentale est toujours plus rapide que la maîtrise gestuelle et le maître est justement celui qui est parvenu à transmettre de l’intelligence à ses gestes. L’apprentissage avec ses rites d’initiation qui ponctuaient le passage du statut d’apprenti à celui de compagnon et, enfin, de maître, visait cette pleinitude du geste où la main devient « pensée ».

Le premier maître de mon père fut Abdelkader El Eulj, un originaire d’Andalousie : il aurait sauvegardé la clé de la maison de ses ancêtres de Cordoue. Celle-ci était transmise de génération en génération dans l’improbable espoir de retrouver un jour le paradis perdu de l’Andalousie musulmane ! Et l’on dit que si la progéniture d’Abdelkader El Eulj, était mulâtre, c’est parce que lui, l’Andalou au blanc immaculé, s’était marié avec une esclave du fait que sa femme blanche était stérile.
Abdessalam, le tuteur de mon père disait à son maître en marquetterie :
-- Vous avez droit de vie et de mort sur ce garçon : si vous le tuez, nous sommes là pour fournir le linceul !
Un jour qu’il était aller chercher de l’eau à la fontaine publique pour son maître, celui-ci lui fracassa la cruche remplie d’eau sur la tête pour cause de retard.
Après cet incident, mon père a dû rejoindre un autre maître du nom de Hâjj Mad, enterré à la zaouïa de Moulay Abdelkader Jilali, où avait eu lieu la cérémonie funéraire au quarantième jour du décès de mon père, et où le fils d’Allam -le nachâr (scieur de madriers à la coopérative des marqueteurs)- avait distribué en guise d’hommage à l’assistance, la fiche artisanale de mon père.
Hâjj Mad était à la fois marqueteur et marchand d’esclaves : sur les terrasses de la ville, on enduisait au henné le corps d’ébène des jeunes esclaves, pour les rendre « luisants » et « attrayants », afin de les vendre à un prix avantageux dans l’actuel marché aux grains (Rahba). Un jour Hâjj Mad voulu ausculter la dentition de l’un d’entre eux, et sans crier gare, celui-ci lui mordit la main jusqu’à l’os ! Maâlam Mahmoud Akherraz, le sacrificateur des Gnaoua qui vient de disparaître presque centenaire me confirmait ces faits :
« Un jour, je devais avoir entre huit et dix ans, je vis un esclave mordre le doigt d’un marchand qui l’avait introduit dans sa bouche pour examiner sa denture.Cela se passait vers 1920. Mon oncle maternel fut acheté au prix de soixante rials, à l’époque du caïd khobbane. Toutes les familles aisées de la ville avaient des servantes noires, les khdem, et des esclaves mâles, les abid. Dans ma jeunesse, les Noirs autour de moi parlaient un dialect africain que je ne comprenais pas. D’ailleurs, je ne comprends pas non plus certaines paroles des chants gnaoua. »
Mon père accompagnait son maître Hâjj Mad aux veillées religieuses, en tenant d’une main l’ampleur de son burnous et de l’autre une lampe à huile d’olive, pour éclairer les sombres et tortueuses ruelles d’Essaouira d’alors. Il l’escorta ainsi à un mariage qui se tenait au Riad du négociant Hâjj Fayri ; où des musiciennes femmes étaient accompagnées d’un luthiste aveugle : Le musicien devait être toujours aveugle pour ne pas être ébloui par le charme satanique des femmes !
L’atelier où travaillait mon père respire à la fois la forêt du mont Amsiten que nous avons aimé ensemble par d’innombrables balades philosophiques, où l’adolescent que j’étais assaillait de questions le maître à penser qu’il fut pour moi : un artisan capable d’évoquer à la fois Al Maârri, le poète aveugle, mais ô combien clairvoyant, Al Ghazali surnommé « preuve de l’Islam », et Socrate faisant face avec courage et dignité au breuvage à la ciguë… On avait aménagé les ateliers des marqueteurs dans ce qui tenait lieu de dépôt de canons et de munitions : devant chaque atelier, un anneau de fer où était attaché le cheval qui tirait le vieux canon jusqu’en haut de la rampe qui fait face à l’ennemi venu de l’océan des ténèbre.

De gauche à droite: Maâlem M'barek, le directeur français de la coopérative des marquéteurs d'Essaouira qui a pris la relève de Mr Dejardin à l'indépendance, maâlem omar Ould Moul L'fakher, Si Mohamed BEN M'barek, dit "lamine", l'un des marqueteurs les plus raffiné de la ville et maâlem Tahar Mana jaugeant un madrier (Gayza).Les années 1950

La porte d'accès à la Scala de la mer, Roman Lazarev
Dans mes souvenirs d’enfance, lorsque j’accompagnais mon père à la coopérative des marqueteurs, c’était toujours le père du sculpteur Allam, qui l’accueillait pour scier ses madriers de thuya sous les arcades et les bananiers. La coopérative est située au noyau primitif de la ville, là où résidaient les amines (contrôleurs) de la douane : à son entrée, on pouvait encore voir, il y a quelques années, les mangeoires où les amines du port attachaient leurs chevaux au retour de la porte de la marine, par où transitaient les marchandises de la terre à la mer et de la mar à la terre.
De la coopérative des marqueteurs me revient surtout le souvenir de la fête de mars, qu’organisait la corporation, avec comme vedette Abibou le chantre du Malhûn local, boulanger de son état, célèbre surtout par sa petite taille et son humour caustique : il ne pouvait pas ouvrir la bouche sans provoquer l’hilarité universelle.
Je vois encore « BaghiTagine » (désir- de – tagine), décédé récemment, interpeller de l’estrade maâlam Tahar Mana, en le surnommant le « rossignol de la corporation », probablement pour l’habileté de son art puisqu’il n’avait pas une voix de ténor.
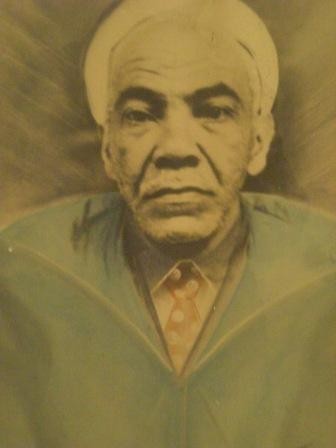
Le légendaire maâlem Abdellah Abibou, grand ami de mon père devant l'éternel.Ce dessin a été réalisé à Casablanca, par un certain Albert(déssinateur de rue).le 25 décembre 1966, d'après une photo d'identité de l'interréssé, décédé à l'âge de 86 ans, en 1962, puisqu'il était né en 1876.«Li bgha ibarraâ hbibou, iâtih khobz Abibou ! »(Celui qui désire faire plaisir à son bien aimé qu’il lui offre le pain d’Abibou ) .Il possédait plusieurs fours publics de la médina : son pain était réputé parce qu’il le pétrissait de la farine émmaculée de Marrakech..De la coopérative des marqueteurs me revient surtout le souvenir de la fête de mars, qu'organisait la corporation, avec comme vedette Abibou le chantre du Malhûn local, boulanger de son état, célèbre surtout par sa petite taille et son humour caustique : il ne pouvait pas ouvrir la bouche sans provoquer l'hilarité universelle.Je vois encore « BaghiTagine » (désir- de - tagine), décédé récemment, interpeller de l'estrade maâlam Tahar Mana, en le surnommant le « rossignol de la corporation», probablement pour l'habileté de son art puisqu'il n'avait pas une voix de ténor. Maâlem Abdellah Abibou était l'un des plus grands connaisseurs du Malhun de la ville et du Maroc.Il était aussi connu par son humour costique. Son trésor de qasida demalhun (khazna), se trouvait caché dans une vieille valise, qui contenait 47 manuscrits de Malhun, ainsi que trois parchemins en cuire contenant chacun une qasida du genre malhun composé de son propre crû: l'une d'entre elle était dédiée à sa campgne Saâdia, la deuxième s'intitulait Sidi Yacine, le saint patron situé au bord de l'oued Ksob, non loin de Ghazoua. Et la troiième qasida , il l'avait composé en l'honneur du fils du tanneur Carel, à l'occasion de son anniversaire. Il avait tout le temps sur lui une taârija(tambourin) enduite de henné, dont il se servait pour déclamer les qasida du malhun. C'était un buveur impénitent, un bon vivant qui appréciait, la fine fleur du kif (on a sauvegarder sa pipe de kif jusqu'à une période récente), mais quand la "Sjia"(l'inspiration) était là, il n'écrivait pas lui-même la qasida, mais la dictait à son élève le bazariste et antiquaire Miloud Ben Ahmed Ben Miloud, dit "Ben Miloud " tout simplement.
Trace de marqueterie de mon père
Et maintenant le fils d’Allam me soumet une fiche technique sur mon père du temps du Protectorat. Cette fiche artisanale est établie par le directeur français de la coopérative le 15 juin 1951. Mon père avait alors 41 ans, ce qui veut dire qu’il était né, non pas en 1912, comme nous croyons jusqu’ici, mais en 1910. Il serait rentré à la corporation en 1920, à l’âge de 10 ans.Mon père fut d’abord apprenti, puis compagnon, avant de devenir lui-même maître artisan en 1936 avec son propre atelier — 24 m² . Il y disposait d’une caisse à gabaris (les Bratels) qu’il ressortait à l’occasion ; ce sont ses aides – mémoires techniques en quelque sorte.
Dessins floreaux de mon père
Les encouragement materiels et moreaux, le prestige dont jouissait maâlam Tahar, faisaient de lui un artiste. Sachant que son travail était apprécié à sa juste valeur il le faisait avec patience et amour. Il travaillait même la nuit, non pas comme aujourd’hui sous la pression du besoin, mais afin de retrouver l’isolement propice à l’inspiration. Il était, disait-il, à la recherche de sa Gana, l’état où l’esprit est possesseur de toutes ses facultés.Perfectionniste il l’était pour mériter de plein droit le titre de maâlam(maître) dont on l’affublait. Pour lui, la beauté n’était rien d’autre que l’équilibre parfait. Il s’opposait à l’artisan de la campagne qui n’était pas comme lui à la recherche de la finesse des formes, mais à celle de sa gourmandise et de sa vitalité naturelle.
Motif géométrique de mon père
Quand je me rendais, enfant, à l’atelier de mon père, j’étais surtout fasciné par l’odeur des bois que décrit avec minutie cette fiche artisanale de 1951 : il avait40 kgde loupe (racine de thuya) à 15 fr.le kg, 30 madriers de bois de thuya, à150 Fle madrier, trois morceaux de5 kgde citronnier en provenance de Chichaoua, cinq rondins d’ébène (Taddoute) à200 Fle rondin,1 litrevenant du pays haha ; 40 boites de colle forte, et2 litresd’alcool.
Telle est la matière première avec laquelle travaillait mon père. La fiche artisanale établie par Mr.Bouyou directeur de la coopérative des marqueteurs alors, précise aussi son outillage — avec la mention « insuffisant » : 4 établis, 2 varlopes, 4 marteaux, 4 ciseaux, 2 tenailles, 3 rabots, 3 serre-joints, 1 drille, 3 scies, 2 rabots à dents.
À partir de 1938 mon père était considéré comme maâlam (maître artisan), puisqu’il avait pour exécuter ses créations un « sanaâ » (compagnon) et un apprenti « matâllam » : son salaire hebdomadaire passait de20 F en 1938 à500 F en 1951. La fiche artisanale mentionne que le loyer de son atelier était de210 F le trimestre et qu’il payait annuellement une patente de570 F.
Louzani, l’entraîneur national souiri né en 1942, me dit aujourd’hui que pour évaluer le véritable revenu de ton père alors, il faut savoir qu’au début des années 1950 le prix d’un kilo de mouton valait un dirham, et la consommation du poisson était quasiment gratuite pour les habitants de la ville. Mon père pouvait alors non seulement prendre en charge ses enfants — en 1951, notre aîné Abdelhamid venait de naître, et nous autres ses frères et sœurs nous n’étions pas encore de ce monde — mais aussi ceux de son demi-frère aîné Omar le poissonnier coléreux. Dans les ruelles étroites de la ville, on pouvait alors entendre les enfants chanter :
S’il n’y a pas de koumira ? Al- sardila !
S’il n’y a pas de sardila ? Al-koumira !
Autrement dit ; s’il n’y a pas de koumira,(baguette de pain), il y aura toujours la sardila (sardine), et vise versa.
 Marchand de baignés et marchandes de pain à khobbaza
Marchand de baignés et marchandes de pain à khobbaza
L’intérêt des artisans était lié à la bonne réputation de leur marchandise, d’où la nécessité d’une réglementation décidée plutôt par le corps de métier, qu’imposée de l’extérieur. Entouré de deux conseillés, l’AMINE intervenait selon la coutume pour résoudre trois sortes de conflits :
-Le conflit entre les artisans (un artisan n’avait pas le droit de séduire par l’attrait du gain, les compagnons de ses confrères, bénéficiant ainsi d’une formation à laquelle il n’avait nullement contribué).
- Entre artisans et bazaristes (la contrefaçon de modèles était prohibée si bien que chaque atlier se distinguait par la nature de ses ouvrages).
- Entre artisans et clients (chaque artisan avait son garant : son ex-maître, au cas où il n’honorait pas un contrat).
L'atelier où Bungal avait réuni plusieurs marqueteurs dans les années 1930
Le témoignage de maâlem Mtirek,sur le samaâ judéo - musulman d'Essaouira : Le mercredi 13 janvier 2010, vers la mi-journée (journée brumeuse mais lumineuse) alors que je prenais un thé à la menthe à la terrasse du café Bachir qui donne sur la mer, je vois venir sur une chaise roulante, maâlem Mtirek, ami à mon père. Il est presque centenaire maintenant, mais sa mémoire reste vivace. Il se souvient de la veillée funèbre du 13 janvier 2003, organisée à la Zaouia de Moulay Abdelkader Jilali pour le quarantième jour du décès de mon père : « C'est là, me dit-il, qu'est enterré maâlem Mad, le maître artisan de ton père. Après avoir accompli son apprentissage auprès de lui, ton père était venu travailler chez Bungal dans les années 1930. Mon établi ( manjra), le sien et celui de Ba Antar étaient mitoyens. Un jour, je me suis mis à déclamer des mawal (oratorios) . Une fois apaisé de mon extase, ton père qui écoutait à l'entrée de l'atelier est venu vers moi pour me dire sur le ton de la plaisanterie :
- Maâlem ! Laisse les gens travailler au lieu de les extasier par ton mawal ! le chantier s'est arrêté à cause de tes mawal !
C'est ce mawal que je déclamais alors sur le mode de la Sika andalouse :
Ya Mawlay koun li wahdi,Li annani laka wahdaka
Wa biqalbika îndi,Min Jamâlikoum
la yandourou illa siwaakoum
Seigneur, soit pour moi tout seul
Parce que c'est à toi seul que je me suis dévoué !
Et mon cœur n'a plus de regards que pour ta splendeur !
A l'époque , poursuit maâlem Mtirek, tout le monde était mordu de mawal à Essaouira : le vendredi on allait animer des séances de samaâ, d'une zaouia, l'autre : la kettaniya, la darkaouiya, celle des Ghazaoua et celle de Moulay Abdelkader Jilali. Les Aïssaoua et les Hamadcha faisaient de même avec leur dhikr et leur hadhra à base de hautbois et d'instruments de percussion. On allait aussi chez les Gnaoua dont la zaouia était dirigée par El Kabrane (le caporal), un ancien militaire noir, qui parlait sénégalais et qui gardait l'hôpital du temps du docteur Bouvret. C'était un type très physique qui servait en même temps de videur lors des lila des Gnaoua : si quelqu'un sentait l'alcool en arrivant à la zaouia de Sidna Boulal ; il le prenait à bras le corps comme un simple poulet et le jetait au loin, hors de l'enceinte sacrée. Les gens étaient véritablement « Ahl Allah» (des hommes ivres de Dieu). Nous avions notre propre orchestre de la musique andalouse, dont faisait partie Si Boujamaâ Aït Chelh, El Mahi, El Mamoune et un barbier .
L’apparition du BAZARISTE, intermédiaire nécessaire à l’artisan en période de crise et en saison morte, est la cause indirecte de la dispartion du système corporatif.Sa main mise sur le circuit commercial et sa concurrence déloyale sont générateurs de déséquilibres rendant caduque la discipline corporative. Pour survivre l’artisan est contraint de prendre des « avances » auprès du bazariste, alors que le produit n’est pas encore fini, et donc de le vendre à vil prix, puisqu’il ne peut pas attendre l’arrivée du client potentiel. En effet, avec la crise et le tarissement de la clientèle touristique nombre d’artisans ont été contraints, durant les années 1930, de subir la tutelle des bazaristes. Pour la première fois, ils furent assemblés par dizaine, pour produire dans une même manufacture, celle de Bungal. Ce « bailleur de fonds » (chkâ’yrî), prenait les commandes auprès des européens et les faisait exécuter par les artisans réunis dans sa manufacture. C’est ainsi qu’il fit éxécuter à mon père une scala miniature, qui fut exposée des années durant au syndicat d’initiative, avant de finir en morceaux, aux fourrières de la ville.

Maâlem Tahar Mana avec la médaille du mérite de l'artisan
Mais, dés que la crise cessa, cette manufacture s’évanouit aussi promptement qu’elle était apparue, et chaque artisan retrouva son autonomie. Ainsi, si le bazariste peut contrôler durablement le circuit commercial, il ne peut en faire autant pour la production, puisque l’artisan tend à être soudé à ses moyens de production comme l’escargot à sa coquille. Lorsque l’artisan vendait lui-même son propre ouvrage, il savait que sa réputation tenait à la qualité de ce qu’il produisait. Mais lorsqu’il fut obligé de passer par le bazariste, sa créativité s’émoussa, car ce dernier pouvait transmettre son modèle à d’autres artisans qui alors en faisaient des contre-façons. Par ailleurs la transmission intergénérationnelle du savoir artisanal devient de plus en plus défaillante : la pression des besoins fait que l’appreti se détache le plutôt possible de son maître alors qu’il n’a pas encore accompli tout le cycle d’apprentissage. C’est ainsi qu’on trouve actuellement des ateliers qui produisent exclusivement un seul article. Le jeune artisan complètement dépendant du bazariste est souvent condamné à vivre dans la marginalité et le célibat, comme le vieil artisan est condamné à mourir sur son outil de travail, à moin que sa descendance ne lui assure sa retraite.

Maâlem Tahar Mana avec médaille et Simohamed Lamine(lunettes noires) lors d'une Nzaha (pique - nique rituel des artisans) à l'ombre des amendiers en fleurs de l'Ourika dans les années 1950
Les corporations d’artisans constituait une très forte communauté unie dans le travail, la fête et, plus encore, l’épreuve. Ces membres se retouvaient dans le cadre de confréries religieuses et cette communion spirituelle renforçait la cohésion professionnelle. Pour leurs loisirs ils organisaient desNzaha, sorte de piques – niques rituels, à l’ombre des mimosas de Diabet, aux environs immédiats d’Essaouira. C’est dire que la société traditionnelle maintenait l’équilibre entre les lieux duMaâkoul (honnêteté, sérieux) qu’étaient l’Atelier et la Mosquée et les lieux du Mzah (ludique), qu’était par exemple à Essaouira, Derb Laâzara (le quartier des célibataires). Avant l’avènement des moyens de transport moderne, ils se tenaient campagnie pour se rendre à Marrakech, souvent leur ville d’origine, comme le montre cette qasida du malhun de Ben Sghir intitulée « Bent el Ârâar » (la sculpture de thuya).
Au début des années cinquante, le souvenir était encore vivace du tournage d’Othello par Orson Welles à Mogador. Le soir on le voyait souvent méditer sur la grande place du syndicat d’initiative. Dans le film, on reconnaît surtout « Tik-Tik » avec son luth au pied des remparts de la Scala de la mer. « Tik-Tik » est mort récemment en ivrogne à la vieille impasse d’Adouar qu’évoque en ces termes le rzoun, vieux chant de la ville :
Ô toi qui s’en vas vers Adouar
Emporte avec toi le Nouar
La rime est un jeu de mot entre « Adouar » (le nom de la sombre impasse supposée cacher les belles filles de la ville) et le « Nouar » (le bouquet de géranium et de basilic).
Entre les deux, l'atelier de mon père, en face du cinéma Scala, ancien consulat d'Allemagne
Mon père me racontait qu’un jour Orson Welles se présenta à son atelier alors qu’il était en train de terminer une magnifique table en bois d’arar, décoré de dessins géométriques complexes et de rinceaux d’inspiration andalouse. Quand mon père dit à Orson Welles le prix de la table en question, le cinéaste américain en fut offusqué :
- À ce prix-là, lui dit-il, je briserais cette table sur ma tête plutôt que de la vendre !
Et certains soirs d’hiver, quand il rentrait à la maison sans le sou, mon père nous regroupait, nous, ses enfants, autour de lui, et nous conviait à lire en sa compagniela Naçiriaoù le maître de Tamgroute incitait, les Marocains à résister à l’envahisseur portugais :
Faibles, nous sommes, mais par la grâce de Dieu, nous serons innombrables et puissants…
Je me souviens d’une journée noire des années 1970, où l’on m’apprit que la police avait conduit mon père au commissariat pour le contraindre à payer ses impôts. Heureusement qu’on finit par le relâcher en fin de journée : c’est la seule fois de toute sa vie où il eut affaire au Makhzen. Omar son demi-frère, était aussi allergique au Makhzen. On raconte qu’il s’était installé un jour à Souk –Jdid en plein centre-ville, en désignant aux passants la notice d’impôt qu’il venait de recevoir :
- Ayez pitié, disait-il du Makhzen ; donnez-lui un peu de cet argent qu’il me réclame : ce n’est pas moi qui mendie, mais le Makhzen !
Les Marocains ont toujours été réticents à payer l’impôt au pouvoir central : on ne voyait pas en quoi cela était justifié. La fameuse coupure entre le pays du Makhzen et le pays de la Siba(l’anarchie), était due aux jacqueries paysannes contre le tertib, cet impôt que le Makhzen prélevait sur le bétail et les moissons sans offrir quoi que ce soit en contrepartie à part ses expéditions punitives et ses petits despotes de caïds qu’il désignait à la tête des tribus.

L'intérieur de l'atelier de mon père où Simohamed, notre frère cadet a pris la relève : au 18 ème siècle ,ces ateliers servaient aux canoniers (tabjia) à y entreposer leurs boulets et canons. En face de chaque atelier, existait un anneau de fer où on attachait les chevaux qui tiraient ces canons en haut de la rampe de la Scala de la mer.
Tout à l’heure le peintre Zouzaf m’a convié à rejoindre Abdessadeq, ami de mon père et l’un des derniers marqueteurs d’Essaouira. Au quarantième jour de la mort de mon père, il m’avait fait écouter des enregistrements radio de mon père effectués au début des années quatre-vingts,c’est-à-dire à un moment où il fréquentait encore son atelier de la Scala, juste en face du vieux cinéma de la ville, actuellement fermé. Quand je quittais à l’entracte la salle obscure, la première silhouette que je voyais, les yeux encore éblouis, était celle de mon père sciant inlassablement le bois. Et combien de fois ne lui arrivait-il pas de revenir travailler jusqu’à tard la nuit juste pour que nous ne puissions manquer de rien. L’atelier où travaillait mon père respire à la fois la forêt du mont Amsiten que nous avons aimé ensemble par d’innombrables balades philosophiques, où l’adolescent que j’étais assaillait de questions le maître à penser qu’il fut pour moi : un artisan capable d’évoquer à la fois Al Maârri, le poète aveugle, mais ô combien clairvoyant, Al Ghazali surnommé « preuve de l’Islam », et Socrate faisant face avec courage et dignité au breuvage à la ciguë… On avait aménagé les ateliers des marqueteurs dans ce qui tenait lieu de dépôt de canons et de munitions : devant chaque atelier, un anneau de fer où était attaché le cheval qui tirait le vieux canon jusqu’en haut de la rampe qui fait face à l’ennemi venu de l’océan des ténèbre.
Le Barzakh
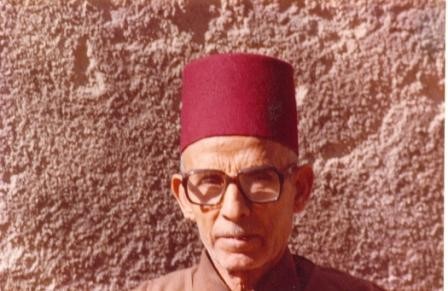
De tous ceux qui sont passés
Hélas, tu te souviens,
Tu connaîtras que la vie n’est rien qu’un chemin…
Chant de trouveur
Vendredi 13 décembre 2002. Il pleut. Vers onze heures du soir, mon père est pris de malaise. Comme d’habitude, ma sœur accourt à son chevet. Personne ne pouvait imaginer encore qu’il s’agit là de la visite de la mort. Je m’assoupis. Le lendemain, samedi 14, vers trois heures du matin, ma sœur m’appelle au chevet de mon père. Le moment est grave. Très affaibli, il parvient dans un souffle à prononcer le prénom qu’il m’avait donné : entre l’instant et l’éternité, nos yeux se croisent pour la dernière fois. Il demande à ma sœur de le soulever — « gaâdini » — pour le maintenir en position assise. Je dois chercher d’urgence notre frère aîné pour d’ultimes à dieux. Dehors, il fait sombre. Des chiens errants aboient. Pleurs et solitude. Au retour, à quatre heures du matin, notre père a rendu l’âme : il ne pouvait plus répondre aux appels désespérés d’Abdelhamid. Dans ma tête se confond le geste que j’ai fait pour fermer les yeux du doyen des marqueteurs d’Essaouira — maâlam Tahar, que Dieu l’ait en sa miséricorde — et celui de l’antique fauconnier des Doukkala qui couvre d’un chaperon le faucon de l’île de Mogador, cet oiseau libre — ce « teir hor » — cet oiseau sacré qui symbolise à la fois le dieu Horus des hiéroglyphes égyptiens, et le dieu de la mort et de l’amour, tel que l’avait représenté dans une ultime peinture notre regretté Boujemaâ Lakhdar, avec son faucon huppé, frappant un Herraz mystique et allant au-devant du sacrifice et de la mort.

Le bohémien de Boujamaâ Lakhdar (détail)
Ce dernier mois de l’année 2002, je devais écrire à la demande de M. Retnani mon éditeur — rencontré à « la croisée des chemins » — ce préambule à la réédition des Regraga, en tant que piste de recherche féconde aussi bien pour l’auteur que pour tous ceux qui ont marché sur ses pas. Le destin en a décidé autrement, et c’est finalement d’une prière de l’absent qu’il s’agit. Mon seul mérite, était d’avoir accompagné les Regraga, en tenant un journal de route, rendant visible ce qui était jusque-là « invisible », donnant existence spatio-temporelle à ce qui n’était connu que sous la forme de légendes. Et Comme le dit si bien un vieux dicton marocain : « Allez aux pèlerinages, vous brillez comme des fleurs, restez chez vous, vous serez comme une terre en friche ». En ce 14 décembre 2002, j’accompagne donc mon père à sa dernière demeure, alors que les plaines côtières sont couvertes de verdure lumineuse et précoce, exactement comme à l’aube des années 1980, lorsqu’il m’avait accompagné jusqu’à la porte des Doukkala, d’où je devais me rendre pour la première fois chez les Regraga.
La légende des sept saints regraga s’inscrit dans une vielle tradition méditerranéenne dont la source serait celle des Sept Dormants d’Ephèse en Turquie comme le soulignait en 1957 Louis Massignon : « En Islam, il s’agit avant tout de « vivre » la sourate XVIII du Qora’n, qui lie les VII dormants à Elie (khadir), maître de la direction spirituelle - et la résurrection des corps dont ils sont les hérauts, avant coureur du Mehdi, au seuil du jugement, avec la transfiguration des âmes, dont les règles de vie érémitiques issues d’Elie sont la clé. Ce culte a donc persisté en Islam, à la fois chez les Chiites et les Sunnites mystiques. »
En Bretagne, par où les sept saints Regraga, auraient passé à leur retour de La Mecque avant d’accoster par leur nef au port d’Agoz à l’embouchure de l’oued Tensift, Massignon notait :
« En Bretagne spécialement, le nombre des Sept Dormants raviva une très ancienne dévotion celtique au septénaire, seul nombre virginal dans la décade (Pythagore), chiffre archétypique du serment. On est tenté de penser que c’est une dévotion locale aux sept d’Ephèse, qui a précédé et provoqué les cultes locaux aux VII saints en Bretagne. »
Par-delà l’ethnographie d’Essaouira et sa région, mon père a été finalement mon initiateur à l’écriture.
J’écris ces lignes le vendredi, jour de la visite aux morts en ayant une très intense pensée pour mon père, et à ce propos la lecture des « sept serments aux morts » de Carl-Gustav Jung, en date de 1916, m’apporte un certain réconfort, dans la mesure où il y considère le Néant identique à la Plénitude :
« Dans l’infini, le plein ne se distingue pas du vide. Le Néant est vide et plein. Le Néant et la Plénitude, nous l’appelons Plérôme. Nous nous distinguons du Plérôme en tant que créature limitée dans le temps et l’espace ».
Il me plaît beaucoup de penser que ce « Plérôme » de Carl-Gustav Jung est l’équivalent du « Barzakh », cette station stellaire où, selon les musulmans, les âmes mortes reposent en attendant leur résurrection au jour du Jugement dernier. Et à mon sens c’est le refus d’être livré à la dissolution dans le néant qui explique la philosophie profonde des Regraga, qui contribuent à la résurrection du printemps après la mort hivernale exactement comme les Sept Dormants ont ressuscité après une longue dormition. Long voyage des hommes autour du printemps, long voyage de l’âme après la mort. Les prières augmentent les lumières des étoiles, et jettent un pont par-dessus la mort.
Selon la tradition musulmane, le Barzakh, est ce monde intermédiaire dans lequel, les morts doivent séjourner pendant quarante jours avant de connaître le sort que leur reserve Nakîr et Mounkar , les anges chargés de les interroger et d’émettre un jugement sur leur vie .Le Barzakh serait l’isthme qui relie les deux mondes. Dans deux pasages du Coran, il est question de deux mers, ou vaste étendue d’eau, l’une douce, l’autre salée, entre lesquel il y a un Barzakh qui les empêche de se confondre :
« Les gens de l’Isthme sont entre l’ici-bas et l’au-delà. Derrière eux, cependant, il y a le monde intermédiaire, pour jusqu’au jour où il seront ressuscités. » (XXIII, 100).
« Il a lâché les deux mers pour se rejoindre, avec entre elles deux un seuil à ne pas enfreindre. » (55, 17-18).
En eschatologie, le mot Barzakh est employé pour déigner la limite du monde humain, et sa séparation d’avec le monde des esprits purs et de Dieu.
Juste après sa mort, je voulais écrire un livre sur la marqueterie d’Essaouira en hommage à mon père Un ouvrage qui en sauvegarderait la mémoire. Une fois à Essaouira, je me rends au complexe artisanal de Bab Marrakech, où je rencontre le marqueteur Abdelkader El Himri, ami de mon père. Il me dit que mon père était très préoccupé par le devenir de la corporation des marqueteurs, et que les œuvres des grands maâlam, comme lui disparaissent avec leur auteur. D’un autre côté, il me signale qu’au début des années 1980, toutes les archives de la coopérative des marqueteurs, fondée le 10 octobre 1949, ont été victimes d’un incendie. C’est dire que le devoir de mémoire était devenu une urgence. .
Le moussem des Hamadcha

La quête aumônière des Hamadcha, d'après Roman Lazarev
La magie de la nuit appelle le silence, la communion du groupe appelle la hadhra (présence divine). Dans la zaouïa, on boit le thé à l’écoute d’une lira (frêle pipeau de roseau) qu’accompagne une voix couverte comme d’un voile invisible :
Gloire à Dieu et à toi océan de lumière !
Ô patron d’Ouazzane ne m’oublie pas !
Le doux intermède de la lira prépare la phase chaude du hautbois. Les musiciens sont aussi des artisans, d’où la communauté du jargon aux deux espaces artisanal et musical. La partition musicale qui rend la présence du surnaturel possible s’appelle mramma, ou métier à tisser. C’est une juxtaposition de phrases musicales tissées par le hautbois sur la trame constante des instruments de percussion : la réussite de la partition musicale dépend du champ magnétique qui s’établit entre l’orchestre et les danseurs de la place sacrée.
Hamdouchi, tourneur sur bois de son état, rencontré à Sidi Mogdoul, me dit en préparant sa pipe de kif :« Tout ce qui brûle au feu n’est pas impur. Jadis, on cachait le kif dans le tambour.Lemoqadem disait : « Fumez où bon vous semble, sauf dans la salle de prière. ».Nous gens du hal, nous avons besoin de fumer jusqu’à ce que nos yeux soient hors des orbites pour pouvoir chanter et faire monter le saken (l’habitant surnaturel) ».
Larbi Slith
En 1983, j’avais assisté au moussem des Hamadcha, en notant son déroulement au jour le jour :
Le 31 août 1983, 17 heures.

Des rumeurs musicales me parviennent de loin : c’est la procession des Hamadcha à Souk – Jdid. À mesure qu’on s’approche de la zaouïa, la musique devient frénétique. Après avoir franchi la porte sur la place du sacrifice et des danseurs sacrés, l’animal est encensé avec du benjoin (jaoui). Le public l’entoure et la musique continue. On fait tomber l’animal pour l’égorger, le public s’agite, la musique devient frénétique et les femmes sur la terrasse poussent des appels au Prophète et des youyous. C’est la première dbiha. La seconde aura lieu lorsque les taïfa invités seront là. Le moqaddem des Hamadcha (boucher de son état) aiguise son couteau en adressant un regard lointain vers le ciel. Il ordonne qu’on oriente la tête du taureau vers La Mecque. Puis, pieusement, d’un geste circulaire, il bénit l’assistance. En ce moment la musique parvient au sommet de la passion ; c’est le mode « daoui hali » (guéris-moi de ma transe), le moqaddem tranche la gorge du taureau. Lorsque les entrailles de l’animal sacrifié sont vidées la musique cesse brutalement.C’est la vente aux enchères, de certaines parties de l’animal, qui commence. D’abord les pieds antérieurs puis postérieurs. Quelqu’un dans l’assistance demande un morceau du cœur. On lui rappelle que le cœur a été envoyé pour la baraka du gouverneur. L’un des sympathisants des Hamadcha s’approche du moqadem pour lui rappeler qu’il faut aussi envoyer un peu de baraka sacrificielle au nouveau conseil municipal (Union Constitutionnelle.) qui a contribué cette année à la subvention du moussem et supprimé les quêtes aumonières.
Sadya Bayrou
À ce moment-là, une femme descend de la terrasse et fait irruption parmi les hommes. Vieille et pauvre, elle propose timidement trois dirhams pour avoir sa part du barouk . Celui qui dirige les enchères la regarde avec dédain et continue son travail. La rate est vendue 5 DH, puis un morceau de gorge rapporte 13 DH. La queue 18,50 DH et le sexe de l’animal 10,50 DH. Pour ce dernier morceau l’un des participants aux enchères commente : « Je ne l’achète pas en été, c’est un aliment chaud, valable surtout en hiver ».
« Les enchères ne sont pas tellement brillantes cette année », me dit un habitué des Hamadcha.
- Pourquoi ? lui dis-je.
- Parce qu’on a supprimé les quêtes dans les rues qui servaient aussi comme publicité au moussem.
Il y a peut-être d’autres raisons à cette désaffection. Dans la zaouïa des Hamadcha, on constate pour la première fois une floraison inhabituelle de drapeaux, entourant le portrait de Sidi Mohamed Ben Abdellah (le fondateur de la ville) qui symbolise ici l’association portant son nom et qui a donné naissance récemment à la section locale du nouveau parti (Union Constitutionnelle).
Un peu plus tard, le hautboïste Dabachi m’explique :
- La musique un peu triste qu’on a jouée tout à l’heure, c’est la Nouba du Rasd puis on a joué Qoddam Ârqâjam.
Khalili intervient pour préciser :
- Les paroles qui accompagnent la mise à mort du taureau commencent ainsi :
Ah que ma patience est limitée !
Et que mon corps et mon cœur sont épuisés !
Sadya Bayrou
Au moment de sortir les entrailles de l’animal, on avait joué Qoddam El Maya. Et à la fin de la Dbiha, les musiciens avaient entamé l’air joyeux du Haddari. Ce morceau de musique rituelle fait aussi partie du Saken des Aïssaoua où il accompagne le moment de la frissa (consommation rituelle de la viande crue chez les Aïssaoua).
On me dit que les quatre morceaux de musique andalouse qui accompagnent le sacrifice chez les Hamadcha sont joués dans d’autres rites de passage tels que ceux de la circoncision ou de la défloraison qui fait passer la mariée du statut de jeunes filles à celui de femme. Dans les trois rites de passage (moussem, circoncision, mariage) cette musique rituelle accompagne l’apparition dangereuse du sang.
1er septembre 1983 à 10 h 30.

J’ai interrogé tout à l’heure un Hamdouchi sur le pourquoi de la présence hier, dans le cortège, du drapeau bleu de Sidi Mohamed Ben Aïssa (de la confrérie des Aïssaoua). Il m’a répondu ceci :
« Sidi Mohamed Ben Aïssa est le cousin de Sidi Ali Ben Hamdouch ; et celui qui les séparerait aurait la chair dissociée de ses os ».
Ce lien est en réalité à interpréter à partir de la silsila (chaîne) mystique, pôle de l’Occident soufi auquel sont rattachées les deux confréries.
Les Dghoughiine disciples de Sidi Ahmed Dghoughi constituent la partie la plus violente de la confrérie et du rituel des Hamadcha. Ils se frappent et se mutilent avec des hachettes nomméesChakrya, avec des baguettes de bois fixées sur un cerceau de fer formant le h’mal et avec des boulets de canon nommés zerzbana. Ils sont, dans l’orchestre, ceux qui frappent le herraz. Leur étendard est rouge, couleur sang.
Le drapeau vert appartient aux Allaliyne disciples plus directs de Sidi Ali Ben Hamdouch. Ils sont, dans l’orchestre, les musiciens du hautbois (ghaïta) et dans la jedba, danse sacrée, les danseurs qui ne se frappent pas, ne se mutilent pas. Les Dghoughiyne se caractérisent ainsi par le fait de frapper (frapper sa tête ou le herraz) tandis que les Allaliyne se caractérisent par le souffle (souffler dans la ghaïta, souffler en dansant).
Au moment où les deux taïfas se rencontrent à Bab Doukkala elles jouent ensemble dans le modegharbaoui…
Les portes étendards d’Essaouira inclinent leurs drapeaux en signe de bienvenue. Puis les deux taïfa se dirigent vers la zaouïa. Quand ils sont proches de la zaouïa, ils commencent à jouer ce qu’ils appellent le zouak : c’est une phase intermédiaire où l’orchestre cherche un passage entre deux modes. En rentrant dans la zaouïa on joue Maâboud Allah (prière à Dieu). L’accueil se fait chaleureux, avec des embrassades fraternelles ; on offre aux invités les dattes et le lait traditionnels.
Nuit du 1er septembre.

Vendredi 2 septembre.
À 9 heures, ce matin, le cortège des Hamadcha se dirige par Bab Doukkala vers la résidence du gouverneur de la province d’Essaouira. En tête les quatre étendards. La taïfa d’Essaouira est suivie des taïfas de Taroudant, Safi,Marrakech,Tamazt, et Demnate. Ils avancent en dansant. Devant l’entrée de la résidence une taïfa danse en attendant la sortie de la taïfa d’Essaouira qui est reçue par le gouverneur.
La taïfa d’Essaouira sort un peu plus tard avec un taureau noir et un mouton pour un sacrifice. Vient ensuite le conseil municipal en tenue de cérémonie. L’atmosphère est vite surchauffée : youyous des femmes et musique de plus en plus accélérée des Hamadcha. Mais d’un signe cette musique cesse, et le silence succède au bruit. On récite publiquement avec le public, une prière.
À 10 h 15 le cortège s’ébranle en direction de la médina. En tête du cortège, un Gnaoui de Marrakech joue avec des couteaux qu’il passe sur sa langue et ses bras sans se blesser. Derrière ce Gnaoui vient le taureau noir, tenu à la corde par un Hamdouchi. Puis le mouton. Et les étendards. Suit le groupe des femmes Haddarate avec, à leur tête, la moqadma des Hamadcha portant un bol de henné dans lequel elle trompe son doigt de temps en temps pour mettre une marque au henné dans la paume de la main des croyants. Suivent les Dghoughiyne de Demnate. Leur moqadem m’explique qu’ils sont pour la plupart des forgerons et des fellahs :
- « Pour devenir Dghoughi me dit-il, il faut apporter à la zaouïa de Zerhoun une galette de seigle et une galette d’orge, puis dormir dans le sous-sol de cette zaouïa ». Durant cette séance d’incubation paraît dans le rêve soit Aïcha Qandicha démente de la mer soit le marabout en personne pour vous ordonner de vous fracasser la tête avec tel ou tel instrument rituel sans risque pour votre santé.
Au centre de la médina, au moment où la musique rituelle atteint son comble, l’un des Dghoughiest brusquement atteint d’une crise. Il se tord par terre en implorant qu’on lui donne immédiatement sa Chakriya (hachette). Le boucher qui porte dans son couffin ces instruments redoutables, lui en offre deux. Alors, il se lève, jette son turban par terre et sautillant – comme s’il a les deux pieds liés par une corde imaginaire – il se met au rytme musical à frapper le sommet de son crâne. Les yeux hagards, le visage ensanglanté ; il laisse sur son passage une traînée de gouttes de sang. Le public fasciné s’écarte sur son passage. Ses confrères lui arrachent ces instruments d’automutilation rituelle en déversent du jus de citron sur ses blessures. Les musiciens devancés par la course folle de tout à l’heure, s’approchent à nouveau et leur saken enflamme un autre Dghoughi. Il a l’air d’un vieux boucher de campagne : la barbiche blanche mais la tête forte. Il a le corps trapu et fort des montagnards berbères. Tenant deux h’mal – une dizaine de baguettes de bois, autour d’un cerceau de fer – il frappe le sol et menace le public pour qu’il s’écarte. Il tend l’oreille pour saisir le meilleur moment musical inducteur du surnaturel et de la transe.
2 septembre (suite). À 19 heures le soir.

Le ciel est encore du bleu du jour agonisant. On allume des bols de terre contenant de l’huile d’olive, des mèches, qui se trouvent au milieu de la place. Le Dghoughi de Demnnate se frappe la tête. Pour la première fois des gens du public tombent en transe. Un jeune homme de 18 ans perd le contrôle de ses gestes. Une autre jeune fille se roule par terre en pleurant. Elle retire son peignoir que prend sa sœur qui l’accompagne et qui paraît plus étonnée d’être parmi les hommes que de l’état de sa sœur. Un boucher me dit plus tard que la possession de cette fille cessera avec le mariage. Le public l’observe avec sympathie et compréhension. Non pas en tant que cas pathologique, mais en tant que personne en contact avec le surnaturel. La jeune fille s’effondre dès que la musique cesse. Le public se précipite autour d’elle. Dakki, le jeune hautboïste d’Essaouira leur dit :
« Eloignez-vous, elle n’a rien, c’est seulement le hal, apportez le brasero et l’encens… »
Après avoir respiré ce parfum, elle sort de sa transe et va se reposer.
Le 3 septembre 1983, 7 heures du soir.
Au centre du rituel : la démente de la mer. Déjà, hier soir, j’ai remarqué au milieu de la place sacrée plusieurs bols de poterie autour de l’égout. Ils contiennent de l’huile d’olive, du sucre, des œufs et autres produits magiques. Le soir on les allume.
- De quoi s’agit-il ?
Le Hamdouchi auquel je m’adresse me répond rapidement comme pour cacher une vérité honteuse :
- Ce sont les femmes qui déposent ces bols-là.
Je m’approche d’un groupe de Hamadcha et je leur demande des précisions sur le même sujet. J’obtiens successivement les réponses suivantes :
- On se sert des cendres qui restent pour les maladies de la peau.
- La personne qui a subi une injustice allume un bol pour que son ennemi se consume de la même manière.
- Ces lumières sont en offrande à Aïcha Qandicha qui habite l’égout et s’assouvit du sang sacrificiel. On lui fait cette offrande lumineuse pour l’empêcher de nuire aux danseurs de la place sacrée.
Je demande à un Marrakchi :
- Pourquoi dans votre taïfa il existe deux personnages qui se mutilent l’un au couteau l’autre au feu ?
- Tous deux sont des Gnaoua venus chez les Hamadcha par ordre d’Aïcha Qandicha. C’est elle qui les protège des métaux et du feu.
Il faut remarquer que par leur métier, les Gnaoua et les Hamadcha qui se mutilent ont tous des rapports avec les métaux et le feu : forgerons, bouchers et coiffeurs pratiquant la circoncision. Pour plus de précision, je demande au même Hamdouchi :
- Est-ce que dans votre répertoire il existe des paroles qui font allusion à Aïcha Qandicha ?
- Elle apparaît dans la phase chaude du rituel. Et habite l’individu en état de transe. Dans lahadhra, on chante :
Aïcha la folle met le henné
Tant que dureront les jours
Elle se livrera pour boire
La part de Dieu et de son Prophète.
Les bols qu’on apporte au crépuscule sont appelés Sabhya (la matinale) parce qu’ils restent allumés jusqu’à l’heure du sort. Cette lumière offerte au saint devrait illuminer l’obscurité de la tombe :
Vieillard comme le blé déjà mûr,
Voilà le temps des moissons qui arrive !
Dieu ! Que faire la dernière nuit de la solitude ?
Lorsque toute lumière s’éteint sauf la tienne !
Le 4 septembre 1983
Sadya Bayrou
Le moment du saken le plus intense de ce moussem s’est produit durant la visite du président du conseil municipal. Comme si chaque participant au rituel voulait être regardé par l’homme charismatique. Il y a là une sorte de jeu de séduction et une collusion entre le pouvoir, la musique et le sacré. Mais cette affectation a cassé la transe. La musique pourtant intense n’a pas induit la transe comme d’habitude.C’est au cours de ce moussem des Hamadcha que j’ai compris que la musique populaire est surtout une musique sacrée. Le mythe fondateur lui-même est musical. Sidi Ali Ben Hamdouch est allé avec son herraz dans un mariage. Il a joué et chanté un air de musique sacrée. Les gens séduits le suivirent jusqu’à la zaouïa et c’est ainsi qu’est née la confrérie.
5 septembre 1983

R1 (ancien citadin menuisier) :
« Je n’ai pas assisté au moussem car les gens du hal –de la transe- sont tous morts. À l’époque de Si Omar le hautboïste que Dieu ait son âme il n’y avait pas de failles dans le flux musical. Maintenant les musiciens essouflés se font remplacés par d’autres, ce qui fait que des « trous » cassent l’élan musical. Jadis les femmes en transe tombaient de la terrasse. Maintenant, à peine à t-on commencé un chant de dhikr que déjà on entame la partie musicale de la hadhra. : c’est comme un film de karaté où la bagarre se déclenche dès la première scène sans raison. Le rituel est désordonné parce que les gens du hal ne sont plus là ».
R2 (ancien citadin, écrivain public) :
« Je n’ai pas assisté cette année, parce qu’il y a trop de tapage et de foule qui ne permettent plus de savourer dans le calme les morceaux de saken ».
Les réactions des jeunes sont différentes :
R3 (jeune fonctionnaire) :
« Moi, je ne vais jamais au moussem ; je préfère la plage et le bar ».
R4 (jeune fonctionnaire) :
« Ce moussem est une résurrection de la mythologie qui nous replonge au Moyen-Âge ».
Procession des Hamadcha par Roman Lazarev
Matière et manière
Tapis – Tableaux : L’art de l’indicible
Des œuvres d’art, peuvent se faufiler à notre insu au milieu des objets utilitaires, jusqu’au jour où le regard exercé de l’expert vient les tirer de l’anonymat auquel ils étaient initialement destinées, pour nous révéler leur dignité d’œuvre d’art. Et c’est ce que nous propose Frédéric Damgaard, en publiant en ce mois de novembre 2008 un très beau livre sur l’art des femmes berbères au Maroc.
Il faut, en effet, avoir le regard exercé par une longue fréquentation des formes et des couleurs pour dénicher chez la femme berbère le tapis -tableau qui renvoi à l’art contemporain. Comme jadis il avait découvert des talents d’artiste chez des autodidactes d’Essaouira et de sa région, le désormais célèbre critique d’art Danois, nous propose maintenant sa collection de tissage rurale comme autant d’œuvres d’art.. Après Omar Khayam qui disait dans un célèbre quatrain :
« Allège le pas, car le visage de la terre est recouvert des yeux des biens aimés disparus », on a envie de dire désormais à quiconque foule un tapis : « Faites attention ! Vous êtes peut-être en train de fouler une œuvre d’art ! »
En effet, au-delà de l’origine ethnographique de tel ou tel tapis ou tissage, ce qui frappe dans la collection du désormais célèbre critique d’art Danois, c’est d’abord la puissance d’expression des formes et des couleurs, qui séduit d’emblée le regard. On tombe immédiatement sous le charme magique de ces objets d’art, comme on reconnaît sans médiation la beauté d’un poème ou d’une partition musicale. Formes florales, anthropomorphiques, sinusoïdales ou géométriques, soupoudrées d’or, de rouge et de noire. Damgaard choisit volontairement de mettre en relief des détails pour souligner davantage la parenté explicite qui existe entre cet art des femmes rurales et l’art contemporains au Maroc et ailleurs. Tapis - tableaux qui se prêtent à une double lecture horizontale et verticale ou parfois même le « défaut » de fabrication ou l’usure du temps contribuent à ce caractère insolite et indicible de l’art rural, qui se caractérise par la gourmandise de ses formes et sa transgression de la sacro-sainte règle de symétrie de l’art citadin. Chaque niveau est différent du suivant et le même motif n’est jamais reproduit sous la même forme et la même couleur : variation sur la même note musicale. Et toujours cette harmonie mystérieuse qui anime la structure d’ensemble malgré les contrastes apparents et l’interpénétration de l’horizontal d’avec le vertical.

Des couleurs chaudes comme l’amour et la tendresse féminine. Comme les noces d’été et les fêtes saisonnières. Comme les rêves au lendemain d’une nuit nuptiale. Et toujours ce bonheur de rêvasser sur ces surfaces chatoyantes comme au bord de l’eau et au voisinage du feu. Comme une traversée de champs doré parsemé de marguerite et de coquelicot. On a l’impression de surprendre non pas une tisseuse mais une rêveuse qui tisse par ses fils d’or et de soie, son paradis imaginaire, son jardin secret. La fraîcheur de son regard à la levée des aubes resplendissantes et son éblouissement par les couleurs du crépuscule. Énigmatique plaisir dont seul l’artiste a le secret. Qui oserait piétiner de tels œuvres, que pourtant la tisseuse destinait à un usage purement utilitaire, et à qui le regard expert d’un Damgaard, donne une dignité d’œuvre d’art.
Comme dans une rêverie créatrice, La tisseuse passe d’une forme à l’autre, d’une couleur à l’autre, pour nous offrir en fin de parcours un tapis – tableau que ne renierait pas l’artiste d’avant-garde le plus contemporain qui soit. Musique silencieuse, émerveillement, moment de grâce. En somme une invitation à la rêverie visuelle, où rien n’est définitivement délimité à l’avance, où les formes en suspens semblent suggérer une continuité vers l’infini au-delà du cadre limité du tapis- tableau. Un espace de prière et pour la prière. Un art sacré donc. Mais aussi un art festif : jaune d’or, mauve pâle…Mais dans l’ensemble on ne sait pas de quelle poésie, de quel mystère, de quelle beauté tout cela est le signe.. On se dit : comment es-ce possible qu’avec un nombre si limité de signes, de symboles et de couleurs, on en est arrivé à ce langage de l’infini ? Chaque tapis – tableau est si différent de l’autre. Et chaque tapis – tableau transcende d’une manière si surprenante les déterminismes ethniques de son origine pour atteindre une expression esthétique universelle. Beauté intrinsèque. Esthétisme qui opère magiquement et immédiatement sur le regard. On est là aux origines de l’art contemporain marocain : mémoire tatoué, transfiguration des saisons printanières d’un pays berbère aux luminosités solaires. Voici donc l’hommage de l’homme venu du grand Nord à l’art des femmes berbères du grand Sud marocain.Le point commun entre la plupart des tapis présentés dans l’ouvrage est d’appartenir soit à des transhumants, soit à des nomades : Béni Mguild, Béni Waraïn, la région de Boujaâd, lesRehamna, les Oulad Bou Sbaâ, les Chiadma et Sidi Mokhtar qui fournit la khaïma auxRgraga pour leur pérégrinations printanières. De là à déceler dans ces tapis berbères une influence saharienne, voire africaine, il n’y a qu’un pas que l’auteur franchit allègrement y compris à juste titre pour des montagnards sédentaires tel les Glawa dont le col de Telouatétait connu pour être un lieu de passage obligé entre l’Univers saharien et africain au sud et l’univers méditerranéen au nord. C’est principalement les deux courants culturellement marquant du monde berbère proprement dit. En effet, certains tapis présentés dans l’ouvrage évoquent ces masques africains sous forme de croix superposées, des totem ou des scènes de chasse telles qu’on peut encore les voire aujourd’hui dans la grotte d’Agdez au Sahara, du temps où celui-ci était verdoyant et attirait pachydermes, autruche et chasseurs africains qu’on voit reproduit par des peinture rupestres.

Un vêtir qui n’appartient nullement au Musée de l’histoire, et dont la fonctionnalité est loin d’être simplement folklorique. Et quand en ces hautes cimes de l’Atlas les tisseuses homériques d’Iswal en pays Glawa se préparent aux rigueurs de l’hiver en fredonnant de frais refrains tout en manillant l’antique quenouille – les chants des tisseuses accompagnent tout le processus du tissage – on obtient alors des objets esthétiques plutôt qu’utilitaires.Par delà les formes et les couleurs communes, les techniques du tissage au Maroc,concernent le tapis en laine du Moyen Atlas, en passant par le « Boucharouette » de la région de Boujaâd, le tissage broché Glawa , le tapis noué Aït seghrouchen, jusqu’au couvertures hanbel Zemmour. Et cela concerne des objets de la vie quotidienne aussi variés que le tapis de selle, le sac, le sacoche, le coussin,la tente des nomades et des transhumants. Cela concerne le vestimentaire au féminin: telle la handira (cap de femme), la tadarrat (le voile de cérémonie), le tissus brodé d’Ighrem ou de Tata. Mais le vestimentaire se conjugue aussi au masculin : en commençant par la djellabah et la tunique de laine que portaient jadis les moines guerriers, en passant par de très beau capuchons et bonnets de bergers de haute montagne. Des vêtements en laine épaisse pour affronter les rigueurs de l’hiver qui caractérise aussi bien les cimes enneigées de Bou Iblân chez les Béni Waraïn du nord-est que ceux des Glawaau sud –ouest. Là haut, il fait en effet très froid, de sorte que dés la tonte des moutons, les tisseuses berbères confectionnent d’épais tapis de laine pour isoler du sol, que des vêtements chauds pour protéger du vent glacial et sec qui balaie les cimes granitiques et dénudées. On fait alors des provisions de navets pour des couscous bien gras. Les berbères sont connus pour trois choses me disait mon père : le port du burnous, la consommation du couscous et les crânes rasés. D’où la nécessité de les couvrir de capuchons et de bonnets surtout quand il neige et quand il pleut. Mais que ces bonnets et ces capuchons soient hauts en couleurs ! Telle en a décidé la bergère à destination de son berger !
..Abdelkader MANA
22:31 Écrit par elhajthami dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
01/07/2012
Menace sur Tombouctou!

Ançar Eddine va détruire tous les mausolées de Tombouctou

Ançar Eddine, un des groupes islamistes armés contrôlant le nord du Mali, "va détruire aujourd'hui tous les mausolées de la ville. Tous les mausolées sans exception", a déclaré, samedi, Sanda OuldBoumama, porte-parole d'Ançar Eddine à Tombouctou, par la voix d'un interprète interrogé sur la destruction de mausolées de saints musulmans dans la ville, en cours depuis samedi matin. Selon la mission culturelle de Tombouctou, 16 mausolées de cette ville à la lisière du Sahara surnommée "la cité des 333 saints" sont sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Le porte-parole d'Ançar Eddine s'était lui-même peu auparavant exprimé directement sur ces destructions, en laissant entendre dans un français approximatif qu'il s'agit de représailles à la décision de l'Unesco, annoncée jeudi, de placer Tombouctou sur la liste du patrimoine en péril. "Dieu, il est unique. Tout ça, c'est "haram" [interdit en islam]. Nous, nous sommes musulmans. L'Unesco, c'est quoi ?", a-t-il dit, ajoutant que Ançar Eddine réagissait "au nom de Dieu".PLUSIEURS MAUSOLÉES DÉTRUITS SAMEDI

Selon plusieurs témoins, les islamistes ont complètement détruit tôt samedi matin le mausolée du saint Sidi Mahmoud, dans le nord de la cité. Ce site avait déjà été profané début mai par des membres d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), autre groupe armé contrôlant le Nord, avec l'appui d'hommes d'Ançar Eddine. Des témoins les ont également décrits en train de détruire le mausolée d'un autre saint, Sidi Moctar, dans l'est de la ville. En annonçant sa décision de placer Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial en péril, de même qu'un site historique de Gao, l'Unesco avait alerté la communauté internationale sur les dangers qui pèsent sur cette ville mythique du nord du Mali.

Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, a dit samedi que la destruction par des islamistes armés de mausolées de saints musulmans "risque de choquer la très grande majorité des musulmans de la région". Pour lui, il s'agit là d'un "acte de l'islam politique qui se nourrit des islamistes" qui "risque de choquer la très grande majorité des musulmans de la région". L'Unesco a aussi déploré la destruction "tragique" des mausolées.
Le groupe islamiste Ançar Eddine et le Mujao, considéré comme une dissidence d'AQMI, veulent imposer la charia (loi islamique) au Mali. Ils tiennent désormais les places fortes du Nord avec les jihadistes d'Aqmi, après avoirsupplanté le MNLA, sécessionniste et laïc.

MILLIERS DE MANUSCRITS
La ville est également célèbre pour ses dizaines de milliers de manuscrits, dont certains remontent au XIIe siècle, et d'autres de l'ère pré-islamique. Ils sont pour la plupart détenus comme des trésors par les grandes familles de la ville.
Avant la chute de Tombouctou aux mains des groupes armés, environ 30 000 de ces manuscrits étaient conservés à l'Institut des hautes études et de recherches islamiques Ahmed Baba(Ihediab, ex-Centre de documentation et de recherches Ahmed Baba), fondé en 1973 par le gouvernement malien. Possession des grandes lignées de la ville, ces manuscrits, les plus anciens remontant au XIIe siècle, sont conservés comme des trésors de famille dans le secret des maisons, des bibliothèques privées, sous la surveillance des anciens et d'érudits religieux. Ils sont pour la plupart écrits en arabe ou en peul, par des savants originaires de l'ancien empire du Mali.
Ces textes parlent d'islam, mais aussi d'histoire, d'astronomie, de musique, de botanique, de généalogie, d'anatomie... Autant de domaines généralement méprisés, voire considérés comme "impies" par Al-Qaida et ses affidés djihadistes.
Des bureaux de l'Ihediab ont été saccagés plusieurs fois en avril par des hommes en armes, mais les manuscrits n'ont pas été affectés. Par mesure de sécurité, ils ont été transférés vers un lieu "plus sécurisé", selon des défenseurs maliens de ce patrimoine. Dans une déclaration commune diffusée le 18 juin, les bibliothèques de Tombouctou affirment qu'aucun détenteur de manuscrit n'a été menacé, mais soulignent que la présence des groupes armés les "met en danger".
En plus de la ville de Tombouctou, l'Unesco a aussi inscrit jeudi sur la liste du patrimoine mondial en péril le Tombeau des Askia, un site édifié en 1495 dans la région de Gao, autre zone sous contrôle de groupes armés depuis fin mars. Des combats, qui ont fait au moins 20 morts, ont opposé mercredi à Gao des combattants touareg et des islamistes. Ces derniers en ont pris le contrôle total, selon de nombreux témoins.
15:22 Écrit par elhajthami dans Histoire, religion | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, religion |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
19/05/2012
Rivages de pourpre

Coquillages "purpura haemastoma"par Roman Lazarev
Le manuscrit grec du "périple d'Hannon"– datant de 300 à 350 avant J.C. - commence ainsi : « Il a paru bon aux Carthaginois qu’Hannon naviguât en dehors des colonnes d’Herculès et fondât des villes de Libye – phéniciens. Il naviguât donc, emmenant 60 vaisseaux à 50 rames, une multitude d’hommes et de femmes, au nombre d’environ 30 000, des vivres et autres objets nécessaires. » La deuxième colonie fondée par Hannon dénommée dans le manuscrit grec Karikon Teihos ,c'est-à-dire le « Mur Carien » se trouvait à une journée de navigation de la lagune visitée par Hannon, identifiée avec l’ancienne zone d’épandage aux hautes eaux du bas Tensift. La concordance des chiffres oblige à situer Karikon Teihos sur l’emplacement de Mogador actuel : « Après avoir dépasser cette lagune et naviguer pendant une journée, nous fondâmes sur la mer des colonnes appelées « Mur Carien ».
Le mouillage d’Amogdoul
La ville frémit comme un être vivant sous les fracas des houles. La prière des minarets se répand dans la lumière froide du crépuscule, en échos à la prière cosmique du firmament. Le chien noir qui aboit en bas de la citadelle, effraie les oiseaux de nuit et les fenêtres closes. Une étoile polaire scintille au dessus du rayon vert. Des ombres, tous les soirs, viennent sur les remparts contempler les îles. Frêle humanité qui semble surgir des temps antiques, accentuant l’aspect fontomatique de la ville.
La rade d’Essaouira est un port naturel pour les bateaux à voiles. Elle a toujours été un mouillage idéal où hivernaient les bateaux ronds de l’Antiquité et du Moyen Age. Non seulement les îles – en particulier celle qui ferme la baie comme une baleine qui flotte, énorme sur la mer – la protégeaient de la houle, mais un banc de sable faisait obstacle aux courants marins, en reliant l’île principale à l’embouchure de l’oued Ksob. Il est indiqué sur une ancienne carte que ce banc de sable « se couvrait et se recouvrait », ce qui laisse supposer qu’on pouvait rejoindre l’île à marée basse. Une tradition orale rapporte que les troupeaux de « Diabet » (le village des loups) allaient y paître au milieu d’une nuée de pique-bœufs. Les marins y sacrifiaient taureaux noirs et coqs bleus à leur saint patron Sidi Mogdoul.
Par ailleurs, sur la plage de Safi, à deux kilomètres au nord d’Essaouira, les explorateurs ont découvert des amoncellements considérables de coquillages de Murex et de Purpura Haemastoma – le vent ne cesse d’en découvrir pour les recouvrir ensuite lorsqu’il remodèle les dunes –, confirmant que c’est bien ici que se situaient les îles purpuraires, où Juba II avait établi au 1er siècle av. J.C. ses fabriques de pourpre.
D’après Pline, Juba II organisa une expédition sur l’archipel des Canaries à partir des îles purpuraires :
« L’expédition organisée par le roi Juba II partit des îles purpuraires, c'est-à-dire de Mogador, et suivit une route qui atteste une réelle connaissance des courants et du régime du vent dans cette partie de l’océan : « les îles fortunées, écrit Pline d’après Juba, sont situées au midi un peu vers l’ouest des Purpurariae... »
Si l’on voulait aller de Mogador aux Canaries en droite ligne, on était pris dans un courant qui portait du large vers l’Est, donc vers la côte. Il valait mieux s’y soustraire, ce qu’on faisait en se dirigeant vers l’Ouest, une fois cet espace traversé les navires se trouvaient dans la zone des forts courants du Nord au Sud, produits par les vents alizés, certains de dériver assez sensiblement au Sud pour atteindre les Canaries. Le long du continent les vaisseaux de Juba II, ne semblaient guère avoir dépasser Mogador. La carte qu’Agrippa fit dresser à l’époque de Juba, n’indiquait pas de ports après portus Rhysadments, qui pourrait devoir être identifié à Mogador...Au second siècle de notre ère, les renseignements précis de Ptolémée s’arrêtent également à la région de Mogador. Dans son « libyca », l’ouvrage que JubaII consacre au pays natal, où il faisait usage du Périple d’Hannon...C’est sans doute dans ce traité qu’il mensionnait les teintureries crées par son ordre aux îles purpuraires. »
Pour Vidal de la Blache, il ne fait pas de doute que nous avons à Mogador « le site où, d’après nous, Juba – après avoir entrepris des recherches dit Pline -, se décida à installer des ateliers de pourpre. »
Selon le texte de Pline l’ancien : « les renseignements sur les îles de la Mauritanie ne sont pas plus certains. On sait seulement qu’il y en a quelques unes en face des Autololes, découverte par Juba, qui y avait établi des fabriques de pourpre de Gétulie. »
La pourpre était extraite de la glande du Murex. C’est une glande grosse comme le bout du petit doigt, un peu jaune soufre, jaune pâle, qui produit la pourpre. Exposée au soleil, elle devient d’abord verdâtre avant de virer au bleu, puis au violet et enfin au pourpre.
Le Murex était recueilli à l’aide de nasses à une trentaine de mètres de profondeur, sur les fonds rocheux où ces molusques se fixent par leur pied ventral. Selon Pline l’Ancien, la pêche du coquillage purpura se pratiquait uniquement à ces deux périodes de l’année, « celle qui suit le lever de la canicule ou celle qui précède les saisons printannières. »
En 1950 Desjacques et Koeberlé enseignants à Mogador, consacraient leurs loisirs à la recherche des silex taillés de l’époque préhistorique. Cette recherche les conduisit dans l’île d’Essaouira où ils trouvèrent dans le sable des fragments de poterie, des pièces de monnaie. Des fouilles plus systématiques furent entreprises aussitôt. En creusant assez profondément du côté de la plage de l’île, sur le « tertre » on a mis à jour une couche phénicienne, la plus profonde, et des couches plus récentes en particulier celle des Romains du temps de JubaII. La petite histoire de cette recherche nous était jusque là inconnue. Desjacques nous l’a racontée, la voici :
" Comme il était interdit, raconte Desjacques, de chasser sur le continent en période de fermeture, la société de chasse locale Saint Hubert élevait des lapins dans l’île. Les lapins avaient brouté l’herbe et mis à nu le sol. Par le vent qui emportait le sable, par érosion, les pièces antiques étaient visibles à la surface du sol."
C’est ainsi que nos deux explorateurs ont découvert à côté de vestiges préhistoriques épars, tels que des silex taillés, des monnaies romaines et une pièce d’argent à l’effegie de Juba II, ainsi que des tessons de poterie sigillés et des fragments d’amphores. C’est la première fois que des vestiges romains sont découverts à une telle distance du Limes de la Mauritanie Tingitane.
Les vestiges préhistoriques et antiques incitent à penser que la région est habitée depuis des millénaires. Sur l’île on a découvert un bétyle phénicien du nom de «Migdol ». C’est une grande pierre jadis dressée dans le ciel. Pourquoi ne pas imaginer un ancien lieu de culte, là où se trouve maintenant le sanctuaire de Sidi Mogdoul ? Ce toponyme a donné au moyen âge, « Amogdoul », transformé en « Mogador » qui est une très ancienne transcription portugaise, d’un vieux toponyme berbère, attesté dés le XIè siècle par le géographe El Bekri :
« Les navires mettent trois jours à se rendre des parages de Noul jusqu’à Ouadi Souss (la rivière Souss). Ensuite, ils font route vers Amogdoul, mouillage trés sûr, qui offre un bon hivernage et qui sert de port à toutes les provinces de Souss. De là, ils se dirigent vers ce qui est le port d’Aghmat... »
Au XIIIè siècle, un autre géographe, Ibn Saïd el Maghrabi, nous dit lui aussi que le mouillage d’Amogdoul se trouve en pays Haha : « Là se trouve une petite île séparée du fleuve d’un mille. C’est un mouillage d’hiver pour les navires. Comme Tinmel est connue dans tout le Maroc pour la qualité de son huile, le pays haha est connu pour son miel blanc, ses taureaux puissants et son arbre à l’huile parfumée. A l’Ouest du pays haha se trouvent les Regraga où l’on tisse des couvertures fines et soyeuses que portent les femmes de la ville. C’est un pays au contact de l’Océan où coule la rivière ourlée des beaux grenadiers de Chiachaoua... »
Le mouillage d’Amogdoul servait donc à l’exportation des produits agricoles du pays haha, fraction des Masmoda qui sont, d’après Ibn Khaldoun, « les habitants du deren », qui vivent au voisinage de la mer. « Deren » est une déformation du mot berbère « adrar » qui signifie montagne.Cette montagne, a un nom berbère qu’elle porte sans interruption depuis l’époque romaine. C’est l’adrar n’idraren, la montagne des montagnes. A moins que ce ne soit la montagne du tonnerre de « nder », gronder, rugir :
Mer, gronde encore plus fort pour faire peur aux trembleurs !
Une région qui dépend énormément des aléas climatiques, comme nous l’indique Andam Ou Adrar, le compositeur de la montagne, qui représente la conscience collective du monde berbère : « Le poète et la hotte sont semblables, peronne n’en veut s’il n’y a pas de pluie et donc de récolte. ».
Dans les vieilles photos en noir et blanc, on voit le déchargement des paquebots au large par les barcasses. Jusqu’à la fin des années 1960 par beau temps chacune pouvait faire de 4 à 5 voyages, avec un rendement journalier, de 300 à 350 tonnes. Depuis les fenêtres grandes ouvertes de nos classes de l’alliance israilite, on pouvait entendre les sirènes de ces paquebots, comme autant d’appels nostalgiques, nous convions à l’évasion et à l’aventure. Le dernier des courtiers juifs de Mogador, fut le Sieur Hatouile, décédé vers 1989 : il était représentant de la compagnie Paquet et avait le monopole sur le savon de Marseille.
Les barcasses employées à Mogador, étaient propriété du Makhzen. D’un type long et étroit, n’offrant pas beaucoup de résistance au vent, leur stabilité transversale, probablement assez faible, suffisait parcequ’elles n’avaient à circuler qu’en rade, assez abritées en somme. Ce petit type, qui portait de 8 à 10 tonnes, était plus facilement maniable dans les rochers qui fermaient l’entrée du port. Elles étaient limitées à 8, dont deux étaient toujours en réserve à terre, prêtes à fonctionner en cas de besoin. Voici les marchandises que transportaient ces barcasses en 1906 :
Du bord à quais : balles de cotonnades, sacs de sucre, barils de sucre, thé, café, riz, semoule, épices, bougie, fer, peaux du buffles, acier, fer-blanc, bière, confiserie, madriers, balles de papier, faïence. Et du quai à bord : amandes, gommes, huiles, laine, cuirs de bœufs, graines en sacs, peaux de chèvres et de moutons.
" Quand la forte houle venait à les surprendre, me dit ma mère, les barcassiers se réfugiaient en haute mer. Loin des récifs côtiers où se fracassent les vagues. Ils restaient là, le temps que la tempête s’apaise. En attendant, la ville retenait son souffle."
Au sortir de la prière du crépuscule, un vieux Mogadorien me tend un jeton dont se servaient les barcassiers pour charger et décharger les marchandises entre la porte de la marine et les paquebots qui attendaient au large : côté face « Essaouira » en arabe, côté pile, l’étoile de David. Comme le soulignait si bien le peintre Adrien Matham, qui accompagnait en 1641, un navire hollandais :
« Il est à remarquer que nous avons ici trois dimanches à célébrer chaque semaine, à savoir celui des Maures : le vendredi ; celui des juifs : le samedi, et le nôtre : le dimanche ».
La ville d’Essaouira est construite sur une île qui s’est vue relier il y a quelques siècles au littoral par les alluvionnements de l’oued Ksob. Au large, une autre île ferme la baie. La houle l’a sectionnée en deux, isolant l’îlot de « firaoun » (Pharaon), qu’on appelle probablement ainsi à cause de sa résistance aux coups de béliers séculaires de l’océan : par une brèche béante, les vagues, déferlant du large, y pénètrent avec rage. L’un des îlots qui entourent la grande île porte le nom de Taffa Ou Gharrabou (l’abri de la pirogue en berbère).
L’embarcation berbère Agherrabou, se prêtait remarquablement à l’accostage des plages parmi les rouleaux. L’avant de la pirogue se termine par une longue pointe effilée (toukcht) qui donne aux formes de l’avant beaucoup d’élégance. Appuyé sur cette pointe et penché en avant, le pilote cherche à découvrir le frétillement des bandes de tasargal (sorte de bonite) qu’on encercle sur les plages avec les filets.L’Agherrabo est le véritable bateau de pêche chleuh. Le mot est connu sous cette forme du cap Juby à Safi. Le mot a pu être rapporté au grec et au latin Carabus. L’emprunt est intéressant : le mot et la chose qu’il désigne existait avant l’arrivée des conquérants arabes.
Les pêcheurs berbères de ces rivages invoquaient Sidi Ishaq, perché sur une falaise rocheuse abrupte qui surplombe une plage déserte où les reqqas échangeaient jadis le courrier d’Essaouira d’avec celui de Safi :
« Lorsque les pêcheurs passent à travers les vagues, il leur arrive de l’appeler à leur secours, ils lui promettent d’immoler une victime et de visiter son sanctuaire. Sidi Ishâq avait un cheval blanc que son frère Sidi Bouzerktoun lui avait donné. Lorsque les Regraga se réunissent, ils vont à cheval visiter ce saint ; les marabouts – hommes et femmes assemblés – prient Dieu de délivrer le monde de ses maux. Lorsque les pêcheurs vont vers Sidi Ishâq, ils entrent dans son sanctuaire et après avoir fait leurs dévotions, il te prenne, ô huile de la lampe, et te la verse au milieu des flots pour les calmer. »
Et jusqu’à une époque récente, avec procession, étendards et taureau noir en tête, les marins se rendaient à Sidi Mogdoul pour qu’il facilite leur entreprise, comme en témoigne cette vieille légende berbères :
« Sidi Mogdoul fixe les limites de l’océan et en chasse les chrétiens. Il secourt quiconque l’invoque. Fût-il dans une chambre de fer aux fermetures d’acier, le saint peut le délivrer. Il délivre le prisonnier entre les mains des chrétiens et le pêcheur qui l’appelle au milieu des flots ; il secourt le voilier si on l’invoque, ô saint va au secours de celui qui t’appelle (fût-il) chrétien ou musulman. Sidi Mogdoul se tient debout près de celui qui l’appelle. Il chevauche un cheval blanc et voile son visage de rouge. Il secourt l’ami dans le danger, le prend et, sur son cheval, traverse les océans jusqu’à l’île. »
Et sur ces mêmes rivages, au Sud de cap Sim, les pêcheurs se rendaient en pèlerinage à Sidi Kawki où les berbères Haha procèdent à la première coupe de cheveux de leurs enfants : « s’ils sont surpris par la tempête, ou si le vent se lève alors qu’ils sont en mer, les marins se recommandent à lui. Avant de s’embarquer pour la pêche, ils fixent la part de Sidi Kawki, dont les vertus sont très renommées. On raconte qu’un individu y avait volé la nuit une bête de somme et bien qu’il eut marché tout le temps, quand le matin se leva, il se retrouva là où il l’avait prise. »
Ces seigneurs des ports, ces saints protecteurs des rivages et des marins dont les coupoles, telle des vigies de mer, jalonnent les rivages, les marins leur rendent hommage à l’ouverture de chaque saison de pêche.
Abdelkader MANA
11:17 Écrit par elhajthami dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook