27/06/2010
Sculpture de thuya
Sculpture de thuya

Hassan BONAR marqueteur et sculpteur disparu

Lors d’un récent voyage à Essaouira, le comédien Khalili nom qui signifie littéralement « mon ami » , expert en matière de Malhûn m’a fait part d’une qasida de Ben Sghir où ce poète décrit un voyage d’Essaouira à Marrakech effectué à pied, comme cela se faisait jadis, par deux compagnons de route : un marqueteur et un colporteur. Cette qasida sous forme de récit de voyage intitulé « Bent el Ârâar » (la sculpture de thuya) commence ainsi :

Ils passaient la nuit à voyager
Et sur la voie du bien, se tenaient compagnie
L’un d’entre eux est marqueteur
Seul à même de rendre malléable l’opaque racine de thuya.
De ce précieux bois il faisait des merveilles.
Que ne peuvent rémunérer ni louis, ni perles, ni poudre d’or.
Le second est un fabriquant de ceintures de soie (Mjadli), de son état.
Vocalise (Mwawli) à tout jour de fête,
Il s’est enrichi à l’importation de thé.
Le troisième était un notable marchand de tissus :
Il vendait la soie d’avec le lin (sabra), lmalf et le gabardi.
Il faisait commerce de tous les parfums :
Du rouge à lèvre, du hargouss, d’écorce de noyer, de kheul,
Ainsi que de tout ce que de loin nous ramènent les chameaux.

l'oued Ksob par Boujamaâ Lakhdar en 1959
Le tisserand, nous dit le poète, était en même temps Mwawli, c’est-à-dire chanteur du mawal (vocalise, cantilène) qui accompagne généralement les séances de samaâ (audition musicale, chant sacré) et sert d’intermède vocal entre deux partitions instrumentale dans la ala andalouse. Dans les confréries religieuses, l’on recourt au mawal – qui provoque le fameux « ollé » admiratif des Espagnols, qui a pour origine l’exclamation « Allah ! », comme l’explique le grenadin Garcia Lorca, à propos du « duende » - lors des panégyriques dédiés au Prophète.

Karami, disciple de Lakhdar asphixié au charbon à Ghazoua

Abderahman Lahchiouch
Les confréries les plus orthodoxes excluent tout instrument hormis la voix humaine ; création divine. Ils considèrent l’emploi de la musique instrumentale comme une hérésie puisqu’un précepte dit :
« Dieu maudit la barbe au-dessus et au-dessous de laquelle il y a zamar ». Ici le terme zamar désigne aussi bien l’instrument à corde que l’instrument à anche. Le zamar, ou la musique instrumentale caractérise le soufisme populaire de transes (Jedba) collectives et de pratique magique. Alors que le samaâ, psalmodie uniquement vocale avec « îmara » (danse extatique), caractérise les zaouïas d’un soufisme plus orthodoxe. Les confréries du zamar et de la jedba sont fréquentées par les citadins « communs ». Quant aux confréries du samaâ et de la îmara, elles sont fréquentées par les citadins « distingués ».

Mustapha Marhoum grand ami de Hussein Miloudi vivait à Derb Haïni
On voit donc bien que culturellement et socialement, notre tisserand appartient à la classe distinguée des citadins. Il était probablement un colporteur « Âttar », qui sillonnait la région, pour y commercialiser non seulement les produits manufacturés en provenance d’Europe par le biais des caravelles, mais aussi les produits sahariens — plumes d’autruches, ambre de baleine, poudre d’or, succulentes dattes bouskri d’Akka et de Tata etc.- que ramenaient les caravanes. Notre colporteur commercialisait aussi les produits cosmétiques de l’époque : khôl pour noircir les cils et les sourcils, écorce de noyer pour la denture, rouge à lèvre de Fès, hargouss (extrait d’une mixture à base de vapeur de benjoin blanc et de bois de santal, donnant un parfum aux vertus aphrodisiaques particulièrement puissantes qui enrobait le corps de la femme pendant une semaine entière, nous dit-on).Notre poème Rihla poursuit ainsi l’aventure de nos compagnons :

Larbi Slith, peintre, guitariste et poète qui avait rarement quitté Essaouira
Avant de prendre la route, ils ont visité le sanctuaire de Sidi Mogdoul.
C’est secrètement qu’ils ont quitté Essaouira,
Traversant forêts et lieux inhabités (fayafi wa qfar).
En chantant des poèmes,
Ils se dirigeaient vers la ville rouge qui réjouit les cœurs (Al Bahja Al Hamra).

Portrait de Larbi Slith par son ami Mohamed Sanoussi (les années 1980)
Quitter les siens, c’est affronter l’inconnu et ces lieux inhabités que notre poète dénomme « fayafi wa qfar » les innombrables dangers qui guettent extra muros et dont il fallait se prémunir préalablement en se recueillant auprès du saint patron de la ville. À l’époque les quatre portes de la ville se fermaient la nuit, et en dehors des remparts, il n’existait que des jardins potagers et des cimetières. Pour se prémunir contre les caïds de la région qui la convoitaient, la ville tendait à développer une certaine autonomie, en disposant d’une citerne collective en son enceinte plus précisément dans l’actuel marché aux poissons. Au crépuscule un berger faisait rentrer les vaches laitières, que chaque maison possédait avant que les portails de la cité ne se referment. Un soir qu’il faisait très froid, deux colporteurs qui sillonnaient la région pour y vendre du tissu de melf importé d’Allemagne et des épices – au paradis le Prophète aurait aimé être marchand de tissu et d’épices – entraient en ville après leur tournée dans les souks de la région. Ils trouvèrent les portes fermées au crépuscule parce que c’était le temps de la Siba, le temps où les caïds étalaient le burnous sur la jellaba et faisaient parler le baroud. Le marchand qui resta immobile jusqu’au matin fut trouvé inanimé au pied des remparts, alors que son compagnon qui avait passé la nuit à rouler une grosse pierre, à la manière de Sisyphe, entra prendre son petit-déjeuner tout trempé de sueur en répétant :
« Que le lit où coule le flot de notre vie serait étroit, s’il n’y avait le vaste espace de l’espérance ».

Abderrahman Lahchiouch
Se rendre au sanctuaire, en quête de protection surnaturelle, avant de quitter la ville, était donc une pratique courante à tous ceux, voyageurs et marins, qui affrontaient les risques de noyade en haute mer, ou le voyageur, celui des coupeurs de route, qui infestaient les sillages des caravanes au pays de la Siba – par opposition au pays sous contrôle du Makhzen – comme le soulignait d’ailleurs Ben Sghir dans une autre qasida intitulée Warchan (pigeon-voyageur) :
De la porte du lion, tu sortiras, colombe
Tu te dirigeras vers Sidi Mogdoul, seigneur du port,
Tu demanderas sa protection
Il est connu même par-delà Istamboul
Sois prudente et éveillée
Dépasse les amas de pierres
Au-delà de la grande colline
Et touche de tes ailes
Moula Doureïn, gloire de notre pays
Demain, de bonne heure,
Tu te purifieras et tu seras matinale
Plus agile que le faucon,
Tu visiteras Akermoud et ses seigneurs !

khoubaïch que j'ai connu durant les nuits bleues du Ramadan

Port nocturne d'après Khoubaïch
Ces seigneurs des ports, ces saints protecteurs des rivages et des marins dont les coupoles, telle des vigies de mer, jalonnent les rivages et à qui les marins rendent hommage avant de s’embarquer à l’ouverture de chaque saison de pêche. C’est le cas de Sidi Mogdoul,où jusqu’à une époque récente, les marins se rendaient en procession, étendards et taureau noir en tête, pour qu’il facilite leur entreprise, comme en témoigne cette vieille légende berbères :
« Sidi Mogdoul fixe les limites de l’océan et en chasse les chrétiens. Il secourt quiconque l’invoque. Fût-il dans une chambre de fer aux fermetures d’acier, le saint peut le délivrer. Il délivre le prisoner entre les mains des chrétiens et le pêcheur qui l’appelle au milieu des flots ; il secourt le voilier si on l’invoque, ô saint va au secours de celui qui t’appelle (fût-il) chrétien ou musulman. Sidi Mogdoul se tient debout près de celui qui l’appelle. Il chevauche un cheval blanc et voile son visage de rouge. Il secourt l’ami dans le danger, le prend et, sur son cheval, traverse les océans jusqu’à l’île. »
Les pêcheurs berbères de ces rivages invoquent aussi Sidi Ishaq, perché sur une falaise rocheuse abrupte qui surplombe une plage déserte où les reqqas échangeaient jadis le courrier d’Essaouira d’avec celui de Safi Lorsque les pêcheurs entrent dans son sanctuaire, et après avoir fait leurs dévotions, dit la légende berbère « ils te prennent, ô huile de la lampe, et te la verse au milieu des flots pour les calmer. » Et au sud ces mêmes rivages d’Essaouira et de cap Sim, les pêcheurs se rendaient en pèlerinage à Sidi Kawki où les berbères Haha procèdent à la première coupe de cheveux de leurs enfants : « s’ils sont surpris par la tempête, ou si le vent se lève alors qu’ils sont en mer, les marins se recommandent à lui. Avant de s’embarquer pour la pêche, ils fixent la part de Sidi Kawki, dont les vertus sont très renommées. On raconte qu’un individu y avait volé la nuit une bête de somme et bien qu’il eut marché tout le temps, quand le matin se leva, il se retrouva là où il l’avait prise. »
Le voyage est d’abord un pèlerinage, et le voyageur comme le poète en quête d’inspiration, doit se mettre sous la protection de puissances tutélaires avant de l’entreprendre. On doit aller d’une étape sacrée à l’autre. Nos compagnons quittent le fief des sept saints Regraga, s’arrêtent en cours de route à Sidi Yacine, saint berbère au bord de l’oued Ksob, avant de poursuivre leur chemin vers la ville des sept saints. Les gîtes d’étapes étaient donc d’abord des sanctuaires.

Larbi Slith décédé en 1989: 21 ans déjà!
La sculpture de thuya est écrite sur le mode du herraz du cheikh Jilali Mtired, que les artisans considèrent comme le prince des poètes à Marrakech et qui prétendait que son génie poétique était dû aux jnûn : on raconte que le poète sortait seul tous les jours avant le coucher du soleil se promener en dehors de la ville de Marrakech. Il allait au Sahrij Belhaddad, endroit peu fréquenté, où poussent des plantes sauvages et où se trouve le bassin des forgerons, eau stagnante remplie de crapauds. Mélancolique, il s’asseyait là pour méditer au milieu des croassements, quand une grenouille lui aurait adressé la parole en l’invitant à une fête de mariage. Quand il eut chanté, les jnûn lui offrirent un tambourin d’or. La légende veut que ce soit à lui qu’on doive l’invention des tambourins ! Ce poète Marrakchi du XIXe siècle considérait sa poésie comme un don divin qu’il aurait acquis après un pèlerinage à la zaouïa de Sidi Bouâbid Charqui, le maître spirituel de Sidi Ali Ben Hamdouch comme il l’affirme dans l’un de ses poèmes :
L’inspiration m’a été accordée par Charqawa,
C’est là que mes seigneurs m’ont fait don d’un breuvage divin.
Comme un conteur de Jamaâ Lafna, Ben Sghir poursuit :
Telle que sculptée par l’artiste
Elle n’est que racine de thuya
Mais la revoilà vivante,
Métamorphosée en femme de chair et de sang.
À la petite source de Sidi Yacine
Ils rattrapèrent notre ami Ben Zin.
Qui devint désormais leur compagnon de route
Et quelle agréable compagnie !
Digne des contes merveilleux
Des récits fantastiques
Et des étrangetés plaisantes.

Sadya Bayrou qui a brutalement disparue en 2010
La qasida prend ici les allures d’un conte. En effet, au marché annuel de Sijilmassaqui était considérable, les animateurs de la place publique tenaient lieu à la fois de conteurs, que de musiciens-poètes. Ils se faisaient accompagner de duf. Les premières qasidas prenaient la forme d’un récit comme l’illustre celle du verre qui commence ainsi :
Toi qui apprécies la beauté et le plaisir,
Fais attention, ô échanson, écoutes ce qui m’est arrivé.
Une histoire merveilleuse m’est arrivée hier avec mes compagnons.
Nous avons passé la nuit et quelle nuit !
Dans un jardin magnifique sous les ailes de l’ombre.

Sadya Bayrou, peintre mystique comme la plupart des artistes d'Essaouira
Les premiers bardes du melhûn se faisaient aussi accompagner du duf, instrument à cadre entouré de peau de chameau pour déclamer des qasidas, dont les thèmes étaient similaires à ceux des conteurs : la Sira du Prophète, mais aussi les épopées des héros de légendes. C’est le conte qui donna naissance au poème. Le conteur est antérieur au poète.
Rire et amusement comme compagnons de route
C’est ainsi que s’est passée la journée.
On y accompagnait dans la joie, la fiancée à sa fête.
Au moment où le soleil du lundi s’en allait,
Ils dressèrent leur tente en s’entraidant.
Après ablutions et prières,
Ils s’accordèrent à partager dîner et nuit de garde.
Le tirage au sort désigna le marqueteur
Pour monter en premier la garde
Pour que passe le temps, il fit un tour dans le champ
De nombreuses racines de thuya y étaient éparpillées
Il entreprit alors de sortir ses outils
Et se mit à sculpter, à ciseler, à polir et brillanter.
Il était possédé par le métier, bouillonnant de pensées
Un artisan droit et méticuleux
Mais sa vie était pleine d’amertume.

Sadya Bayrou

Portrait de Sadya Bayrou
La passion de l’art est comparée ici à la possession par les djinns. Car ça serait blasphème que de croire que l’artiste est le créateur de sa propre œuvre ; il n’est qu’une écorce charnelle traversée par le souffle de la création venue d’en haut, un simple médium, pour des énergies supérieures. Ne dit-on pas que sans hal (transe) un crâne est vide, comme un jardin sans palmier, comme une coupole sans puits ?
Il vécut pleinement son tour de garde
En sculptant une silhouette qui ravit l’œil
Une femme brune au port majestueux
Puis alla réveiller celui dont c’est le tour de garde
Avant de s’étendre pour s’endormir
Le colporteur resta bouche bée, en voyant ce qu’il a vu
Son sang en fut glacé
Il reprit ses esprits et la reconnut
Un corps de thuya sculpté par ce jinn
Il se met alors à l’ausculter et à réfléchir
Puis, il accourut vers ses coffres
En sortit un caftan vert de velours
Une robe de soie,
Une voilette brodée de rameaux scintillants,
Un foulard à bandeau tissé de poils de chameau
Et des babouches décorées d’arabesques
Il l’embellit en la couvrant d’ornements
Et la laisse ainsi exposée à l’admiration de la nuit
Puis alla réveiller Ba Omar Ben Zin
Pour qu’en compagnie de la belle femme
Il monte la garde à son tour
Celui-ci en fut étourdi, ô toi qui comprends
L’univers lui parut tourbillonnant de vertige
Mais il reprit ses esprits et se mit à la dévisager de prêt
Le vent emporta sa voilette qui faillit lui tomber sur la tête
Tristesse, joie, tourments. Il en perdit la raison.
Il en perdit l’étoile du nord, il en perdit l’axe du monde !
Il en perdit la maîtrise de l’être
Cette fois-ci, il est peu probable qu’il puisse s’en réchapper
Ces états d’âme se bousculèrent
Il s’en alla haletant à travers la vallée du désir
Si seulement les siens pouvaient le voir à l’instant
Pauvre tourmenté, errant la tête dénudée !
Et lorsqu’enfin il regarda autour de lui
Il ne vit que copeaux de thuya éparpillés
Il comprit alors de quoi il s’en retournait.
La fatigue l’ayant vaincu
Au petit jour il revint de son errance
Son regard reconnu le tronc d’arbre
Et en ressentit une profonde humiliation.
Comment a-t-il pu avoir peur du néant ?
Lui qui savait pourtant distinguer le vil du précieux métal ?
Lui qui savait pourtant peser les milles et une abra de grains ?
Il se mit à réfléchir au pourquoi
Il se mit à réfléchir au comment
Pourrait-il se venger un jour du piège tendu ?
Du plus perfide des commerçants ?
De celui qui ne l’avait pas averti à temps ?
Sa gorge se noua de rage et de regrets !
Pour retrouver ses esprits, il frappa le sol de ses deux mains
Et de sa poussière se purifia le corps de ses souillures
Il s’orienta vers la kibla (l’Est) et pria son créateur
À peine s’est-il prosterné qu’un bruyant éternuement se fit entendre
C’était la sculpture de thuya qui reprenait vie
À la fin de la prière une vierge brune lui tomba dans les bras.
Il lui dit : réveille le colporteur sans scrupule,
Réveille ce loup de marqueteur
La folie sortit alors de sa tanière
Et se mit à vagabonder comme une chamelle dans le désert.
Ô vous penseurs, hommes de science, mes meilleurs lecteurs,
Dites : de tous les trois qui a le droit d’en disposer ?
C’est Mohamed Ben Sghir qui vous salue tous,
Ô vous poètes, et gens de bien.

Onirique Sadya Bayrou
Le poète nous annonçait un voyage d’Essaouira à Marrakech qui se déroulait en quatre jours à dos de mulet, mais le récit s’arrête à la première journée et à la première étape. En fait la Rihla se poursuit mais uniquement dans le rêve. La peur que ressent notre personnage face à la sculpture nocturne est commune à toutes les représentations figurées. Car l’ombre, l’image formée dans l’eau ou le miroir, la statue ou le portrait sont des espèces de doubles de l’âme, sinon l’âme elle-même ; dès lors le possesseur du double peut se livrer à des pratiques magiques d’envoûtement dangereuses pour l’âme et même la seule présence du double peut attirer l’âme hors du corps et causer ainsi la mort. D’ailleurs la séduction féminine est souvent associée à l’envoûtement et à la mort : il y a quelques années, un jeune marqueteur s’étant pris d’amour pour une femme voilée s’est mis à parcourir la ville pieds nus, et pour le délivrer de cet envoûtement un sorcier lui avait prescrit d’aller déterrer une tortue au cimetière, car celle qui l’avait charmé avait enterré son âme avec la tortue.
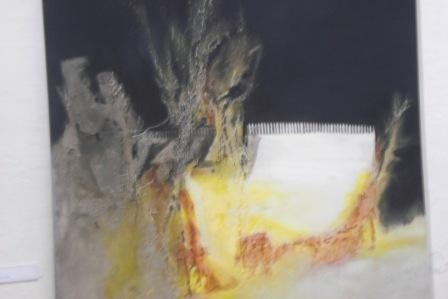
La flamme intérieur et ses mystères de Sadya Bayrou
Ben Sghir associe le désir au halètement provoqué par la transe, de sorte que le personnage vagabondant dans la vallée du désir et de la nuit nous fait penser à ces chants de chameliers dont Ghazali nous dit que même les chameaux y sont sensibles, au point qu’en les entendant, il en oublient le poids de leur charge et la longueur du voyage et qu’ainsi excités, « étendent leur cou et n’ayant plus d’oreille que pour le chanteur », ils sont capables de se tuer à force de courir.
Abdelkader MANA

21:38 Écrit par elhajthami dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : poèsie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Georges Lapassade

Sadya Bayrou
Sous le signe de la transe
Ce chant, ces grands tambours et ces cymbales d’or !

Georges Lapassade

Larbi Slith

Les flammes intérieures et leur mystère de Sadya Bayrou
Par Abdelkader Mana
Ma première rencontre avec Georges Lapassade remonte à la période où il enquêtait sur Ben Sghir pour répondre à une double commande : celle du caïd Bassou de la division économique et sociale de la province d’Essaouira, qui voulait publier les travaux du colloque de musicologie (1980-1981)dont les actes sont parus par la suite dans la revue Transit de Paris-VIII, sous le titre Paroles d’Essaouira. Il s’agissait aussi de répondre à la demande de son ami Dominique Bedou, petit éditeur de poésie qui voulait publier un recueil sur la poésie d’Essaouira en tant que « carrefour culturel ».

Sadya Bayrou
J’enseignais alors au Lycée Akenssous de la ville. Un jour, au tout début des années 1980, le proviseur m’invita à une réunion prévue vers 16 heures à la Chambre du commerce, entre Georges Lapassade, et les connaisseurs du Malhoun de la ville. La réunion était provoquée par Georges qui enquêtait alors sur Ben Sghir. Il comptait ainsi sur la dynamique du groupe pour faire avancer sa recherche.

A l’origine de cette enquête, un article où Hachmaoui et Lakhdar, résumaient la qasida de Lafjar (l’aube) de Ben Sghir sans donner le texte. C’est après cette réunion que Georges m’embarqua dans l’enquête sur les traditions poétiques et musicales d’Essaouira et sa région qu’il menait à l’issue du premier festival d’Essaouira « la musique d’abord » (1981-82). Une fois à Paris il me faxa ce qui suit :
« Ce qui choquait mon esprit de cartésien, y écrivait-il, c’est que nous avons découvert que le cahier d’un certain Saddiki (grand’père du prof. d’histoire du même nom) qu’il avait exposé au Musée et « commenté » était daté en réalité de 1920, et non de 1870 comme ils prétendaient, tirant argument de cela et du contenu du cahier, pour inventer une sorte de pléiade poétique souirie qui aurait eu pour mécène vers 1870, à Essaouira, Moulay Abderrahman ! C’est cela que je contestais beaucoup plus que l’origine souirie de B.Sghir. En effet, ce cahier contenait des qasidas diverses, recueillies (peut-être) par le grand-père Saddiki au cours de ses voyages à Marrakech qui du coup devenait souiri ! Etant donné l’impossibilité d’avancer à Essaouira, j’ai fini par me décider d’aller consulter à Marrakech Maître Chlyeh, animateur d’une sorte d’Académie du malhoun. Il m’a fort bien reçu, bien informé et je crois (sans en être sûr) que la version de Lafjar que j’ai ensuite diffusé à Essaouira venait de lui »

Sadya Bayrou
Toute la démarche de l’enquête ethnographique de Georges Lapassade réside dans ce texte : alors qu’il demandait des informations sur Ben Sghir, au bazariste Ben Miloud, celui-ci était assis sur un vieux coffre qui contenait plein de qasida, dont celles de Ben Sghir ! C’est pour contourner cette rétention d’informations, ces réticences locales qu’il se voyait obligé de se rendre à Marrakech pour obtenir la fameuse qasida de Lafjar (l’aube) ! Lors de cette enquête sur les paroles oubliées d’Essaouira, Ghorba le cordonnier d’Essaouira, refusait lui aussi de transmettre le contenu de sa « khazna »[1] à Georges Lapassade jusqu’au jour où après sa mort, sa vétuste boutique de cordonnier s’effondra engloutissant à jamais sous les décombre, tout le trésor poétique qu’il conservait si jalousement.

Sadya Bayrou
« Lafjar » (l’aube)
De Mohamed Ben Sghir
En participant ce printemps 2009 à Essaouira au colloque de musicologie de la deuxième édition du festival du Malhûn, les musiciens de la ville m’ont parlé d’une seconde mort de Ben Sghir avec la disparition de Georges Lapassade, son découvreur. C’était une flamme qui s’était éteinte. C’est à Georges Lapassade en effet, que revient, le mérite d’exhumer et de diffuser « Lafjar » (l’aube), la qasida de Mohamed Ben Sghir, le poète du melhûn d’Essaouira, qu’on avait retrouvée dans un cahier daté de 1920 :
Vois le ciel au-dessus de la terre, source de lumière
Les habitants de la terre ne peuvent l’atteindre
Vois Mars, toi qui es indifférent
Sa beauté apparaît au monde clairement
Vois Mercure qui vient à toi, ô voyageur
Au dessus du globe, de l’ignorance étonnante
Vois Neptune qui illumine les déserts
Il a mis dans la création, le riche qui a tout.
Vois Saturne qui vient visiblement vers toi
Au-dessus des sept du secret parfait
Guerre des hommes, ô toi qui dort,
Vois le mouvement des astres
Ils ont éclairé de leur lumière éclatante, les ignorants.
Et sache la vérité si tu veux être pur
Lafjar (l’aube) qui t’advient d’une science illuminée
Prends ô toi qui m’écoutes Yabriz et Nikir
Celui qui règne sur le plus rusé des loups
Celui qui répond très vite au défi
Doit protéger les fauves
Est-ce que le hérisson peut aller à la guerre contre l’ogre ?
On connaît l’aigle parmi les faucons
Il craint le moindre bruit et les fauves au sommet des montagnes
En passant par les grottes Bendir Telemsani et son beau cortège
Dites à celui qui n’est ni faible ni vantard
Que Mohamed Ben Sghir est une épée dégainée.

Sadya Bayrou
Le mercredi 13 mai 2009, j’écris à Céline Cronnier :
Je suis depuis quelques jours à Essaouira pour participer au colloque sur le Malhûn - une tradition instituée par Georges au festival de 1980. Je participe par une communication sur le poète Ben Sghir, "une énigme" sur laquelle Georges avait enquêté à Essaouira pendant de nombreux étés.
Je vous écris sans accent; parce que le clavier n’en contient pas; mais aussi parce que je n’en n’ai pas pour raison d’émotion: au colloque sur le malhûn, tout le monde était stupéfié par la beauté céleste d’aurore de Ben Sghir que Georges avait aidé à exhumer et à traduire! Les autres intervenants qui ont utilise la "langue du malhûn" entaient inaudibles et sans voix parce qu’ ils ont parlé dans une langue morte et inusitée depuis longtemps: seuls les chanteuses lui rendent vie; arrivent à en communiquer le sens oublie: c est donc Georges qui avait rendu vie à Ben Sghir en le faisant traduire en une langue vivante et moderne comme le français! Il faut que les gens comprennent que les manuscrits du malhun _ que les khazzanes(leur conservateurs) tiennent jalousement dans leurs counnaches (cahiers dissimules dans de vieux coffres) sont les seuls inities capables d’en déchiffrer le sens: Georges avait donc aidé à faire parler un poème cosmique écrit dans une langue morte; lui qui est féru de Paul Valery : il était capable de me réciter de long poèmes de ce fiévreux penseur français tout le long de la plage...

Sadya Bayrou
C'est incroyable ! Me répond Céline Cronnier, le même jour. Ce qui est incroyable ? Cette "énigme", dont vous me parlez, j'en prenais connaissance tout juste hier ! Hier que vous étiez à reprendre le fil de l'enquête là où Georges l'avait laissé...Oui, hier en effet, j'étais à lire le "Journal de la réforme des DEUG", tenu par Georges de septembre 1984 à juillet 1985... Soudain, un passage fort me frappe... suffisamment pour que j'en rêve dans mon sommeil...
"27 février. Hier soir, en rentrant à Paris, je réfléchissais à la "recherche". Je ne me sens autorisé à faire usage de cette expression que pour désigner mon enquête d'Essaouira sur la chanson, en 1981. Ce n'était certes pas une "recherche scientifique" : je n'avais aucune compétence pour engager une telle recherche, je ne connaissais ni le vieux dialecte poétique local, ni sa graphie. Je ne connaissais rien non plus en matière de chant andalou, ni les formes, ni les rimes, ni les thèmes consacrés.

Sadya Bayrou
C'était pourtant une recherche : recherche d'un poème perdu, "Lafjar", de Mohamed Ben Sghir, tout en sachant déjà que lorsque je l'aurais retrouvé, je serais incapable de le lire, de le traduire, de le comprendre. Plus j'avançais dans mon enquête, plus les portes se fermaient, plus les gens devenaient hostiles, plus ils mentaient et brouillaient les pistes. Et plus je devenais obsédé, par le fantôme de Ben Sghir : ce poème perdu me fascinait par son absence, par sa perte (alors qu'il se trouvait, mais je l'ai su trop tard, dans le coffre d'un antiquaire chez qui j'allais chaque jour pour le supplier de m'aider à recomposer ce poème perdu.)
Il y avait là quelque chose d'excessivement douloureux, comme une "obsession" au sens fait à ce mot par les théologiens de l'exorcisme. Cette douleur naissait de l'obsession elle-même, de ce fantôme de poète oublié qui me fait courir, dans l'hostilité grandissante de la ville ; j'aimais cette ville et je croyais en être aimé. Mais mon enquête me montrait jour après jour, qu'elle ne m'aimait pas, et qu'elle n'aimait pas non plus son passé, ses poètes. Tout cela lui était indifférent."
J'ai passé la nuit à errer, à rechercher avec angoisse ce Mohadmed Ben Sghir dont j'ignore tout. et voilà qu'aujourd'hui, qu'à peine sortie de mon errance, vous m'écrivez son nom !

Sadya Bayrou
J’ai maintenant les mêmes problèmes de traduction avec les chants des femmes(les haddarates) que jadis avec les chants oubliés du malhûn, mais je suis tellement content de retrouver en plus complets leurs chants de mariage dont j’avais recueilli des lambeaux à l’aube des années 1980; lors de ma première rencontre avec Georges où ce dernier m’avait embarqué à son enquête sur la "Parole d’Essaouira' (en tant que parole sociale s’entend). Je me rends compte maintenant à quel point mon enquête d’alors était larvaire; mais je suis content de voir a nouveau fonctionner le dispositif de recherche que Georges avait installe il y a déjà si longtemps. Non seulement cela, mais cette enquête ressuscitée m’a permis de retrouver vivace les souvenirs de Rbatia une amie de ma mère; morte il y a déjà fort longtemps - au milieu des années 1970- que j’aimais beaucoup et dont l’image me hante toute ma vie sans savoir pourquoi ? Or hier les haddarates m’ont appris que ce fut une des figures emblématiques qui ont émaillé leur histoire secrète et qu’en plus, elle était sage-femme. Je suis maintenant convaincu que c’est elle qui avait aidée ma mère à me mettre au monde! Elle était en fait ma seconde mère et je la chérissais pour cette raison sans le savoir...Cette en- quête s’est révélée comme une nouvelle naissance pour ma propre mémoire; une sorte de re-naissance de Rbatia; de ma mère; de Geeorges; mais aussi de ma mère nous apportons à moi et à Georges le thé et les gâteaux lorsqu’au salon de chez nous il m’aidait à mettre en forme mes contributions à son enquête.

Sadya Bayrou
Selon Rabiâ haïl, dont le grand père maternel, Ba-Zaïd, était le moqadem des Aïssaoua d’Essaouira dans les années 1950 :
« Rbatia était la grand-mère de toute la ville. Elle était à la fois sage-femme et moqadma de la zaouïa du Hadi Ben Aïssa. Au Mouloud, on y organisait un moussem où se retrouvaient les Aïssaoua et où étaient également conviés les Hamadcha.. Après le sacrifice, on offrait tête et tripes à la moqadma. Au troisième jour des festivités, arrivaient les haddarates. C’était la moqadma qui organisait la hadhra. »
Cette enquête s’est révélée comme une nouvelle naissance pour les" paroles oubliées d’Essaouira"...

Sadya Bayrou
Latifa Boumazzourh qui a maintenant 54 ans, se souvient encore, qu’à l’âge de quatre ou cinq ans, elle tenait le bendir recouvert de tissus de sa grand-mère , qu’elle accompagnait à la zaouïa des Aïssaoua où la hadhra se déroulait jusqu’à l’aube : elle me cite comme Haddara, entre autre la femme de Moulay Omar le célèbre hautboïste des Hamadcha, et Fatima Kit-kit, que j’ai connu au début des années quatre vingt lorsque j’enquêtais sur le chant des femmes, à l’instigation de Georges Lapassade. Elle résidait à derb adouar , une sombre impasse qu’évoquait le rzoun , le chant oublié de la ville :
Ô toi qui s’en vas vers Adouar
Emporte avec toi le Nouar
La rime est un jeu de mot entre « Adouar » (le nom de la sombre impasse supposée cacher les belles filles de la ville) et le « Nouar » (le bouquet de géranium et de basilic).. Au début des années cinquante, le souvenir était encore vivace du tournage d’Othello par Orson Welles à Mogador. Le soir on le voyait souvent méditer sur la grande place du syndicat d’initiative. Dans le film, on reconnaît surtout « Tik-Tik » avec son luth au pied des remparts de la Scala de la mer. Sa mère m’avait récité un chant de femme où il est dit :

Sadya Bayrou
Pourquoi je suis partie et pourquoi je revienne ?!
Aux pays lointains chacun me médit
Que le chemin est long, les chameaux sont fatigué
Mais mes pas continuent à le parcourir...
La qasida du Gnaoui
Lors de la soirée musicale, je découvre, la qasida du Gnaoui que je ne connaissais pas : Elle est ducheheïkh Thami Mdaghri (de Mdaghra au Sahara), qui a vécu( au 19ème siècle )de longues années à Fès et Marrakech : elle raconte l'histoire d'un Gnaoui à scarifications sur les joues qui tombe amoureux d’une gazelle et surtout qui tombe en transe par dépit amoureux La maladie d’amour comme possession par le bien-aimé auquel on aspire à s’unifier. Et pour le soigner, on fait appel entre autre à une voyante médiumnique !

Sadya Bayrou
Al harba (le refrain)
Ma bien-aimée me reproche mon état, sachant bien ce qui m’arrive
Mes joues sont scarifiées et les siens rayonnent
Elle me charme par son tempérament de feu et son grain de beauté.
Al qism al aoual( première partie) :
Qu’il est terrible le jour où les miens sont partis
Me laissant pleurant sur les ruines,
Que Dieu apaise les flammes de celui qu’abandonnent les siens
Ils ont décampé sur la trace des étoiles
Ah, si je pouvais accompagner le rubis scintillant de mille feux
Au désert mon cœur erre désormais seul derrière les mirages !
Perdu à jamais , s’il n’y avait ce tintement de cloche,

Al qism al tâni (deuxième partie) :
Que ma désolation est grande, le jour où la caravane est partie
Derrière les lointaines rumeurs du désert
Le moindre bruit attise mes soupirs
Les gazelles errantes sont dispersées par le vent
Me trouvant perdu m’ont dit : « Qui es-tu ? »
« Esclave Gnaoui aux joues scarifiées sans remède pour son mal» leur dis-je
Sillons creusés sur mes joues, par le flot des larmes
Par amour, elles ont asservi , ma peau noire
A leur service, j’attiser les cendres éteintes
J’irrigue les champs assoiffés et j’ajuste la mesure
Je consolide l’encrage des tentes
Je redresse les étais de celles qui s’affalent
Elles se dirent alors : « Cet esclave est utile, pas si cher pour ce qu’il vaut »

Sadya Bayrou
Al qism al talet (troisième partie) :
Elles m’ont mis à prix en augmentant les enchères
Tirant au sort les bâtonnets sur le sable
Le mien a désigné une autre que celle que j’aime
J’en suis tombé en transe,
Ecumant par la bouche, sans prise sur mon état
Elles se dirent alors : « Celui-là est un possédé »

Sadya Bayrou
Al qism al rabiâ (quatrième partie) :
Ma maîtresse m’a rapproché d’elle
M’encensant de benjoin et de bois de cantal
C’est alors que le melk qui me possède s’adressa à elle
« Pour qu’il guérisse, il faut un sacrifice » lui dit-il.
Lui conseillant une voyante ou un homme-médecine
Ou encore un devin prescrivant les écritures
A elle mes secrets se dévoilèrent
Souriante, sur moi elle exhala son musc
Que Dieu me fasse de son parfum délivrance

Sadya Bayrou
Al qism al khamis (cinquième partie) :
A cause d’elle, j’ai oublié tout ce que j’ai appris
Et quand j’ai retrouvé mes esprits, elle l’a à nouveau ensorcelé
J’en suis tombé malade et rien ne peut m’en guérir
Le poète du malhûn était souvent considéré comme un mejdoub, et les connaisseurs du melhûn sont ses « adeptes », dans le sens où ils n’ont pas un simple rapport esthétique avec cette poésie, mais un rapport mystique proche de la possession rituelle. C’est une poésie ritualisée, me disait Abdelkébir Khatibi, qui considère Sidi Abderrahman el-Majdoub comme le meilleurs poète marocain jusqu’à maintenant. Vagabond mystique et poète, el – Mejdoub a vécu au XVIe siècle dans le Gharb. Ses pouvoirs magiques ainsi que ses quatrains, souvent caustiques, le rendirent célèbre. Parmi ses célèbres quatrains celui où il prédisait l’engloutissement de la ville sous le déluge :

Sadya Bayrou
« Essaouira périra par le déluge
Un vendredi ou un jour de fête,
Marrakech est un tagine brûlant,
Fès, une coupe transparente.... »
En guise de commentaire à ce quatrain, un pèlerin tourneur du printemps m’a dit un jour : « On raconte que le Mejdoub était fou. Mais tout ce qu’il disait arrivait. L’œil verra ce que l’oreille entend. On raconte qu’il était fou, mais il voyait avec « l’œil du cœur ». L’œil – la vision du Majdoub – n’est pas simple regard ; il est « l’œil du monde », comme disait Schopenhauer : « le pur connaître »...Il pratiquait donc la voyance en état de transe !

Sadya Bayrou
L’expérience de Sidi Boudhaab
Autant que faire se peut, Georges Lapassade pratiquait de l’observation participante auprès de ces confréries de la transe. Il provoquait même des « nuits bleues » pour contribuer à les observer, comme ce fut le cas pour les nuits bleues des Gnaoua à Essaouira(festival de 1980-1982) et au premier festival de Safi(1983), avec les nuits bleues de Sidi Boudhab (le marabout de l’or)..
Cette animation était comme un dispositif de visibilité selon l’expression des ethno-méthodologues ou encore un analyseur culturel. Pour comprendre la culture de Safi, il fallait l’organiser, y participer. Dans l’entretien paru par la suite à Maroc-Soir du lundi 1er septembre 1986, Georges Lapassade faisait le bilan de cette expérience en ces termes :

Sadya Bayrou
«Une expérience assez étonnante, me disait-il et qui vaut la peine d’être racontée. Nous avons obtenu, non sans peine de la Direction du Festival, qu’on organise chaque soir à Sidi Boudhab, à l’entrée de la vieille médina, après le spectacle donné dans le château de la mer, une nuit confrérique. Et très vite les difficultés se sont accumulées : on devait chaque soir, avec Abdelkader Mana, qui était invité au colloque, mais qui était avant tout militant de la culture populaire, on devait dis-je chaque soir balayer les poissons pourris qui jonchent la place que protège le marabout. Ensuite, nous devions transporter des nattes avec l’espoir que les gens viendraient s’asseoir selon la tradition de la lila. Hélas, le premier soir, la place était envahie dans une énorme confusion par les curieux. Mais nous n’avions pas à les faire asseoir. Nous avions oublié que Sidi Boudhab à Safi, est avant tout un haut lieu de la Halka, y compris celle des Gnaoua. Et les gens de Safi ne pouvaient pas comprendre immédiatement que les mêmes Gnaoua venaient maintenant à minuit pour tenter d’y instituer le rituel de la Derdeba avec ses transes et ses danses de possession. C’est seulement à la fin du festival, comme par miracle que les jeunes de la médina ont compris le projet et l’ont soutenu. Une immense Jedba animée par les Hmadcha s’est installée vers minuit sur la place de Sidi Boudhab.
Cette expérience rendait visible la permanence à Safi comme probablement ailleurs, d’une vieille culture de médina, dans laquelle la transe et le Soufisme populaire ont une part de choix. C’est ce qui explique d’ailleurs l’immense succès qu’ont connu dans le Maghreb, les « Jil » par exemple Nass El Ghiouan. J’ai retrouvé cela à Tunis, à Constantine où pourtant la vieille culture maghrébine semble moins vivante qu’au Maroc. Je l’ai aussi constaté à Casablanca après Safi. Là, à Casablanca, dans une vieille médina rétrécie, cette culture reste vivante et enracinée. Peut-être, faudrait-il décrire un jour cette culture de médina à Casablanca dans le contexte offensif de la modernité comme une contre-culture. Pour toutes ces raisons, je me réjouis de constater d’une année à l’autre, que le Festival de Safi continue. Mais ce qui me fait plaisir par-dessus tout, c’est de savoir qu’on a gardé dans le programme du festival, les nuits de Sidi Boudhab. »

Le plus vieil arbre d'Essaouira
Le 31 août 1983, je participe pour la première fois au moussem des hamadcha, en tenant sur les conseils de Georges Lapassade, un journal de route où je découvre en la décrivant la transe et ses adjuvants rituels. Le soir j’accompagnais ârabi ,le tambourinaire noir au yeux exorbitants en notant ceci à propos de leur adjuvent rituel :
Hamdouchi, tourneur sur bois de son état, rencontré à Sidi Mogdoul, me dit en préparant sa pipe de kif : « Tout ce qui brûle au feu n’est pas impur. Jadis, on cachait le kif dans le tambour. Le moqadem disait : « Fumez où bon vous semble, sauf dans la salle de prière. »Nous gens du hal, nous avons besoin de fumer jusqu’à ce que nos yeux soient hors des orbites pour pouvoir chanter et faire monter le saken (l’habitant surnaturel) ».
Et c’est en ces termes que je décrivais les scènes de transe :
Pour la première fois des gens du public tombent en transe. Un jeune homme de 18 ans perd le contrôle de ses gestes. Une autre jeune fille se roule par terre en pleurant. Elle retire son peignoir que prend sa sœur qui l’accompagne et qui paraît plus étonnée d’être parmi les hommes que de l’état de sa sœur. Un boucher me dit plus tard que la possession de cette fille cessera avec le mariage. Le public l’observe avec sympathie et compréhension. Non pas en tant que cas pathologique, mais en tant que personne en contact avec le surnaturel. La jeune fille s’effondre dès que la musique cesse. Le public se précipite autour d’elle. Dakki, le jeune hautboïste d’Essaouira leur dit :
« Eloignez-vous, elle n’a rien, c’est seulement le hal, apportez le brasero et l’encens… »
.Après avoir respiré ce parfum, elle sort de sa transe et va se reposer.
En participant à ce moussem, j’ai rêvé moi-même que je suis tombé en transe. En le rapportant le lendemain à Georges Lapassade, il me dit : « Tu résistes à la transe en état de veille parce que tu es occidentalisé, mais au sommeil tu cèdes à ta culture profonde qui est fondée sur le hal. » .
Dans le langage populaire marocain, la transe se dit hal , c’est à dire l’état de celui qui est « saisi » qui est « possédé » par les esprits et qui tombe en transe pour cette raison. Un chant de la confrérie des Ghazaoua évoque le hal en ces termes :

Sadya Bayrou
Le hal, le hal, Ô ceux qui connaissent le hal !
Le hal qui me fait trembler !
Celui que le hal ne fait pas trembler, je vous annonce ;
Ô homme ! Que sa tête est encore vide
Ses ailes n’ont pas de plumes
Et sa maison n’a pas d’enceinte
Son jardin n’a pas de palmier
Celui qui est parfait, la calomnie ne l’effleure pas
Sidi Ahmed Ben Ali le wali
Prends-nous en charge, Ô notre cheikh !
Sidi Ahmed et Sidi Mohamed
Ayez pitié de nous. »

Sadya Bayrou
Le hal est cette énergie supérieure qui dictent aux Gnaoua en état de transe le choix de telle ou telle couleur, et qui dictaient à Sidi Abderahman el- Mejdoub en extase ses fameux quatrains. Le « Mejdoub », est celui qui est possédé par le hal.
Abdelkader MANA
13:01 Écrit par elhajthami dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poèsie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
25/06/2010
L'arbre du Malhûn
L’arbre du malhûn

Sadya Bayrou nous a quitté à la force de l'âge(Essaouira, 1963-2010). Pleine de fougue et de créativité. Son art relève autant de la poésie que de la peinture: une palette d'or imprégnée de mysticisme. Dés que j'ai appris son décès à Essaouira je me suis empressé de lui rendre hommage aux travers les images de la salle de prière des femmes de Moulay Abdelkader Jilali. J'ai voulu récupérer des images de ces oeuvres auprès de son mari, mais celui -ci était trés éprouvé pour répondre à mes sollicitations..Maintenant c'est chose faite avec l'exposition "Traces et mémoires" qui lui est consacrée au bastion de Bab Marrakech. Elle aurait été très heureuse d'assister à ce vernissage auquel elle a préparée elle - même un catalogue. On peut y lire une citation d'elle où elle écrivait: "Les traces nous font remonter le temps et nous guident à travers bien des espaces. ils traduisent des aspects de notre vécu et de nos mémoires enfouies. Les traces font rêver...". En effet, chez Sadya Bayrou comme chez beaucoup de femmes marocaine, la frontière entre la réalité et le rêve est ténue et bien souvent le rêve se confond avec la réalité voir s'y substitue...Ce son ses oeuvres qui accompagnent ce texte sur l'arbre du malhun qui rend hommage à d'autres poètes disparus...

J’aimerai mettre en exergue à ce texte « L’arbre jouant au saxophone », poème de mon ami Moubarak Raji, qui s’incrit véritablement, avec sa modernité et sa fraîcheur, dans la lignée des grands poètes du Malhun local :
L’arbre jouant au saxophone
Accueille des nuées d’oiseaux invisibles
C’est l’arbre de la vie,
Qui ne se crucifie, ni par les clous, ni sur les murs
Depuis que l’arbre est arbre
Tous les souffles sont vibrations d’ailes sur l’arbre
Le souffle de l’âme
Le souffle du saxophone
Le souffle du souffle
L’arbre jouant du saxophone
A effacé de son destin
Le cauchemar de devenir une porte de prison
Ou de se transformer en poignée de cendre dans un four
L’arbre jouant au saxophone
A toute la nuit derrière lui
Une nuit qui s’engouffre toute entière
Dans les orifices d’une petite oreille
Tel l’univers dans le trou noir…
Le melhûn, comme composante de l’identité culturelle des artisans des vieilles cités marocaines, est à la fois un legs bédouin sur le plan poétique et un legs andalou sur le plan musical. Beaucoup de mots de cette poésie populaire ne sont plus usités. Il serait le chant par lequel les chameliers rythmaient le déhanchement des caravanes. Maître Laânaya, forgeron de son état, au quartier des Sraïria où l’on fabriquait les armes à Meknès,fait même remonter les origines du melhûn , aux temps immémoriaux (la seconde moitié du Xe siècle),où les Béni Hilâl, « pareils à une nuée de sauterelles »,font leur apparition aux frontières de l’Ifriquiya (l’actuel Maghreb).

Une des oeuvres de Sadya Bayrou :"Traces et moires", Essaouira vendredi 25 juin 2010
La majeure partie des poètes est originaire de Tafilalet, notamment leur prince, Mohamed El Maghraoui,surnommé « l’arbre du melhûn ».Il était pasteur-nomade, se déplaçant avec son troupeau entre le Sahara et les plaines de la côte atlantique. Un jour qu’il sortait du souk avec son troupeau , une sauterelle s’est posée sur la corne d’un bélier. Elle ne l’a plus quitté jusqu’au Sahara, le pays d’origine du poète-pasteur. Le troupeau s’étant mis à l’ombre d’un muret, une salamandre noire marbrée de taches jaunes sortit d’un trou pour dévorer la sauterelle sur la corne du bélier. Le poète qui assistait à la scène s’exclama alors :

« Après tant de chemin parcouru, celui qui destina la sauterelle à la salamandre, apportera sa nourriture au Maghraoui en sa demeure ! »
Parmi les autres poètes du melhûn, on cite également Thami Lamdaghri de Mdaghra au Sahara qui a vécu de longues années à Fès et Marrakech. L’une de ses qasidas les plus célèbres s’intitule La lanterne. On ne sait d’ailleurs pas si cette lanterne est faite pour éclairer tout le monde, ou lui seul :
Ton manque m’ébranle, ô lanterne !
Branche brisée, tu m’as jeté au milieu des arbres
Sans pareil parmi les délaissés !

Non loin des chandeliers et des candélabres de Moulay Idriss à Fès, en collectionneur averti, Si Abdelkader Berrada exhibe de sous le paillasson, tout un florilège de melhûn inscrit avec un grand soin sur un registre de commerce ! Pour lui cette poésie populaire est aussi un art musical et plus précisément un tarab cette émotion musicale qui aboutit à l’extase :
« À travers le temps, les poètes ont fait du melhûn un tarab. À l’origine les gens du Sahara rythmaient leurs qasidas uniquement en battant des mains. Puis vinrent les terrassiers qui tenaient la mesure en aplatissant le sol et en rythmant de la plante des pieds, ce qui a d’ailleurs donner naissance à cette danse qu’on appelle « rakza » ».

Pour Hussein Toulali, le chantre de Meknès et du Maroc, le melhûn était né, en quelque sorte, pour commenter la prose du monde :
« On commentait les événements qui se déroulaient dans ce bas monde. Puis, il est venu un temps, où un certain homme des Jbala, s’est mis à découper la qasida en strophes pour permettre aux chanteurs de respirer, quand la chorale lui réplique par un refrain ».
Pour Laânaya, le forgeron Meknassi, au moment où il eut l’expulsion des Morisques d’Espagne vers le Maroc en 1610, il s’est établi un échange entre leurs musiciens et les poètes du melhûn. Ce sont eux qui ont introduit les instruments à cordes dans l’orchestre du melhûn. Auparavant cette poésie était rythmée uniquement par des instruments de percussion : al handka (castagnettes), la taârija (tambourin) et le dûf (cadre de bois entouré de peau de chameau qui scande aussi la parole du conteur).
C’est à partir de ce contact avec les Morisques qu’on voit apparaître des modes de la ala andalouse – Al Maya, lahgaz, Sika, Rasd, Al Istihlal – dans les mesures du melhûn.
Laânaya, le maître forgeron de Meknès, se souvient encore de son premier jour d’initiation :
« J’ai découvert le melhûn grâce à un gardien de nuit, chargé de surveiller les boutiques du souk. À l’époque je me réveillais tôt pour nettoyer ma boutique. Et lui passait par là, en chantonnant pour son propre plaisir. Je l’écoutais sans vraiment tout comprendre, mais j’appréciais la musicalité des mots. Un jour, je lui ai offert deux beignets, en preuve de mon admiration. De debout qu’il était, il s’est assis par terre. Et il commença à m’expliquer la qasida qu’il chantait. L’amour de la parole poétique habitat alors ma conscience. Il me demanda :
- Veux-tu apprendre ?
- Bien sûr, si je pouvais.
Il m’apprit deux qasidas. Toutes deux portaient sur l’aube. La première est celle de Sidi Kaddour El Alami, dont le refrain dit :
La nuit s’est dissipée,
Prélude à une aube lumineuse.
La musique s’embellit,
Par la coupe qui fait le tour des convives.
La seconde qasida est « Lafjar » (aube) de Mohamed Ben Sghir, le poète du melhûn d’Essaouira. On l’avait retrouvée dans un cahier daté de 1920 :
Vois le ciel au-dessus de la terre, source de lumière
Les habitants de la terre ne peuvent l’atteindre
Vois Mars, toi qui es indifférent
Sa beauté apparaît au monde clairement
Vois Mercure qui vient à toi, ô voyageur
Au dessus du globe, de l’ignorance étonnante
Vois Neptune qui illumine les déserts
Il a mis dans la création, le riche qui a tout.
Vois Saturne qui vient visiblement vers toi
Au-dessus des sept du secret parfait
Guerre des hommes, ô toi qui dort,
Vois le mouvement des astres
Ils ont éclairé de leur lumière éclatante, les ignorants.
Et sache la vérité si tu veux être pur
Lafjar (l’aube) qui t’advient d’une science illuminée
Prends ô toi qui m’écoutes Yabriz et Nikir
Celui qui règne sur le plus rusé des loups
Celui qui répond très vite au défi
Doit protéger les fauves
Est-ce que le hérisson peut aller à la guerre contre l’ogre ?
On connaît l’aigle parmi les faucons
Il craint le moindre bruit et les fauves au sommet des montagnes
En passant par les grottes Bendir Telemsani et son beau cortège
Dites à celui qui n’est ni faible ni vantard
Que Mohamed Ben Sghir est une épée dégainée.
De seigneur qu’il était Sidi Kaddour Al Alami, finira par devenir un mystique errant entre les parvis sacrés, dans un univers où les valeurs et les rôles sociaux se sont inversés :
L’aigle apeuré rentre ses griffes
Quand le hibou chasse l’hirondelle.
Ce poète qui était l’âme même de la générosité, toujours au service de ses amis, a fini par devenir mystique et misanthrope :
Un jeu sur la pointe d’une lance,
C’est comme ça que je vois,
La grande fréquentation des hommes.
Ce désenchantement du monde, il le doit à l’amère expérience qui l’avait conduit à perdre sa belle demeure pour s’abriter sous des auvents, dit-on qu’il décrivait comme un lieu où :
Les étourneaux frôlent l’eau qui ruisselle dans les canaux inclinés,
Comme les poissons fuyant dans les lacs,
Les hameçons que leur jettent les pêcheurs.
Cette interprétation recueillie par Khiati à la coupole du souk est désapprouvée par le forgeron des Sraïria de Meknès, pour qui il faut plutôt comprendre :
Les oiseaux de la maison
Sont aux aguets,
Picorant, s’envolant,
Tels les poissons des côtes rocheuses
Fuyant les hameçons.
C’est ainsi que sont les amis
Prompts à s’attrouper autour du verre
Et à se dissiper quand la main est vide.
Quand la nourriture est abondante à toute heure
Que d’amis, m’entourent !
Que de compagnons me font la cour !
C’est un pôle mystique parmi d’autres. La nuit, il dormait sans feuilles ni plumes, mais le lendemain le mur se noircissait par ce que la nuit dictait au jour. On le considérait comme un Mejdoub qui aurait reçu l’inspiration d’en haut : il se rendait souvent à Moulay Idriss Al Akbar du Zerhoune, pour s’adonner dans l’isolement à la prière. Il ne devait rentrer chez lui, qu’après être « autorisé » - par un rêve divinatoire. Une fois, la dévotion du poète a duré trop longtemps, sans que Moulay Idriss lui apparaisse dans le rêve pour l’autoriser à quitter les lieux. De guerre lasse, il se dirigea à pied vers la ville de Meknès. En cours de route, un homme lui demanda :
- Où vas-tu comme ça ?
- Je vide le pays pour le laisser à ses habitants. Depuis que je suis ici, je n’ai pas reçu de Burhan (preuve surnaturelle).
Un peu plus loin, le même personnage lui apparut une seconde fois :
- Où vas-tu comme ça ?
- Je fus délaissé alors que d’autres, venus après moi, ont eu ce qu’ils voulaient.
- Non, lui répliqua l’apparition. Tu es le fils de la maison, alors que les autres ne sont que de simples hôtes. À ce titre, ils ont la priorité sur les propriétaires de la maison.
Et il lui tendit un ustensile contenant du miel. Le seigneur des poètes en but une gorgée et continua son chemin. Arrivé à un oued, il lava l’ustensile. L’eau en devint sucrée. Depuis lors, on l’appela Oued Bou Âssoul (rivière de miel). C’est ce qu’on raconte chez les gens de Zerhoune et d’ailleurs, et Allah est le plus savant. Son mausolée est richement décoré par de vieux lustres, des calligraphies sur l’une d’entre elles, on peut lire : « Par la plume et ce qu’elle a tracé » des poèmes, des tapis, et surtout de vieilles horloges qui semblent s’être arrêtées à une heure indéterminée du passé.
Sidi Kaddour El Alami était un maître, et les connaisseurs du melhûn sont ses « adeptes », dans le sens où ils n’ont pas un simple rapport esthétique avec cette poésie, mais un rapport mystique proche de la possession rituelle. Et le producteur de melhûn qu’on appelle Sejaï n’était pas non plus un simple poète, mais un mejdoub, une sorte de fou de Dieu, auquel on élève parfois un mausolée après sa mort. Les initiés – ces priseurs de tabatières, ces joueurs de ronda qui semblent « tuer le temps », sont en fait en quête permanente de la sjia, cette sorte d’extase, cette voie mystique que la poésie et le chant rendent possible. En ce sens, le melhûn devient un besoin fondamental pour l’équilibre spirituel et psychique de l’individu. Une sorte de « drogue poétique » à laquelle on s’accoutume autant qu’au tabac à priser. C’est en cela que cette poésie diffère fondamentalement de ce qu’on entend généralement par « poésie » dans notre monde moderne : son but n’est pas esthétique, mais spirituel.
Abdelkader MANA
15:22 Écrit par elhajthami dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poèsie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook












