26/11/2009
Miroir et mémoire
Miroir et mémoire

Georges a Essaouira, 1993 (photo de Luigi Di Cristo, archives de G. De Martino)
Georges Lapassade, l’ami d’Essaouira depuis toujours nous a quitté le mercredi 30 juillet 2008. Il est décédé dans une clinque parisienne puis a été inhumé dans le caveau familial d’Arbus en Béarn. Retour aux sources :
« Je suis parti d’Arbus et j’ai commencé à écrire pour exister. » écrivait-il dans son Autobiographe. Toute sa vie fut consacrée à l’écriture. Quiconque a rencontré Georges a fait quelque chose de sa vie. En tant que pédagogue-né, Georges Lapassade a, en effet, formé beaucoup de gens à l’écriture, aussi bien au Maroc, en France, qu’en Italie où il travaillait avec Gianni de Martino et un groupe de recherche sur la tarentule.Dans son Autobiographe Georges Lapassade écrit encore :
« Je suis né à Arbus, le 10 mai 1924.On raconte qu’à l’époque mon père chantait, sur un air de bourrée :
« Si l’Bon Dieu nous donne un garçon
A la saison des asperges
Toutes les filles du canton
Lui feront brûler un cierge... »
Le monde se situait pour nous, à peu près entre Pau et Monein. »
De là il partira à l’assaut de Paris, comme le Lucien des illusions perdues de Balzac, où il sera le père fondateur de l’analyse institutionnelle, et une autorité mondiale en matière d’ethnométhodologie des rites de possession et de transe.
Depuis 1969, Georges Lapassade a séjourné à peu près régulièrement, à Essaouira, chaque été :
« J’arrive à Essaouira dans les premiers jours de juillet. Au début, je trouve que l’odeur de sardine est trop forte, presque insupportable. Je feuillette quelques manuscrits, j’en apporte toujours avec moi quand je prépare un nouveau livre. Je les transporte dans mes sacs de toile et dans le grand cabas de ménagère que j’ai acheté l’été dernier au marché de Lisbonne chez un marchand de couleurs dans le quartier Belem-Blem-Blum. C’était à Belem. Je chantais toujours Belem-Blem-Blum en souvenir de la macumba. Le coq a chanté, il était minuit à Belem-Blem-Blum. »
Le chant de la macumba du Brésil, le stembali tunsien, les gnaoua marocains et enfin le rap parisien, partout où il allait Georges était fasciné par la contre- culture et les rites de possession de la diaspora noire et il les mettait à l’honneur, ce qui lui valu une distinction honorifique de Léopold Sédar Senghor, et une lettre de félicitations personnelle de Sa Majesté le roi Mohamed VI, lors de la parution de son ouvrage sur les Regraga intitulé D’un marabout, l’autre à la manière D’un château, l’autre de Céline.
Il venait surtout à Essaouira pour écrire tel ou tel de ses livres comme il le raconte dans son Autobiographe :
« Je revenais de Marrakech par l’autocar de la nuit. C’était une nuit de ramadan. Au levé du jour, le car s’est arrêté en rase campagne. Et ils sont descendus du car pour prier...Il faut un désir plus haut que la mort habituelle et plus haut que l’ennui pour que soudain, c’est tout à fait imprévisible, on puisse commencer à délimiter un espace blanc, comme des marques de fortune dans le désert des pierres blanches posées sur le sol pour une prière. Il conviendrait de justifier ce blanc où des mots peuvent s’inscrire à condition d’écrire selon la loi. Dans cet espace blanc ainsi délimité nous serions tournés vers l’est, très attentifs. Le jour se lève à l’est dans une lueur cassée, une lueur de nuit défoncée par le jour. La lune n’a jamais cessé d’éclairer la plaine pendant notre voyage toute la nuit la lune toujours là-haut dans le ciel, le temps est suspendu au fil de l’indécision comme si le jour hésitait à se lever....Je fais un effort pour écrire sur ma vie à Arbus ; il me faut pour cela retrouver des souvenirs. Je vais essayer. Toutes nos fêtes étaient religieuses. Elles marquaient la marche du temps. »
Et à Essaouira, il s’intéressait beaucoup aux fêtes religieuses, celle des Gnaoua au mois lunaire de Chaâbane, celles qui célèbrent la nativité du Prophète, mais aussi aux fêtes saisonnières en particulier le pèlerinage circulaire des Regraga. J’avais déjà lu son brillant article sur l’Emile de Jean Jacques Rousseau qu’il avait publié dans la revue Métaphysique en 1952, aux côtés de Bertrand Russel, mais je le voyais de loin enquêter à Essaouira sur les Gnaoua. J’enseignais alors au Lycée Akenssous de la ville. Un jour, au tout début des années 1980, le proviseur du lycée m’invita à une réunion prévue vers 16 heures à la Chambre du commerce, entre Georges Lapassade, et les connaisseurs du Malhoun de la ville. La réunion était provoquée par Georges qui enquêtait alors sur Ben Sghir, le chantre du malhoun souiri. A l’origine de cette enquête, un article où Hachmaoui et Lakhdar, résumaient la qasida de Lafjar (l’aube) de Ben Sghir sans donner le texte. Après cette réunion à la chambre du commerce, Georges m’embarqua dans l’enquête sur les traditions musicales d’Essaouira et de la région qu’il menait à l’issue du festival d’Essaouira (1981). Une fois à Paris il me faxa ce qui suit à propos de l’article controversé sur le malhoun :
« Ce qui choquait mon esprit de cartésien, y écrivait-il, c’est que nous avons découvert que le cahier d’un certain Saddiki (grand’père du prof. d’histoire du même nom) qu’il avait exposé au Musée et « commenté » était daté en réalité de 1920, et non de 1870 comme ils prétendaient, tirant argument de cela et du contenu du cahier, pour inventer une sorte de pléiade poétique souirie qui aurait eu pour mécène vers 1870, à Essaouira, Moulay Abderrahman ! C’est cela que je contestais beaucoup plus que l’origine souirie de B.Sghir. En effet, ce cahier contenait des qasida diverses, recueillies (peut-être) par le grand’père Saddiki au cours de ses voyages à Marrakech qui du coup devenait souiri ! Etant donné l’impossibilité d’avancer à Essaouira, j’ai fini par me décider d’aller consulter à Marrakech Maître Chlyeh, animateur d’une sorte d’Académie du malhoun. Il m’a fort bien reçu, bien informé et je crois (sans en être sûr) que la version de Lafjar que j’ai ensuite diffusé à Essaouira venait de lui »
Toute la démarche de l’enquête ethnographique de Georges Lapassade réside dans ce texte : alors qu’il demandait des informations sur Ben Sghir, au bazariste Ben Miloud, celui-ci était assis sur un vieux coffre qui contenait plein de qasida, dont celles de Ben Sghir ! C’est pour contourner cette rétention d’informations, ces réticences locales qu’il se voyait obligé de se rendre à Marrakech pour obtenir la fameuse qasida de Lafjar (l’aube) !
L’enquête pourrait durer des années, chaque été il revenait à la charge avec son obsession de chercheur et son doute cartésien pour reposer encore et toujours l’énigme Ben Sghir. Il soulevait d’autres lièvres qu’il problématisait à souhait alors même qu’on croyait avoir affaire à des évidences : le sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah avait fondé le port et l’ancienne kasbah et non pas toute la médina comme on le croyait auparavant. Le plan établi par Théodore Cornut en 1767 est là pour prouver que Georges avait raison. Au XVIII ème siècle, en dehors de la Kasbah, les gens habitaient sous des tentes et dans les casemates qui donnaient à Essaouira un visage militaire, à côté du quartier administratif.
De même l’emplacement du Castello Real des Portugais se trouvait d’après une ancienne carte établie par Lambrecht, au port et non pas à l’embouchure de l’oued Ksob où se trouve borj el baroud. Cette erreur a été souvent commise concernant l’emplacement exact de la forteresse. On donnait, comme ruine de l’ancien fort portugais, un bastion rond situé dans les dunes, auprès de l’ancienne embouchure du Ksob, non loin du palais ensablé bâti au XVIII ème siècle par Sidi Mohamed Ben Abdellah. Ce fort n’a rien de portugais, affirmait Georges à juste raison. Il s’agit simplement d’une batterie construite, elle aussi, par le sultan. Toute sa démarche en matière d’enquêtes ethnographique est fondée sur ce doute cartésien, cette remise en cause permanente des évidences à la Ptolémée.
Pour ne pas « bronzer idiot » sur la plage d’Essaouira, Georges aura à résoudre une autre « énigme », qui relève cette fois-ci du Maroc antique. Jusqu’en 1950, on pensait que les Phéniciens et les Romains n’avaient peut-être pas dépassé le Nord du Maroc, alors que du côté de Luxus et Volubilis on avait les preuves évidentes de leur présence, il n’y avait rien de semblable au Sud jusqu’au jour où des enseignants, MM Desjacques et koeberlé allaient entreprendre des fouilles systématiques dans l’île de Mogador, qui prouvent que le monde antique allait en réalité beaucoup plus au sud que le fameux limes, plus exactement jusqu’à l’île de Mogador qu’on peut identifier à la mythique Cerné qu’évoque le périple d’Hannon . En 1985, Georges Lapassade profite du passage dans la ville de Desjacque et de sa femme pour les interroger à ce sujet, et publie le résultat de cet entretien sous le titre : « la petite histoire d’une grande découverte » :
« En 1950 Desjacques et Koeberlé enseignants à Mogador, consacraient leurs loisirs à la recherche des silex taillés de l’époque préhistorique. Cette recherche les conduisit dans l’île d’Essaouira où ils trouvèrent dans le sable des fragments de poterie, des pièces de monnaie. Des fouilles plus systématiques furent entreprises aussitôt. En creusant assez profondément du côté de la plage de l’île, sur le « tertre » on a mis à jour une couche phénicienne, la plus profonde, et des couches plus récentes en particulier celle des Romains du temps de JubaII. La petite histoire de cette recherche nous était jusque là inconnue. Desjacques nous l’a racontée, la voici :
- Comme il était interdit, raconte Desjacques, de chasser sur le continent en période de fermeture, la société de chasse locale Saint Hubert élevait des lapins dans l’île. Les lapins avaient brouté l’herbe et mis à nu le sol. Par le vent qui emportait le sable, par érosion, les pièces antiques étaient visibles à la surface du sol.
Mais il fallait pour éclairer la première découverte faite dans l’île une référence que Desjacques et Koeberlé connaissaient bien : le court récit dit du « périple de Hannon », sauvé de la destruction de Carthage dit-on, par un copiste grec. Ce document décrit le parcourt du navigateur chargé de retrouver et fixer les étapes d’un parcours maritime. Le contenu du texte interprété donna à Desjacques et Koeberlé la conviction d’avoir mis à jour la preuve d’une étape phénicienne dans l’Atlantique peut être Cerné « où nous fondâmes une colonie » écrit l’auteur du périple d’Hannon. Ils organisèrent alors un petit Musée pour leurs élèves et pour la ville à la Sqala :
- C’était une pièce minuscule qui abritait tout ce que nous ramenions de l’île : les débris de vases, les pièces de monnaies. Raconte Desjacques.
Les pièces sont maintenant au Musée d’archéologie de Rabat. Desjacques et sa femme vont séjourner en vacances chez des amis qui habitent à Agadir :
- Nos amis, demeuraient près du rivage de l’Océan, raconte Odette Desjacques. Un jour de grandes marées, à l’heure où la mer était retirée loin de la côte, j’ai vu des femmes ramasser des coquillages dans les rochers. Elles cassaient les coquilles, les broyaient, les lavaient à l’eau de mer et conservaient dans de grands couffins, la partie comestible. Je me suis approchée d’elles, et j’ai remarqué alors que leurs mains étaient violettes. Or nous parlions souvent, à Mogador, avec mon mari et Koeberlé de la fameuse pourpre de Gétules pour laquelle les Romains avaient installé dans l’île des « fabriques ». On ne savait pas comment la teinture était fabriquée. Et voilà que ces femmes d’Agadir nous apportaient la solution de l’énigme ! Je me souviens que nous avons mis quelques coquillages brisés dans un tissu de coton blanc qui a toujours gardé la couleur...Il y avait, dans le coquillage, une glande jaune au moment où on la recueillait en cassant la coquille. Puis la couleur changeait au soleil et devenait verdâtre, puis violette, plus précisément « pourpre »....Nous avons apporté quelques coquillages vivants à Mogador, nous les avons déposé dans les rochers à la « plage de Safi » pour essayer de les faire reproduire. Mais le sable les a recouvert. Or sur cette même plage, nous avons trouvé des coquillages pour être précis, les purpurae haemastomae, vides avec un trou dans la coquille. C’est par cet article qu’on extrait la précieuse glande. On pourrait probablement en trouver encore aujourd’hui au même endroit. Nous en avons fait identifier, à Paris au Muséum, les résultats ont été probants.
Le site de l’île comme lieu de fouilles a été trouvé on l’a vu, par hasard alors qu’on y cherchait des silex taillés...Le succès de cette recherche devrait inciter nos archéologues marocains à rechercher d’autres traces d’antiquité sur le littoral. » Concluait Georges qui ne croyait pas si bien dire, puisque récemment encore, des marins ont pris dans leurs fillets , deux amphores antiques, tout à fait intactes, recouvertes seulement d’algues et de coquillages...
Lors de ses séjours à Essaouira, Georges aimait souvent se rendre à ce borj el baroud lieu de ralliement du mouvement hippie dans le sillage duquel il avait découvert pour la première fois Essaouira en 1968 avec le Living Théâtre :
« 19 h 30. La sirène du ramadan a hurlé, ce soir pour la première fois. Il fait presque nuit. Tristesse maintenant sur la ville déserte. Je retrouve l’angoisse de l’année dernière. Les lumières de la rue s’allument lentement....Le soleil s’est levé tard ce matin. Il faisait froid, un petit vent mauvais courait sur la plage, au ras du sable, jusqu’aux grandes dunes qui entourent, là-bas, le borj el baroud. Il m’a semblé tout à l’heure que j’allais enfin me décider à écrire le récit chronologique de mon enfance, puis de ma jeunesse, jusqu’à mon départ définitif d’Arbus et mon installation à Paris. J’ai cru que j’avais retrouver le courage nécessaire pour me lever à des heures fixes et travailler. J’étais convaincu que ce moment tant attendu était enfin arrivé, après une longue attente. La chaleur de l’été est enfin revenue. J’ai retrouvé ma chambre d’autrefois inondée de soleil tout le jour. Je peux contempler le mouvement incessant des bateaux dans la baie, et dans le port. Hier j’avais décidé d’écrire le récit de mon enfance. Mais je ne trouve que des bribes de souvenirs. Je ne sais comment les souvenirs arrivent à ce moment-là, ni pourquoi tel souvenir plutôt que tel autre...La journée sera chaude comme hier, j’irai à la plage, je marcherai jusqu’au borj el baroud, j’irai m’étendre dans les dunes. Je reprends goût à la vie. Je n’ai plus envie de travailler, je dois faire un assez grand effort pour écrire seulement quelques lignes chaque jour. »
De cette période hippie où Georges encore dans la force de l’âge est arrivé à Essaouira avec sa pipe et ses fréquentations assidues à Bijou-bar, restent des réminiscences : « L’autre jour, j’avais fumé un peu d’herbe, assez pour ne pas tenir debout tout à fait. Je me suis allongé sur une banquette au café hippie, et Majid, qu’ils appellent Speed, m’a interpellé ; je l’ai regardé, et j’ai vu en même temps, sous le masque de son rire, un autre visage, plus sombre, fermé, immensément triste, comme on voit chez les Grecs, le masque des rires avec le masque des pleurs. Et cet autre visage qui est toujours derrière les mouvements de la vie, c’est déjà, j’en suis persuadé, le visage de notre mort.
- Et si tu mourrais maintenant, dit Mourad. Si tu devais dire ce que tu regrettes de n’avoir pas fait dans ta vie, qu’est-ce que tu pourrais répondre ?
J’ai répondu que je n’avais pas de réponse. J’en avais une pourtant : que mon seul regret serait d’avoir manqué ma vie à force de penser à la mort, de n’avoir pas vécu chaque instant de ma vie comme un moment possible de bonheur. »
Pourtant nous avons connu des moments de bonheur, au printemps des Regraga, lors de nos dérives communes à la vallée d’ Aïn Lahjar (la source de pierre). C’est là qu’on avait découvert ensemble, lui et moi, « la fiancée pétrifiée » du Sahel, et le concept de faïd comme débordement de l’eau et de la baraka. Un jour on est même partis ensemble, en autocar jusqu’à la vallée heureuse de Tlit, entre le mont Tama et le mont Amsiten, en pays Haha, pour enquêter sur le chant des moissonneurs. Mon oncle maternel nous reçu alors avec le cérémoniel du thé, avec des amandes, et des galettes de seigle, à tremper dans l’huile d’argan et le miel de thym . Mon oncle maternel disait alors à ce Béarnais que je croyais parisien et qui a toujours gardé une âme paysanne lui venant de son enfance passée dans ces « Pyrénées-Atlantiques », comme on les appelle si joliment en France. Mon oncle donc disait à Georges :
« Le poète et la hotte sont semblables, personne n’en veut
s’il n’y a pas de pluie et donc de récolte. ».
Et Georges qui avait aidé jadis son père à la scierie dans la forêt béarnaise comprenait parfaitement ce langage et en avait même la nostalgie. En lisant maintenant son Autobiographe, je comprends à quel point son intérêt pour notre culture était sincère, car tant d’affinités électives reliaient secrètement les traits culturels de son Béarn natal au mouillage d’Amogdoul où chaque été il jetait l’ancre pour écrire : « Dans le temps du carnaval, entre le premier de l’an et Mardi-gras, nous allions danser chaque dimanche dans le quiller de l’estanguet, sur la terre battue. Les musiciens s’installaient sur un petit balcon de planches, pour jouer des marches et des javas, avec quelques guigues et quelques sauts basques. D’autres souvenirs reviennent : le jardin de l’école, les grilles rouillées du portail. Un phono avec des disques ébréchés dans un placard. Ce vieux phonographe, posé sur une petite table dans la salle à manger de ma grand-mère, remplaçait un phonographe plus ancien muni d’un grand haut-parleur en entonnoir qui traînait dans le grenier au milieu des toiles d’araignées. »
De là, me semble-t-il, sa passion pour le carnaval d’Essaouira, cette compétition chantée, ce charivari, qui opposait jadis, à chaque Nouvel An, les deux clans de la ville et surtout le couplet du rzoun de l’Achoura relatif au phonographe :
« Permettez-moi donc d’avouer
Les soucis qui m’oppressent
Et si je meurs, que personne ne me pleure
Mais quel est votre chef ô Chebanate ?
Osman à la tête bossue
Et à la bedaine serrée d’une cordelette ?
Et qui est votre chef Ô Béni Antar ?
Ali Warsas traînant au port son chien
Éternellement sur son âne ?
Pourquoi donc avez-vous remplacé,
Les chanteurs du malhoun par le phonographe ? »
C’est lui qui, le premier, par ses nombreux articles, avait vulgarisé l’idée selon laquelle « Essaouira est la ville des Gnaoua ». Il avait longtemps enquêté sur leurs rites de possession, sur ceux des gens de l’ombre, ces Hamadcha et ces Aïssaoua, ces musique sacrées auxquelles on avait consacré tout le colloque du premier festival et dont les actes ont été publiés dans le deuxième numéro de la revue Transit de Paris-VIII, tandis que le premier numéro avait été consacré aux chants profanes intitulés Paroles d’Essaouira.
Le spectateur du rite nocturne de possession, fasciné par ce « spectacle » de transe « habitée », est avant tout sensible au jeu musical de ses animateurs. Il est tenté alors, de conclure que chez les Gnaoua, ce sont les musiciens qui sont les maîtres du jeu. En réalité nous dit Georges Lapassade, ici, comme dans tous les rites de possession, la gestion de la situation est assurée par les prêtresses du culte. Et ici comme ailleurs, les femmes, parce qu’elles sont tenues en marge de la religion des hommes, se sont donné secrètement une autre « religion » : la religion des femmes.
Là encore, afin d’expliquer son intérêt pour les ethnométhodes de guérison par l’induction de transe, on retrouve cette lointaine empreinte de la prime enfance : « Ma grand-mère savait tirer les cartes et j’ai été incité par son exemple, lorsque j’avais douze ans, à m’initier à la cartomancie et même à la pratiquer. Cela créait une atmosphère, et je peux ainsi aujourd’hui comprendre assez facilement les croyances des gens, au Brésil et au Maroc, autour des pratiques de la voyance et de la possession. Mon initiation précoce a déterminé mon intérêt persistant pour les pratiques ésotériques. »
Au mois de mai 1986 sous le titre « voyage au pays de la magie : Talisman et divination à Essaouira », il publie à SINDBAD,les résultats d’une enquête qu’il avait mené avec Boujamaâ Lakhdar sur la magie: Après l’enquête chez les tolba sur la talismanique et ses sources livresques (les livres jaunes de la magie, élaborés et publiés au moyen âge, inspirés d’une grande tradition occulte, El Bouni et Damyati pour le monde arabo-musulman, au 12ème siècle, et AGRIPPA d’Aubigné pour le monde occidental, au 16ème siècle) ils ont procédé à une autre enquête sur les traditions orales de divination chez les choufate :
« Notre promenade éthnologique à Essaouira à la recherche des pratiques magiques s’est effectuée à plusieurs niveaux et en plusieurs étapes : on a d’abord inventorié quelques liasses de documents de tolba existant au Musée. On a ensuite procédé à une enquête auprès de quelques tolba en exercice auxquels on a demandé de fabriquer des herz et de parler de leurs pratiques. On a enfin rencontré quelques voyantes..Contrairement aux taleb, les voyantes en tant que femmes ne peuvent pas se rattacher aux « textes » ni utiliser l’écriture pour fabriquer des talismans. Les femmes qui fabriquent des objets magiques, kammoussa, ne sont pas appelées voyante mais saharate (sorcières). Les voyantes ne fabriquent pas d’objets magiques. Elle pratique surtout la devination et elles ont un rôle thérapeutique. Elles trouvent souvent leur vocation à travers une maladie (possession) et elles entrent en transe pour faire leur divination. »
Dix ans plus tard, en 1996, la dernière enquête de Georges à Essaouira a porté sur les talaâ, ces voyantes médiumniques, ces prêtresses des Gnaoua qui pratiquent la divination en état de transe.
Entre Essaouira et Pau, les Pyrénées-Atlantiques et le Haut-Atlas occidental, ces mêmes saveurs sont transversales à l’écriture, à la mort et à la nostalgie des origines : « Tout à l’heure on égorgeait des poulets dans la rue, près de Bab Doukkala. Le sang coulait dans les seaux, il débordait sur le trottoir. Au milieu de la cour intérieure du sanctuaire des poules rouges égorgées baignaient dans le sang. Je ne me suis pas attardé. J’ai regardé juste en passant, je supportais mal ce spectacle. Et soudain, alors que j’écris ces lignes, un souvenir me revient : je suis étendu sur la table de la salle à manger transformée en salle d’opération, j’ai onze ans, je hurle, on recoud des chairs à vif. L’année suivante, on m’opère d’un phimosis, mais cette fois c’est à Pau, dans une clinique. C’est à ce moment-là que j’ai été blessé pour la vie, livré à l’angoisse et à la peur de la mort. Lorsque ma mère est morte, j’ai refusé de la voir, comme l’exige la coutume. J’ai retenu mes larmes pendant l’enterrement ; c’était une journée froide de février, avec un soleil pâle sur la neige. La veille de l’enterrement, je me suis enfermé dans ma chambre, chez ma grand-mère, et j’ai écrit pour ne pas y penser. Après l’enterrement, j’ai marché dans la plaine, dans les salines, au milieu des arbres morts de l’hiver. J’ai marché dans nos champs, j’enfonçais mes souliers dans notre terre noire. Et, là, j’ai pleuré, parce que j’étais seul. »
Cette angoisse du départ, qui préfigure d’une manière symbolique, ce départ pour toujours qu’est la mort, Georges l’a toujours ressenti à chaque fois qu’il devait quitter Essaouira pour se rendre à Paris à la fin de l’été, comme une mort symbolique et une nouvelle naissance : la fin de l’écriture d’été et la naissance d’une nouvelle oeuvre.
C’est en cette période de « transition » et de « transit » que nous envoyons pour publication nos articles sur « la musique comme fait social », « le mouvement folk de Nass El Ghiouane », « l’empire des signes », « les marqueteurs d’Essaouira », ou « le printemps des Regraga ». Il s’agissait de défendre la vitalité de la culture populaire contre la muséification qui la guette. Dans ces articles Georges s’élevait contre ce qu’il appelait la folklorisation qui est à ses yeux une muséification de la vie : Comme dans un musée, on a une espèce d’épouvantail à moineaux à la place d’un être vivant qui portait jadis un costume. De la même manière la musique locale est dévitalisée par sa folklorisation.
Le Musée ethnographique des traditions populaires d’Essaouira, que dirigeait alors feu Boujamaâ Lakhdar était transformé par Georges en un département d’ethnographie et, en même temps, en un lieu de rencontres culturelles intense. Cette hyperactivité intellectuelle, symbolisée par le cliquetis incessant de sa machine à écrire, qui emplissait la voûte du musée du matin au soir, suscitait des admirations envieuses par sa vitalité créatrice, faisait oublier à Georges pour un temps son angoisse native du départ vers cet ailleurs qui peut être la mort. Mais dés que l’heure du départ effectif s’approche, la fébrilité resurgit à nouveau de sa tanière et ressaisit sa personne comme un djinn possesseur de l’écriture : «Je ne peux rien contre l’angoisse du départ, contre cette souffrance que je traînerai avec moi probablement aussi longtemps que j’écrirai... La nuit sera chaude. Un vent léger secoue les palmiers devant l’hôtel. Mais le grand arbre reste immobile. Seule l’étoile du berger brûle au milieu du ciel. Une musique lointaine troue le silence. L’été va mourir, peut-être cette nuit. Mais je voudrais qu’il s’éternise. Qu’importe les livre si rien ne peut empêcher la mort de l’été. Mes étés sont comptés déjà. Tout ce qui me le rappelle, tous ces signes accroissent ma douleur. Mais le commencement de l’été ramène chaque année l’illusion que la vie recommence... »
Lapassade poursuivait : « La fin de l’été approche. Je pourrai maintenant retourner à Paris, et puis peut-être retourner à Pau et, là, me mettre vraiment au travail. Je repasserai par tous les lieux où j’ai vécu quand j’étais enfant, j’interrogerais Lalie, la sœur de ma mère, elle se souvient de tout, elle aime raconter des histoires. Il suffira ensuite de transcrire – et mon livre sera fait, il se fera tout seul. Ce matin, je n’ai même pas le courage d’aller jusqu’au marché, je n’achèterai pas les légumes pour préparer mon repas de midi...
Guy, ce soir, va m’aider, comme l’année dernière, à quitter cette ville. Arrive Boujamaa. Il est inquiet, il s’interroge :
- Mais qu’est-ce que tu as fait pendant ces deux jours, personne ne t’a rencontré dans la ville.
- Rien. J’ai un peu écrit, quelques pages seulement. Et puis j’ai attendu Guy. Demain, nous partirons ensemble.
Maintenant le temps est gris avec, par intermittence, un soleil pâle :
- Ça sent l’hiver, dit Boujamaa, il est temps de partir.
Je suis rentré à l’hôtel tout à l’heure. J’ai mis dans des sacs en papier le camping-gaz, les verres, les assiettes et j’ai tout laissé à Fatima. Elle gardera mes affaires jusqu’à mon retour. J’ai payé ma dernière note d’hôtel. J’ai dédicacé à Kamal un exemplaire de L’essai sur la transe. Je suis allé au café glacier pour le dernier adieu à Saïd. Les oiseaux volent plus vite dans le ciel, comme des nuées de cendre emportées par le vent. Neige blanche des mouettes autour d’un sardinier qui rentre au port. Les contrevents de l’hôtel claquent contre les murs. Les départs me dépriment toujours. Je vais partir. Je vais laisser ici ceux que j’aime. »
Quand on s’éloigne d’Essaouira, c’est toujours sous forme de mouette qu’on la retrouve ! Leur envol au crépuscule, leur envol au ras des vagues et au-dessus des mâts, sont la réincarnation des légendes et des mythologies marines , comme le souligne si bien Moubarek Raji, le jeune poète arabophone contemporain de la ville :
« Les mouettes sont des vagues qui prennent leur envol
Et les vagues, des mouettes qui grondent
Quand on brise une vague
Une aile vous pénètre profondément
Et quand on brise une aile
Une vague vous pénètre profondément
Ecoutez les trois mouettes briser leurs oeufs
Comme si la mer surgissait du sable pour la première fois
Avec comme notes musicales : l’éclosion d’œufs de mouettes »
Pour ce poète comme pour le magicien de la terre qu’était Boujamaâ Lakhdar, une mouette n’est pas une mouette, elle est pour l’artiste peintre le symbole même de la ville. Le dernier tableau peint par Boujamaâ Lakhdar, avant sa disparition en 1989, représentait une mouette fantastique portant sur ses ailes les signes et les symboles magiques de la ville. Georges Lapassade était l’une des figures emblématiques de la ville, l’un de ses principaux auteurs, son regard fut un limpide miroir pour la mémoire de la ville. Un de ces oiseaux marins au regard perçant survolant les rivages de pourpre. C’est toujours sous la forme d’une mouette que nous rendent visite nos chers disparus.
L’un des enseignements fondamentaux que j’ai reçus de Georges Lapassade, en menant ensemble notre enquête sur la parole d’Essaouira au début des années 1980, c’est non seulement l’obligation de tenir une sorte de compte-rendu sur les apprentissages de chaque jour, mais surtout la vertu pédagogique du compte-rendu : au retour de mon pèlerinage chez les Regraga, il venait chaque soir m’écouter ; en lui racontant ce qui s’est passé, je me rendais compte que mon subconscient avait enregistré des faits pertinents à mon insu. Mais sans son écoute attentive, je n’aurais certainement pas produit telle ou telle idée intéressante, comme faire le lien avec la « théorie du don » de Mauss, « l’éternel retour » de Nietzsche, ou « l’observation participante » de Malinowski : on produit autant par soi-même que par l’écoute amicale de l’autre. Comme me le disait si bien mon ami Georges Lapassade : dans ton cerveau et dans le mien, il n’y a que de l’eau ; la véritable étincelle jaillit dans l’interaction entre les deux cerveaux. C’est du dialogue que naît la lumière…J’ai peur qu’avec sa mort ne soit enterrée la Parole d’Essaouira, qu’il avait su avec talent sortir des limbes de l’oubli.
Abdelkader MANA
21:55 Écrit par elhajthami dans hommage | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
23/11/2009
Les poètes
L'[i]invité du lundi
La secte des diplomates et la race des poètes
Ali Skali et Fatima Abaroudi...Face à Face...


Le carrefour du livre - que dirige l'animatrice culturelle Mme Marie-Louise BELARBI, dont il faut saluer le dynamisme au passage - a connu la rencontre de deux poètes : lui diplomate de haut rang. Elle, femme au foyer, ex-professeur de littérature, ayant délaissé l'enseignement pour se consacrer à l'écriture. Pour lui, on peut concilier diplomatie et poésie. Pour elle enseigner la littérature des autres et faire la sienne est inconciliable.
Lui, c'est Mr.ALI SKALI homme d'humour spirituel et de modestie qui vient pour la présentation d'une œuvre poétique destinée au départ à l'intimité et à l'oubli et offerte par hasard aux lumières du grand jour : « Regards » primé par l'académie Française et « Aux gré des sens », dont Maurice Druon dit :
« Ali Skali pourrait bien nous piéger avec son titre « Au gré des sens » et nous faire croire qu'il s'agit de pièces érotiques. Mais non, il joue sur le sens du mot « sens » : bon sens, non- sens, sens interdit, sens dessus-dessous... »
Elle, c'est Fatima Chahid Abaroudi. Elle vient pour nous présenter « Imago », du latin « image ». Poétesse couverte de je ne sait quel halo de noblesse et de modestie qui nous dit : « Je ne suis pas militante féministe -loin de là- mais je suis pour un rapport d'égalité et d'équilibre entre la femme et l'homme pour -comme dirait le poète - « regarder ensemble dans la même direction ».
L'univers diplomatique - dans un monde conflictuel et cynique - donne l'impression d'un enfer climatisé où les monstres froids sont en conciliabule. Apparemment, il n'y a pas de place pour les poètes. Cela veut-il dire pour autant que notre poète est un rossignol au milieu des loups ? Oh, que non ! Disons que c'est un homme d'équilibre qui parvient à réconcilier les exigences du devoir avec la soif de liberté. Difficile équilibre entre la valise diplomatique et la clé des champs, entre l'homme et la fonction. Mais notre poète est un habile acrobate au sens intellectuel s'entend. La poésie est à la fois délivrance et humanisation de la diplomatie - le monde serait certainement meilleur si tous les diplomates étaient des poètes. Trêve de comparaison, la poésie est besoin tout court. Les Peuls du Sénégal ne définissent-ils pas la poésie comme étant « les paroles plaisantes au cœur et à l'oreille » ?
Si l'outil linguistique est le Français, le miel des choses nous vient de deux villes millénaires : Taroudant où est née la poétesse et Fès d'où nous vient le poète. Si les branches respirent aux cieux de l'ailleurs le tronc reste enraciné au terroir des ancêtres. Contrairement à notre habitude, d'adopter la formule « INTERVIEW » - un mot d'ailleurs assez barbare, reconnaissons le- pour une fois, nous avons préféré le dialogue entre deux poètes qui connaissent mieux que nous - quoiqu'ils s'en défendent par « modestie diplomatique » !- l'univers de la poésie et sont à même de nous en dévoiler les mystères. Écoutons-les. Qu'ils nous fassent traverser avec les chevaux sauvages sur les terres nouvelles.
M.Ali Skali : On laisse entendre parfois qu'il ne faut pas prendre au mot le diplomate. Que son « Oui » veut dire « Peut-être » et que quand il dit « Peut-être » cela signifie « Non » et qu'un diplomate ne doit jamais dire « Non » pour se garder toujours une porte de sortie et pouvoir modifier en cas de besoin son attitude initiale. Le diplomate doit se garder de dire toute la vérité qu'il pense. Ce n'est pas mentir par omission, c'est tout simplement atténuer l'effet de ses jugements pour garder toujours le contact avec l'interlocuteur ou l'adversaire. Car la diplomatie est un souci constant de ne pas perdre contact. En revanche la poésie n'est pas une « carrière » ; la poésie « habite » le poète. Elle s'identifie à lui au point qu'on ne peut dissocier facilement l'homme de son œuvre. Le poète est sincère, totalement, éperdument. Pour lui « Oui », c'est « Oui », « Non », c'est « Non ». La poésie, c'est la clé des champs, l'évasion, l'irrationnel et surtout l'imaginaire. Le poète confronte la totalité de son expérience personnelle et l'expérience humaine en général avec la totalité des mots dont il peut disposer. La poésie s'apparente à mon sens à la musique par ses rythmes et son harmonie.
Alors que nous voguions entre la liberté du poète et les contraintes du diplomate ; telle une apparition, la poétesse de feu vint nous rejoindre avec son IMAGO et le dialogue se poursuivit sur le miel des choses aux abords de Taroudant, sur Fès au pied du mont Zalagh, sur les lieux hantés et les moment inoubliables qui font que vous êtes saisi par cette transe de l'écriture, moment de grâce et de création qu'on n'aimerai jamais quitter.
Mme Abaroudi : Ce que nous exprimons n'est pas différent. Nous ne sommes pas des Martiens. Tout simplement la vie, l'amour, la mort avec des optiques différentes féminines et masculines. La poésie, c'est comme chausser des lunettes avec lesquelles on voit le monde transfiguré, c'est une espèce de coup de baguettes magiques avec laquelle on magnifie les objets autour de nous. C'est un regard contemplatif. Le réel autour de nous est chargé de poésie et la poésie ne se limite pas seulement à l'écriture, la création poétique peut toucher tous les domaines, que ce soit l'écriture, l'expression filmique, la danse ou la peinture. Par exemple Van Gogh a peint d'affreux godillots, qui sont un objet banal et usé. Pourtant à bien y regarder, il en a fait un tableau tout à fait poétique. Victor Hugo a fait du crapaud un superbe passage poétique. Un poète espagnol a écrit tout un recueil sur « le petit âne argenté et moi » et c'est ce recueil qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1956.
M. Ali Skalli : Il n'est pas indifférent au poète d'être sensible aux évènements de notre monde. Au contraire. Aussi bien à la paix qu'à la misère humaine et aux droits de l'homme. Si on est témoins, on ne peut se taire parce qu'un poète où il est sincère ou il ne l'est pas. J'évoque d'ailleurs dans « Aux gré des sens » le problème de Jérusalem :
« Ces enfants égorgés et ces vieillards amputés,
Ces femmes éventrées et ces maisons dynamitées,
C'est pour toi Jérusalem.
Ce peuple décidé à se battre jusqu'à la victoire
Parce qu'il y a une histoire dont il garde la mémoire
C'est pour toi Jérusalem ».
Peuple bafoué, peuple exilé, peuple chassé de ses terres qui endure le pire, le droit est de son côté, la sensibilité humaine est de son côté. Malgré tout cela le peuple palestinien continue à naviguer sur les routes.
Mme A baroudi : La poésie est plutôt venue à moi. Très tôt. J'ai écris mes premiers poèmes à l'âge de neuf ans et demie. C'était suite à un déchirement que j'ai vécu dans mon enfance. Je suis native de Taroudant, cette ville, que si on enlève les aspects modernes (voitures, poteaux électriques etc.) est une ville moyenâgeuse, qui vit en dehors du temps. Quand j'ai obtenu mon certificat d'étude à 9 ans, j'ai été envoyée comme interne à Rabat. Alors, imaginez une petite fille de neuf ans et demie, partie à Rabat. A l'époque, c'était le bout du monde. Quand mon père m'a laissé à l'internat et que sa silhouette a disparue derrière la vitre de la grande porte d'entrée, j'ai sentie un déchirement très douloureux. J'ai pleuré pendant des jours et des nuits et c'est là que j'ai écris mon premier poème sur la séparation. C'est un poème sur Taroudant, je l'ai écrit dans « imago », mais bien sûr plus amélioré, plus mûr. C'est un déclic causé par la séparation de mes parents et de ma ville :
« Il est au loin une ville brune
Que chante le vent du Sud
D'or et de pourpre, de cuivre et de feu.
Corps tendre de rosier et ceinture d'orangers
Dans une main la plaine, dans l'autre le désert
C'est la vierge fiancée du vent qui passe
Coulez larmes et fleuves
L'aube sera toujours belle sur ma ville
Elle est rêve de pierres entre deux crépuscules
Et le soleil qui allume ses remparts a un autre destin
Elle est beauté sereine à la lisière du silence
Et le vent qui la chante a un autre langage
Coulez larmes et fleuves
L'aube sera toujours belle sur ma ville... »
M. Ali Skalli : La poésie est un exutoire qui me permet d'échapper au quotidien pour me retrouver avec moi - même...Quand j'ai cette feuille blanche j'oublie tout. Même ma femme qui dort à côté. Je suis seul au monde avec cette feuille et ce crayon à la main pour faire quelque chose ; je ne sais quoi ? Une rencontre, un paysage, un mot qui peut parfaitement suggérer bien des choses. C'est une façon de m'endormir en communion avec moi-même. J'écrivais pour mes plaisirs parce que ça me permettait de faire une espèce de mosaïque des mots. Un jour nous recevions un ami qui travaillait à l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Je ne sais pas comment on est arrivé à parler de poésie. Mais j'ai refusé à la fin du repas de leur lire ma poésie. J'ai dis à mon ami : « Ce que j'écris ne s'aurait t'intéresser à aucun titre. Il m'a alors demandé : « Est-ce que mon avis ne t'intéresse pas ? ». Là, j'étais piqué au vif. Je lui ai remis alors la liasse de feuilles. Huit mois sont passés. Silence absolu. Un soir le téléphone sonne et cet ami me dit : « Ali ! Tu es assis ? ». Je dis : « Non ». « Alors assieds toi et écoutes-moi, j'ai lu tes poèmes, je les ai beaucoup appréciés, j'ai pris sur moi de les envoyer à un éditeur à Paris ». Je lui ai rappelé que je suis le représentant du Maroc ; ce que j'écris dans ces textes n'est peut-être pas publiable ? Il m'a répondu : « écoutes, tu a un roi réputé pour être très large d'esprit ; je suis sûr que quelque soit le texte qui va être publié, eh bien, il sera d'accord avec toi ». « Encore faut-il, lui dis-je, que je lui demande quand même l'autorisation, parce que je ne suis pas seulement un homme mais j'ai aussi un titre. » Et c'est ainsi que j'ai demandé l'autorisation et Sa Majesté dans sa magnanimité et dans sa bonté m'a dit qu'il était fier d'avoir un ambassadeur qui était aussi poète et que je pouvais publier ce que je voulais. Et c'est comme cela que ce livre est sorti. Ce qui m'a incité à commettre un deuxième livre (éclat de rire). Maurice Rheims, de l'Académie Française, qui m'a fait l'amitié de préfacer « Regards » écrit :
« Un homme écrit...Qu'il prenne garde !...Il suffit parfois d'un simple billet pour en dire long sur lui, bien plus peut-être que le signataire n'aurait désiré le faire, mais si un roman peut révéler la personnalité de l'homme de lettre, ses ambitions, son caractère, ses frustrations, en ces domaines, rien ne vaut la poésie...Et c'est vrai, on est nu pratiquement comme un ver devant son public. Autrement, ce n'est pas de la poésie. On triche et ça ne résonne pas dans l'âme du public. »
Quand on vit loin de son pays, on éprouve la nostalgie pour ce pays :
« si en Amérique les Andes entendent fièrement leur Cordillère, toi mon Maroc à moi, tu porte allègrement ton Atlas en bandoulière ! »(Regards).
Le temps marque. Il marque non seulement les choses autour de nous ; il marque les êtres, hélas, et ceux que l'on aime. Il les marque peut-être d'une façon assez dramatique, puisque souvent, on s'en sépare. C'est la raison pour laquelle la fuite du temps et la mort, je les ressens très douloureusement :
« Tu es parti comme l'effluve d'un parfum,
Comme la rosée du matin qui s'évapore au soleil levant.
Et je suis resté seul,
Abattu, désappointé, médusé, hébété,
L'esprit aux quatre vents ».
Mme Abaroudi : Pour la compréhension de ma dédicace « d'Imago » ; j'ai perdu une fille que je n'ai jamais vu, parce qu'elle est morte à la naissance et c'est à elle que j'ai dédié mon recueil :
« Racontez - moi cet été,
La terre avait-elle son blé ?
Et le ciel ses couleurs quand vint le règne de l'oiseleur ?
Ils venaient de force des haleurs sans mémoire
Ils m'auraient pris tes jours,
Ferme tes yeux, courbe ton corps
Brise la fleur du jour nouveau
Les voleurs d'aube, les voleurs d'eau
Fille promise au cœur du bel été
Colombe trop tôt envolée...
Imago veut dire en latin « image ». Beaucoup de gens connaissant le sang berbère qui coule dans mes veines m'ont demandé si ce n'est pas Aïmago ? Non, le mot est latin. C'est une image affective qu'on se fait de soi-même. Mon regard sur les choses de la vie, sur les choses de l'amour, les grands thèmes du monde. Comme on a un album de photos pour fixer les souvenirs de sa vie, j'ai écris des poèmes à chaque étape importante de ma vie. Et j'ai comme une sorte d'album poétique ; certains je les ai mis dans « imago », d'autres je les garde pour moi-même.
M. Ali Skali : Certains lieux m'ont inspiré, Fès ma ville natale :
« Et c'est l'indicible moment de la prière et du recueillement
Devant ce paysage d'un autre âge
Avec ses oliviers et ses buissons sauvages.
L'on se croirait assurément devant Nazareth, Bethléem ou Jérusalem.
Alors que l'on subit l'envoûtement de Fès, leur grande sœur d'Occident ».
Mon père a vécu une vie assez extraordinaire. Il me plaisait infiniment de l'entendre parler des ces montagnes qu'il a traversées au siècle dernier à dos de mulet. C'était absolument un monde fabuleux qui était resté pour l'enfant que j'étais. Mon père, propriétaire terrien, était mêlé à l'histoire de la région. C'était un homme épris de musique andalouse et de malhoun. Tichka, c'était une découverte de la beauté de notre pays pour moi et pour mes enfants. Il y a des moments qui vous marquent plus que d'autres, ou tout simplement des arrêts dans la vie qui font que vous sentez le besoin de les marquer par un souvenir : certains prennent des photos, moi, j'écris des poèmes.
Propos recueillis par Abdelkader Mana
[i] Paru à Maroc - Soir du lundi 29 décembre 1986
Le vendredi 12 octobre 2007, l'agence MAP, annonce le décès de l'ancien diplomate et homme de lettres, Moulay Ali Skali "le jeudi, dans une clinique Suisse, des suites d'une longue maladie, annonce le ministère des Affaires étrangères et de la coopération".
11:48 Écrit par elhajthami dans Entretien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poèsie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Jérada
les derniers mineurs de jerada
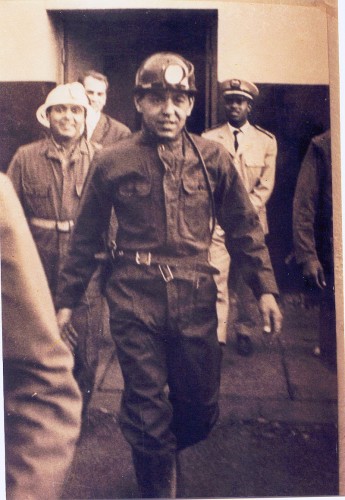
Au bout de la nuit et du voyage vers l'Oriental, en ce mois de décembre glacial, le ciel matinal et gris d'Oujda nous accueille. A cinquante kilomètres plus au sud, je me rends à Jérada, cité de mineurs en fin de parcours. Radioscopie d'une ville en quête d'avenir.[i]
Par Abdelkader Mana
JERADA, UNE NOUVELLE ATLANTIDE ?
Depuis sa reconnaissance par les géologues en 1929 et son exploitation effective en 1936 , le bassin carbonifère de Jérada avait transformé cette région agricole en zone minière. Prochainement, en l'an de grâce 2001, le dernier puits sera fermé, et le dernier mineur prié de redevenir le fellah qu'il a toujours été. Difficile reconversion, quand on sait que la mine a crée autour d'elle une communauté de destins, une identité propre à ceux qui ont partagé les joies de la fête, mais aussi les ruines invisibles de la silicose : inhalé au fond des galeries souterraines, le dépôt cristallin de poussière noire finit par durcir et obstruer l'appareil respiratoire, y étouffant progressivement la vie. Incurable est la silicose, parce qu'elle adhère irrémédiablement aux parois pulmonaires. L'inertie se substitue progressivement à la plasticité cellulaire, le mort se saisit du vif. La mine ferme, les damnés de la silicose restent : plus de travail à la mine, plus de travail ailleurs, que vont-ils devenir ?
Ce simple mot, « Jérada » (sauterelle en arabe), produit en moi, comme « une déflagration du souvenir » . Il me rappelle étrangement cette vieille comptine dont jadis nos grands - mères berçaient en nous l'enfant qui rêve :
« Â Jérada Maalha !
Fiin kounti saarha ? »
O sauterelle bien salée !
Vers quelle prairie t'en es-tu allée ?
C'était au temps des disettes et des vaches maigres, où des nuées de sauterelles décimaient les champs, et où il ne restait aux hommes affamés qu'à se gaver de grillades de sauterelles salées.
Nuée de pique-bœufs dans le ciel d'Oujda. Au bord de la route des « trabendistes » proposent à vil prix de l'essence en noir, qu'ils sont allés chercher en Algérie toute proche. Ici, le « trabendo », terme par lequel on désigne toutes sortes de transactions, semble tourner au ralenti, non seulement des lenteurs des réveils ramadanesques, mais à cause de la double fermeture : celle de la frontière algéro-marocaine et celle de la mine carbonifère de Jérada.
Sauterelles et hérisson
Les champs reverdissent déjà de leurs jeunes pousses de fraîcheur. Il a dû pleuvoir sur ces étendues steppiques et dépeuplées couvertes d'alfa, sur ces petites crêtes dénudées qui ferment l'horizon plus au sud, et sur cette haie d'arbres, dressant vers le ciel leurs branchages fantomatiques et nus. Par delà les collines dénudées et les amandiers en fleurs ; la traversée de l'oued Isly, connu pour la bataille éponyme qui oppose en 1844 un Maroc qui soutenait les incursions de l'Emir Abdelkader depuis le Rif jusqu'en Algérie qui venait alors d'être occupée par la France. Par delà les frontières, histoire commune, proximité géographique : ici -même le jeûne est rompu aux dattes d'Algérie. Par delà les étendues steppiques et les rivières partagées, mêmes goûts musicaux : le Raï d'Annaba est apprécié à Jérada et le Gharnati de Tlemcen à Oujda. Par delà les conjonctures politiques, croisement de destins et affinités électives l'emportent de loin.
Traversée de « Guenfouda » (hérisson en arabe), localité née, non pas autour d'un marché hebdomadaire rural, mais plutôt autour d'une activité minière : dans des hangars de type colonial, on transformait jadis le minerai de charbon en « boulets » destinées à l'exportation. Tout semble indiquer que la région vit non pas du sol laissé en friche pour la vaine pâture, mais des ses énergies telluriques. Ici, l'activité minière a finit par l'emporter de loin sur l'activité agricole, vidant du même coup celle-ci de sa substance humaine, comme semble l'indiquer ces immenses étendues où l'on a du mal à apercevoir ne serait-ce qu'un épouvantail.
"Qu'allons-nous devenir
seuls au milieu des ruines?"
Après le plat pays, le massif montagneux. Le bassin carbonifère est situé au sud de cette montagne. M'étant assuré que « Guenfouda » (hérisson) n'est pas encore Jérada (sauterelle) - les toponymes ont ici des airs de totems - je m'assoupis. Au réveil, j'y suis déjà comme au sortir d'un rêve. C'est donc cela Jérada ? Une immense joutia (marché aux puces) de bric à brac, un baraquement de taudis en briques, urbanisme sans allure, éclaté au milieu de montagnes de remblais de charbon. Au pied du minaret délavé de la place centrale - y a-t-il vraiment un centre à Jérada ? - on marchande, la mine grise, de maigres étalages d'oranges et de poissons faméliques pêchés je ne sais où. C'était donc cela la ville minière ?

Tout autour de la place, des échoppes de bricolage : ateliers d'électricité, mécanique, plomberie, menuiserie, chaudronnerie. On vend de tout, on répare de tout, on a même ouvert une « Jérada Internet » ! C'est en ces mille et un petit métiers que ce sont reconverties les anciennes gueules noires . Une reconversion qui ne concerne que les ouvriers de surface mais pas les charbonniers du fond dont le seul savoir - faire est justement d'aller au charbon. Minés par la silicose, désoeuvrés par inaptitude ou pour cause de fermeture définitive du puits dans lequel ils passaient le plus sombre de leur temps, ils déplorent néanmoins la fermeture de la mine dont ils extrayaient au risque de leur vie, leur raison d'être et leur dignité d'hommes. Depuis que du fond de la terre - mère, les énergies telluriques ne font plus surface, depuis que les puits se sont mis à fermer l'un après l'autre, la ville née et autour de la mine ne sait plus de quoi demain sera fait.
Une mosaïque de tribus
L'argent circule peu dans cette ville où la mine n'est plus qu'un puits sans fond ni issue. Une ruine dont on extrait plus d'énergie - pour continuer à faire tourner la centrale thermique, on importe désormais un combustible douteux - et encore moins de richesse : « Il y a encore des réserves de charbon pour un siècle, mais on a décidé de fermer les charbonnages, nous explique cet ancien ouvrier de surface. Question de politique. La mine ne faisait pas seulement vivre Jérada, elle profitait aussi à la ville d'Oujda. Après la fermeture, certains mineurs sont restés sur place, mais beaucoup d'autres sont retournés dans leur patelin d'origine dans le sud ou à Berkene ».
En raison des départs
pour fermeture de la mine,
la cité ouvrière est actuellement
en démolition.
On me conseille d'aller rencontrer un certain Mohamed Lashab, un syndicaliste qui aurait participé aux négociations conduisant à la fermeture de la mine : « Je vis ici depuis 1945, dit-il. Quand je suis arrivé à Jérada, j'avais à peine trois ans. Maintenant, je suis à la retraite. On est venu de Debdou où mon père ne pouvait plus vivre de la petite agriculture. Des membres de sa famille qui travaillaient déjà à la mine en 1945 l'avaient incité à les y rejoindre ». Le recrutement s'opérait souvent de la sorte : les mineurs originaires de régions rurales pauvres, une fois établis sur place, faisaient venir voisins et famille de leur village d'origine, leur servant dans un premier temps de « structure d'accueil ». c'est la cas d'Afenzy, né à Demnate en 1950, venu travailler comme mineur au début des années quatre - vingt « parce qu'il y avait des gens de Demnate qui travaillaient déjà ici ». C'est le cas d'Ahmed, né aussi en 1950 chez les Béni Lent, fraction Tsoul, dans la région de Taza, venu à Jérada en 1972 pour rejoindre son frère qui travaillait déjà dans la mine. Ainsi, de fil en aiguille, Jérada, mi-ville, mi-village, s'est composée de quartiers et de douars dont les habitants avaient pratiquement la même origine. Ce qui explique que les quartiers portent les noms de régions lointaines : Sous, Marrakech, Taza, Debdou, Demnate, Béni Yaâla, Oulad Sidi Ali, Oulad Âmer, Zkara, Oulad Maziane. Il y a même des membres de la même tribu qui habitent des sous - douars : Laghouate installés au douar Oulad Âmer, Béni Guil au douar Oulad Maziane (ces derniers sont des éleveurs connus pour la qualité de leur mouton « Guilli »).
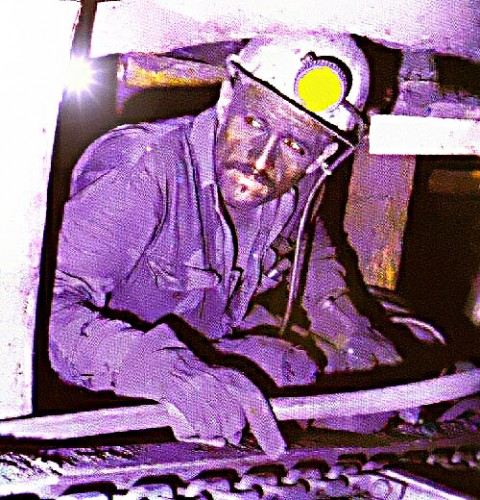
Jérada était ainsi composée d'une mosaïque de tribus, comme en témoigne Malika El Kihal, fille de l'un des premiers mineurs : « De mon enfance, je garde l'image de la place centrale de Jérada où, à l'occasion d'une fête religieuse ou nationale, on pouvait assister à tous les folklores du pays. Le personnel organisait une fête saisonnière , l'Ouaâda , qui était à la fois un rite de passage et un pèlerinage » . La ville était structurée en fonction des activités de la mine : il y avait la cité ouvrière, la cité des agents de maîtrise et « la cité Russe » (édifiée dans les années soixante - dix par les Soviétiques venus monter la centrale thermique) où résident les ingénieurs. Du temps du Protectorat, se souvient-on, les agents qui occupaient la cité ouvrière n'avaient pas le droit d'entrer ni de se promener dans la cité des agents de maîtrise, alors occupée par les Français.
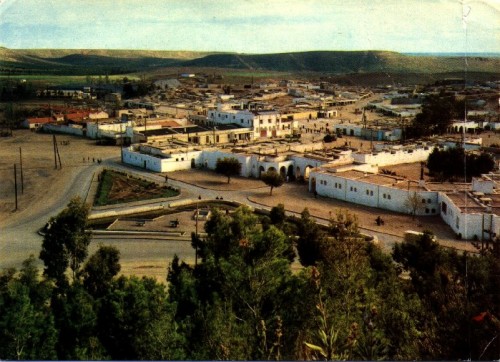
Beaucoup de vendeurs mais pas d'acheteurs
En pleine activité, la mine produisait jusqu'à 700 000 tonnes de charbon par an et employait 7000 personnes. Ce qui faisait vivre jusqu'à 70 000 âmes. En raison des départs pour fermeture de la mine, la cité ouvrière - noyau primitif de Jérada - est actuellement en démolition. Dans les autres quartiers qui restent encore debout, on peut lire l'inscription « à vendre » sur les façades de nombreux taudis. Mais comme il n'y a pas d'acquéreurs, leurs propriétaires finissent par les abandonner . C'est le cas d'un certain Zeroual, originaire du Sous, qui a abandonné sa maison, pas de son plein gré, mais parce que dans sa ruelle, les maisons voisines ont été brutalement désertées : vidée de toute vie, elles ne sont plus que des ruines hantées par l'esprit des disparus. Les ruelles fantômes font désormais peur à ceux qui sont restés. La femme de Zeroual et ses enfants ont réclamé de quitter les lieux à tout prix : « Qu'allons - nous devenir seuls au milieu des ruines ? » demandaient-ils à Zeroual qui voulait d'abord vendre la maison avant de partir. Il voulait aussi retarder son départ parce qu'il attendaient le verdict du tribunal sur le litige qui l'opposait depuis des années aux charbonnages. Finalement, il a eu gain de cause : les tribunaux ont rendu leur jugement en sa faveur pour qu'il réintègre son travail dans une mine qui n'existe plus ! Comme il n'a pas non plus trouver d'acquéreur pour sa maison, Zeroual a dû se rendre à l'évidence : il a plié bagage et s'en est retourné dans sa tribu d'origine dans le Souss. Il était bien commode de penser qu'en guise de reconversion les mineurs n'avaient qu'à retourner travailler la terre qu'ils avaient quitté. Mais le hic et le nunc est qu'entre temps ces ex-mineurs se sont urbanisés : on en est au moins à la troisième génération de mineurs depuis le début de l'exploitation de la mine en 1936. Et leurs enfants, qui sont pour beaucoup des diplômés - chômeurs, ne voient pas leur avenir dans un « retour à la terre des ancêtres ». ces jeunes s'attendaient plutôt à prendre la relève de leurs parents en tant que « cadres de la mine ». Or, avec la fermeture de celle-ci, ils se voient brusquement sans perspectives, condamnés « à se tourner les pouces et à croiser les bras », comme avoue un jeune titulaire d'une licence en mathématique, au chômage. Certains ex-mineurs investissent une part des indemnités qu'ils ont reçu des charbonnages en finançant l'émigration clandestine de leur progéniture. Un drame en cache un autre : pour avoir fait naufrage dans le détroit de Gibraltar, on ne verra plus jamais certains de ces jeunes candidats à l'exil. Au lieu de partir, beaucoup ont cependant préféré rester sur place, choisissant d'investir leur indemnités de départ dans le petit commerce ou la création d'ateliers, comme l'explique un mineur à la retraite :
« On veut faire disparaître Jérada alors qu'on sait pertinemment que la mine pourrait encore continuer à produire pendant deux siècles. Après la fermeture les ouvriers ont crée de petites entreprises avec leur savoir faire en menuiserie, des ateliers électriques ou de nettoyage. Mais les effectifs ne dépassent guère une trentaine de personnes, y compris les associés d'une société charbonnière. Cela ne constitue pas vraiment une reconversion vers d'autres activités dont la ville a pourtant cruellement besoin ».
Les jeunes s'attendaient
à prendre la relève de leurs parents
en tant que "cadres de la mine"...
A l'emplacement même du premier puits dont l'exploitation remonte à 1936 - là où se trouvent les locaux de la direction - les Charbonnages du Maroc (CDM) ont cédé des ateliers à leurs anciens techniciens pour qu'ils y créent leur propre entreprise. Louables intentions, encore fallait-il y préparer les salariés avant de plier bagage. Car on ne métamorphose pas du jour au lendemain en d'ingénieux gestionnaires d'entreprises de simples salariés qui ont vécu toute leur vie dans un cadre régi par une discipline de fer et où ils n'avaient aucun droit à l'initiative. Résultat : échec de la reconversion. D'où l'angoisse des « bénéficiaires », face à la précarité et à l'incertitude d'une situation qui les désarme, tant psychologiquement (ils n'ont jamais appris « le goût du risque ») qu'économiquement (ils n'ont pas une assise financière suffisante pour la maintenance et la traversée du désert). Nos nouveaux entrepreneurs donnent plutôt l'impression de regretter la situation confortable que leur conférait leur statut de salarié. Certes, ils ne gagnaient pas beaucoup, mais au moins ils savaient à quoi s'en tenir à la fin de chaque mois : « On n'arrive même plus à retrouver la moitié de notre ancien salaire », se lamente cet associé de l'entreprise qui s'est substituée à l'ancien atelier d'électricité.

Une reconversion difficile
L'isolement et l'enclavement de Jérada n'arrange pas non plus les choses et nos associés n'ont ni les moyens ni la formation requise pour faire connaître leurs services à une clientèle potentielle, dont ils devinent l'existence mais qu'ils ne savent pas atteindre : les commandes sont rares et irrégulières : « Même la centrale thermique préfère réparer son matériel défectueux à Casablanca plutôt que dans nos ateliers. Or, si les commandes continuent à nous faire défaut, nous risquons de fermer dans deux à trois mois au plus tard ». Même son de cloche à l'atelier mécanique, concédé lui aussi à d'anciens techniciens de la mine : « à ce jour, nous n'avons pas touché un centime. Si la situation ne change pas d'ici à six mois, nous serons obligé d'abandonner. Pour le moment, on survit grâce aux charbonnages, mais nous serons bientôt condamnés à perdre ce seul client puisque la mine va fermer. Nous espérons que la centrale thermique de Jérada nous fera une proposition de convention remplaçant celle que nous avions avec les charbonnages. L'argent ne circule plus, le rawaj a disparu, les boutiques ont fermé, des habitations sont en vente. Ne reste ici que ceux qui n'ont pas où partir ». Faute de retrouver une activité de substitution, la ville se meurt. Une mort lente symbolisée par la présence de la silicose : « Une maladie incurable et mal indemnisée », précise le syndicaliste. « Pour moi, un homme atteint à 30% d'IPP(Invalidité Physique Professionnelle, sigle par lequel on désigne pudiquement la silicose) doit être bien payé et avoir 70% de la CNSS. Or il cesse ses activités aux charbonnages et il est inapte à reprendre un travail ailleurs. Tant qu'il est en activité, il est soigné lui-même et sa famille. Mais quand il part, il n'a p)lus droit ni aux soins ni à une activité quelconque .

Des hommes minés par la silicose
Généralement, les gens de Jérada même, mieux avertis par l'expérience et les années, préfèrent travailler de jour en surface, plutôt que dans la nuit éternelle du fond, de crainte d'attraper la silicose. Ce qui n'est pas le cas des paysans déracinés venu de loin qui, pour gagner leur vie, n'hésitaient pas à aller au hassi (puits), soit parce qu'ils ignoraient le risque encouru pour leur santé, soit parce qu'ils étaient attachés par un meilleurs gain, car le travail du fond est mieux rémunéré que celui de surface. Hélas, ils ne comprenaient ce qui leur arrivait qu'une fois atteints dans leur chair : « J'ai fais un arrêt de maladie à cause de la silicose ». nous confie ce mineur d'une quarantaine d'année qui travailla dans la force de l'âge(de 1977 à 1982) au puits F3 : « Depuis lors, je n'ai plus travaillé et je suis toujours malade. Je n'ai pas de quoi me soigner. La mine ne vous prend en charge qu'une année après l'arrêt du travail. Après quoi, si vous êtes en bonne santé, il faut reprendre le travail, sinon rien ».
Il semble qu'on ait préféré sacrifier "le social" sur l'autel des sacro-saints équilibres financiers.Mais le coût social de la fermeture se révèle d'ores et déjà plus lourd puisque rien n'a été prévu pour redonner du travail et de l'espoir.
Son identité est celle de son numéro de matricule "59913", son nom véritable, Lahcen Belaïd, il le met entre parenthèses. L'indemnité de départ permet à peine au mineur de subvenir à ses besoins vitaux pendant trois à quatre ans. Mais passé ce délai, il se retrouve avec une rente trimestrielle qui varie de 500 à 700 DH, et parfois 70 DH ! Le plus grave est l'inaptitude physique qui se répercute sur toute la famille. Actuellement à Jérada, il y a des veuves qui ont deux à sept enfants à charge. Leur père est décédé à cause de la silicose, souvent précocement, bien avant l'âge de la retraite. Qui va s'occuper des enfants et de leur avenir ? Jérada, isolée, se voit impuissante face au drame silencieux qui la mine. Sans perspective, elle constitue une véritable bombe à retardement sur le plan social. Villes aux ruines visibles et invisibles, peuplée désormais de fantômes errants, Jérada serait-elle la nouvelle Atlantide ? Défunte est la raison d'être d'une ville de près de 70 000 habitants, qui continuent pourtant d'exister même si elle n'est plus que l'ombre d'elle - même. Une ex-ville minière en sursis, où on a pourtant érigé récemment d'imposantes bâtisses administratives (celles de la municipalité et de la province), arborant marbre et pierre de taille, au milieu des taudis, comme pour indiquer que la ville devrait survivre à sa raison d'être. Mais de quoi va-t-elle vivre, une fois que le dernier puits sera fermé en juin 2001 ? Mystère. En attendant pour survivre, les fils des derniers mineurs bricolent, creusent de nouveaux puits de façon informelle au péril de leur vie. Travail au noir, travail dans le noir...C'est dire à quel point pour préserver leur travail et leur dignité, les gens de Jérada, préfèrent de loin prendre tous les risques, y compris pour leur vie et leur santé. Maintenant que Jérada n'a plus de mine de charbon, il lui faut beaucoup d'imagination pour s'ensortir.

Polyvalence ou inertie
Avec la fermeture du dernier puits en 2001, le troisième millénaire semble mal engagé pour les mineurs de Jérada et surtout pour leurs enfants. Une fois les indemnités dépensées, de quoi vivront les mineurs et leurs familles ? On évoque la possibilité de développer une industrie textile, d'exploiter l'alfa qui recouvre les immenses étendues alentour, d'un possible retour à la terre : pour le moment de simples idées de projets échafaudés sans réalisations concrètes. Une chose est sûre, aucune reconversion n'a été planifiée dans la perspective de la fermeture. Le sentiment qui prédomine est que le protocole d'accord qui y a conduit a été signé à la hâte et qu'il aurait fallu maintenir la mine en exploitation encore quelques années -elle est exploitable encore pour un siècle nous dit-on- le temps de préparer une reconversion économique fondée principalement sur le potentiel humains, surtout jeune, dont regorge Jérada. Mais il semble qu'on ait préféré sacrifier le « social » sur l'autel des sacro-saints équilibres économiques : maintenir une mine dont le charbon n'est plus compétitif supposerait de coûteuses subventions. Mais le coût social de la fermeture se révèle d'ores et déjà plus lourd puis que rien n'a été prévu pour redonner du travail et de l'espoir.
Une part des indemnités
sert à l'émigration clandestine
Certaines familles vivent ici depuis le lancement de la mine en 1936, c'est-à-dire depuis plusieurs générations. Difficile pour elles de se couper de leurs racines pour aller trouver logis et travail ailleurs. Par conséquent, nombre de ces familles sont condamnées à rester sur place avec le sentiments que la charrue a été mise avant les bœufs : il aurait fallu préparer longtemps à l'avance la reconversion économique, au lieu d'y être acculer dans l'urgence une fois la mine fermée. Car le passage d'une économie à une autre prend du temps, beaucoup de temps, parce qu'il nécessite, outre des investisseurs et des investissements financiers, la formation des hommes et leur préparation aux nouveaux rôles qu'ils seront amenés à jouer dans une économie où la mine n'existe plus. Une mutation de toute une économie régionale, prenant en compte à long terme des complémentarités avec l'Algérie voisine, ce qui relève beaucoup plus de la décision politique et de la stratégie économique au niveau gouvernemental, que du bricolage au niveau des individus auquel on assiste actuellement. En l'absence de vision claire chez les élus, chacun s'en sort comme il peut. Pour le moment, en lieu et place de la mine, les derniers mineurs n'ont plus pour survivre que le bricolage dans le cadre d'une économie informelle. Le potentiel humain reste le principal atout sur lequel peut se fonder une éventuelle reconversion de l'économie locale. Un potentiel humain fondé sur la polyvalence et la capacité d'adaptation dont font preuve certains jeunes diplômés. C'est le cas par exemple d'Ahmed Issiali, ce fils de mineur, titulaire d'un doctorat en chimie, qui s'est convertit à la distribution de produits pharmaceutiques tout en créant une entreprise de plastique avec un autre jeune associé. Une attitude novatrice qui dénote avec la mentalité des parents pour lesquels, il n'y a pas d'autre salut que la mine : l'absence de polyvalence conduit à la même inertie que la
silicose.
Abdelkader Mana
[i] Enquête parue au bimensuel Medina, de Mars - Avril 2001.
09:06 Écrit par elhajthami dans enquête | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : reportage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les rythmes de Marrakech
Les rythmes de Marrakech

En cette fin d’après-midi, l’air commence à fraîchir, et l’éternelle place Jamaâ-Lafna à s’animer. Tous les jours, à heure fixe, un aveugle y joue de la cithare. Pure poésie. Il chante d’une voix vibrante l’Orient de toujours. Malgré ses cheveux grisonnants, il a ce duende, sans lequel l’auditoire de la halqa se disperserait aussi vite qu’une nuée de moineaux. D’où vient-il ? Probablement du côté de Sidi-Belabbès, ce quartier qui porte le nom de l’un des sept saints patrons de Marrakech. Un saint que l’on dit aussi protecteur des aveugles. Ceux qui écoutent avec les oreilles du cœur et qui voient avec les yeux de la miséricorde. Seraient-ils vraiment disposés à la musique ? En tout cas à Marrakech, nombreux sont les aveugles qui sont aussi musiciens.

Je me dirige vers la Koutoubia, à l’ombre de laquelle se tient chaque fin d’après-midi la halqa du conteur. Les artisans y accourent de toute part pour écouter à l’ombre du vieux minaret la Sira de Saladin, les amours légendaires d’ Antar et Abla, ou encore les fabuleuses aventures d’ Hamza, l’acrobate et d’ Omar Ayar dont le vol est si agile qu’il devance celui des oiseaux.
Le livre jaune des vieux contes reste un mort parmi les morts, s’il ne trouve pas de conteur professionnel qui peut le ranimer en donnant aux chevaux en cavalcade des sabots d’or :
« Quand le Calife du temps embrassa la terre pour la remercier des bienfaits qu’elle prodigue aux hommes, les maudits se taisent ! »
- Recommence dès le début ! Crie le public.
Une meute de chiens aboie, un âne braie interrompant la narration :
- Voici l’âne, voici le chien, il ne manque plus que le coq !
Il y a constamment un va-et-vient entre le récit du conteur et le commentaire de ce qui se passe tout autour. Une autre mémoire se substitue au néant. Cette durée de l’imaginaire n’existe que par la voix du conteur. Le conteur, c’est celui qui parcourt une géographie imaginaire, qui relate l’histoire des royaumes disparus, ou ceux qui n’ont jamais existé.

Le conte est constamment recréé par la communauté de l’espace imaginaire, qui est d’ici et de nulle part. La Sira c’est le temps à la fois figé et éternel du conte. C’est un voyage suspendu au souffle du conteur, qui transporte les auditeurs en dehors d’ici et d’eux-mêmes. Le conte se situe dans une durée rituelle entre deux prières : la Sira de l’étoile polaire et celle de Saladin.

À partir du foyer central que constitue la place Jamaâ-Lafna un espace ludique qui tient à la fois du cirque , du théâtre et du carnaval l’esprit de la fête semble gagner toute la ville. Le soir venu, en déambulant dans le labyrinthe de la médina, partout on croise des cortèges répandant leurs flots de musique et de lumière, précédé de vierges portant des cierges. Ces processions rythment tout événement heureux.

On fait appel soit aux laâbates, littéralement les amuseuses et Dieu sait si l’on s’amuse à Marrakech , soit aux tabbala[1] qui ont pignon sur rue, et qui, en plus de leurs « services musicaux », louent un cheval harnaché pour porter, tel un prince, l’enfant à circoncire. En temps normal, dix boutiques de tabbala répondent à la demande musicale à Marrakech. Mais lors que celle-ci s’accroît comme en ce moment avec l’arrivée des pèlerins de La Mecque on en engage trente. L’orchestre des tabbala comprend deux tambourinaires, deux hautboïstes et deux trompettistes. Dans une procession, ils sont généralement relayés par les mouaznya qui rythment des mains, accompagnés de la darbouka, du tambourin et du trayère (petit cadre circulaire à sonnailles). Il ne faut pas confondre ces personnages hauts en couleur et bien dans le goût local, qu’on appelle mouaznya (équilibristes) parce que l’équilibre musical coule dans leurs veines, ou rchaïchia (applaudisseurs), avec les joueurs de tambourins de l’Achoura, les dquaïquiya, qui ne se manifestent qu’une fois l’an. Si la daqqa[2] est originaire de Taroudant, l’art des mouaznya est typiquement marrakchi, avec sa gestuelle et son humour.

Un vrai musicien de Marrakech doit connaître tous les rythmes, maîtriser tous les instruments de musiques traditionnelles, et même savoir danser. C’est le sens des mots Bahja (esprit de la fête) et Hyala (esprit de la danse) : la joie qui habite le corps et l’esprit au printemps de l’âge - quand on a assez de musique en soi pour faire danser le monde.

À l’origine, les tambourinaires et les hautboïstes étaient voués à une musique sacrée, ce n’est que par la suite qu’ils ont commencé à animer les fêtes profanes. Un vrai hautboïste est un artiste qui a reçu l’enseignement d’un maître, comme nous l’explique l’amin[3] des tabbala, dinandier de son état :
- La lira (flûte de roseau) est la mère du hautbois, en ce sens qu’on s’entraîne d’abord à jouer de la lira avant d’aborder le hautbois. Mais il faut surtout s’initier auprès d’un maître. Un hautbois n’est qu’in simple instrument à huit notes, c’est la tête du musicien qui lui insuffle la transe sacrée qui fait trembler le monde. Aujourd’hui, quiconque tient un hautbois se dit hautboïste.
Durant le Ramadan, « les djinns sont enchaînés ». Il n’y a ni transe, ni rituel de possession. Seul, du haut du minaret, le hautboïste lance des airs séraphiques. C’est une musique sacrée de recueillement, d’apaisement après l’épreuve du jeûne de la journée. C’est la seule musique sacrée qu’on entend pendant le Ramadan, comme si les autres instruments et répertoires des confréries étaient diaboliques.
Un cortège sans harmonie passe justement devant l’échoppe, et le dinandier-hautboïste de s’exclamer :
- La ville est devenue sourde et muette !
Dans l’ordre de la naissance mythique des instruments de musique, le souffle primordial du hautbois a précédé le rythme du tambour. C’est d’Ouazzane, foyer de mysticisme confrérique, que le hautbois se serait propagé au reste du pays. Comme le chant des oiseaux et le bourdonnement des abeilles réveillent la nature de son sommeil hivernal, « le souffle du hautbois a réveillé un djinn de son profond sommeil annuel. Ce n’est que bien après que le rythme du tambour a commencé à se répandre à travers le monde jusqu’à nos jours ».

La magie de la nuit appelle le silence, la communion du groupe appelle la hadhra (présence divine). Dans la zaouïa, on boit le thé à l’écoute d’une lira (frêle pipeau de roseau) qu’accompagne une voix couverte comme d’un voile invisible :
Gloire à Dieu et à toi océan de lumière !
Ô patron d’Ouazzane ne m’oublie pas !
Le doux intermède de la lira prépare la phase chaude du hautbois. Les musiciens sont aussi des artisans, d’où la communauté du jargon aux deux espaces artisanal et musical. La partition musicale qui rend la présence du surnaturel possible s’appelle mramma, ou métier à tisser. C’est une juxtaposition de phrases musicales tissées par le hautbois sur la trame constante des instruments de percussion : la réussite de la partition musicale dépend du champ magnétique qui s’établit entre l’orchestre et les danseurs de la place sacrée.

Dans une fête de mariage près de Sidi Belabbès, un orchestre de jeunes interprète les chants traditionnels des artisans d’autrefois, le melhûn[4], avec batterie et guitare électrique ! Après la pose, un trio de chikhates[5] de l’aïta[6] du Haouz se joint à eux. La polyvalence des musiciens et l’éclectisme de leur auditoire font que des instruments de musique rock rythment aussi bien un vieux chant citadin qu’une chanson rurale traditionnelle, et tout le monde y trouve son compte ! Un orchestre, en effet, est en perpétuelle recomposition ; ce qui explique l’existence d’orchestres mixte dans le domaine de l’ ala andalouse :
- Les musiciens juifs de Marrakech pratiquaient uniquement l’ala andalouse. Lorsqu’on avait besoin d’eux, ou qu’ils avaient besoin de nous, on travaillait ensemble, nous assure le doyen des musiciens de Marrakech Amine Al Moutribine qui tient une boutique de fabrication d’instruments en tous genres près des selliers.

Les Moutribine sont ceux qui procurent le Tarab cette émotion musicale qu’une voix vibrante comme celle d’Oum Kaltoum pousse jusqu’à l’extase, et qui caractérise, entre autres, le melhûn depuis la dynastie saâdienne. L’art de chanter est un don de la jeunesse, et la mélodie des voix, un don de Dieu. Excellente définition du Tarab.

Hâjj Belfatmi s’occupe des fêtes officielles et religieuses, interdit l’ivresse pendant celles-ci (sauf lorsqu’elle est provoquée par Al Moutribine, ceux qui émeuvent par leur voix), intervient quand un orchestre est mal payé et défend l’intérêt des chanteurs à la retraite. Combien de musiciens d’ala évoluant dans la capitale du Royaume n’ont-t-il pas été initiés au sous-sol de sa boutique, où l’on marchande, maintenant que l’Achoura approche, tambours et tambourins ! Cependant Belfatmi reste optimiste quant à l’amélioration du niveau musical à Marrakech : « Maintenant, quand tu veux indiquer à quelqu’un le seuil d’ala, il t’en montre le fond de la demeure». Une manière comme une autre de dire combien, grâce aux moyens de diffusion moderne, les disciples sont devenus plus savants que leurs maîtres.

De musique rituelle et conviviale, le répertoire traditionnel est devenu, pour une part, un « produit » destiné à l’animation touristique. Mais si l’industrie touristique contribue à sa folklorisation, elle lui a permis, en contrepartie, de survivre. Marrakech est ainsi l’une des rares villes où reste bien vivante une musique issue de la culture d’antan.

Ainsi la vieille corporation des Nfafriya (trompettistes) est toujours bien vivante, avec son doyen, ou amine, tenancier au Derb Dabachi d’un four public qui sert de siège à ladite corporation, et où il prépare de succulentes Tanjiya. El Hâjj Rahal veille à la répartition des trompettes et des trompettistes. Ils sont quarante-quatre à monter au minaret pour réveiller les jeûneurs du Ramadan à l’heure du sort et pour animer, le restant de l’année, les fêtes profanes.

À l’origine du Neffar,[7] il y aurait eu, selon notre témoin-clé, une raison militaire - donner l’alerte surtout lors des attaques nocturnes - et un repentir religieux qui fait penser à la chute originelle après la consommation de la pomme interdite :
« C’est Lalla Aouda - enterrée à Meknès - qui est la patronne des trompettistes. Elle était fille d’un roi qui aurait rompu le Ramadan en mangeant une pêche et une grenade. Pour se faire pardonner on a recommandé, à ce roi, d’entretenir les trompettistes. Il y a des minarets à deux trompettes qui alternent les Taraouih avec un hautboïste, et d’autres qui n’en possèdent qu’une seule. Le souffle de la trompette réveille du sommeil de la nuit, comme le tocsin de la corne réveillera du sommeil de la mort, au Jugement dernier». Dès que la lumière s’allume au sommet du minaret, annonçant la prière de l’aube, le trompettiste interrompt sa communication céleste pour descendre à terre.

Très démonstratif, l’amine des Nfafria nous explique qu’un neffar comprend trois parties :
1. Le tennor avec son embouchure, qui mesure une coudée (50 cm) et six doigts ;
2. Al wasti, le tube du milieu, qui mesure une coudée ;
3. Al fals, qui vaut une coudée et quatre doigts.
« Quand on met les trois pièces bout à bout, on obtient cette trompette de trois coudées (150 cm) et dix doigts, qui a fait le tour de tant de régions et de fêtes, à travers tout le Maroc. Nous avons appris ce métier rien qu’en soufflant dans la flûte de roseau. J’ai 84 ans et je souffle dans le neffar depuis l’âge de seize ou dix-neuf ans. Nos ancêtres n’accepteraient pas de nous voir souffler ainsi dans les trompettes ».
Le four public où se terre notre trompettiste est contigu à la boutique des dqaîquiya de la troupe de Baba. Ailleurs les dqaîquiya ne sont disponibles que lors de la fête annuelle de l’achoura, alors qu’ici, on se tient prêt en permanence à toute épreuve, en « tuant le temps » à jouer aux cartes dans cette boutique sise au derb Dabachi.

La daqqa, c’est le rythme à l’état pur. Dans chaque quartier, quelque quarante joueurs de tambourin s’assoient en cercle : c’est le gor. Rythmée lentement par les battements des mains, la mélopée scandée par la moitié terrestre (Lafrach) monte au ciel, hésite en son milieu, avant d’être « saisie » par la moitié céleste (laghta) de l’orchestre. Les deux moitiés se font face, en demi-lune, alors qu’allant de l’une à l’autre, Maître Baba synchronise leur rythme avec son bendir[8].
Dans la compétition entre vieux quartiers de Marrakech - Al-Moqaf, la kasbah, Derb-Dabachi, Isbtiine, qui se déroulait sur la place de l’anéantissement, Jamaâ-Lafna, les dernières années, c’est le gor des tanneurs qui a emporté le tambourin d’argent — sorte de trophée remis la veille des feux de joie (chaâla). Et au neuvième jour du nouvel an musulman, une procession carnavalesque a lieu, dans le sillage des sept saints, avec des personnages burlesques revêtus de peau de mouton et de chapelets d’escargots.

On peut être illettré, poète et musicien. C’est la cas du Cheikh Jilali Mtired , figure emblématique de Marrakech dont une association de malhûn porte le nom. Simple marchand de légumes et de primeurs, dit-on, il vécut à la fin du XVIIIe siècle. : on doit à ce grand homme des poèmes, des modes de chant, et surtout al Harraz, imité par la suite en tant que mode et en tant que thème. Dans le milieu des artisans, Jilali Mtired est considéré à Marrakech, comme le prince des poètes. Il prétendait être inspiré par les djinns : une grenouille lui aurait adressé la parole un jour, au bassin des forgerons à Bab Lakhmis, pour l’inviter à une fête de mariage. Quand il eut chanté, les djinns lui offrirent un tambourin d’or ! La légende veut qu’il soit l’inventeur des tambourins !

Ailleurs, le marché de la musique est médiatisé par des objets - cassettes audio et vidéo. À Marrakech, c’est un marché vivant. Sa spécificité tient au fait que les musiciens professionnels sont disponibles d’une manière permanente. Dans les boutiques, où sont suspendus des instruments à anches, à percussion, ou à corde, il ne s’agit pas d’offrir un produit musical, mais rien moins que les musiciens eux-mêmes ! C’est une espèce de «mouqaf »[9] musical. Une sorte de marché du rythme à la disposition de toute fête organisée dans la ville. Et les instruments sont là, non seulement pour l’orchestre attendant d’éventuels clients, mais aussi pour être loués à des orchestres fantômes. Ce qui prouve que les musiciens « professionnels » ne forment que la partie émergée de l’iceberg : leurs clients se révèlent être parfois eux-mêmes des musiciens occasionnels. Un inoffensif aiguiseur de couteaux peut être à l’occasion un redoutable connaisseur de malhûn. Ainsi en est-il d’Abbas, l’authentique, qui depuis cinquante-quatre ans ne cesse d’aiguiser les couteaux et les mots. Pour lui, les gens sont comparables aux métaux - de l’or au vil alliage - mais le vrai frère, c’est le dirham !

La diffusion massive des minicassettes constitue en soi un phénomène culturel de première importance. Tant pour la reproduction de la musique populaire locale que pour la musique venue d’ailleurs ; les minicassettes sont un nouveau moment dans l’évolution de la culture populaire et sa déstabilisation continuelle. La culture est toujours ambulante et en mouvement : soit elle déambule et voyage comme autrefois, et encore aujourd’hui, en carriole, soit elle emprunte la voie des ondes et des bandes magnétiques. Mais la musique populaire est d’abord une musique à vivre en communion, une musique de participation et de partage : aucune technique ne peut remplacer le plaisir de recueillir le chant des moissonneurs, d’écouter la cantilène d’une bergère à la margelle d’un puits ou de participer à un feu de joie au Haut-Atlas. Abdelkader MANA
[1] Les tabbala : les tambourinaires.
[2] La daqqa, C’est le rythme à l’état pur. À la veille du 1er Moharram, jour de l’an musulman – annoncé par la nouvelle lune — le rythme de la Daqqa envahit les rues de la ville.
Il semblerait que la daqqa — un véritable tapage nocturne qui relève à la fois du charivari et des mascarades carnavalesques — soit originaire de la ville berbère de Taroudant, d’où elle s’est diffusée avec le commerce transsaharien vers Marrakech puis Essaouira.
[3] L’amine : Le doyen des artisans, leur garant.
[4] Le melhûn, comme composante de l’identité culturelle des artisans des vieilles cités marocaines, est à la fois un legs bédouin sur le plan poétique et un legs andalou sur le plan musical. Beaucoup de mots de cette poésie populaire ne sont plus usités. Il serait le chant par lequel les chameliers rythmaient le déhanchement des caravanes.
[5] Chikhates : Chanteuses, danseuses. Chez les Romains, des prostituées sacrées vendaient leurs charmes au bénéfice de la divinité, dans son temple. Il est possible que les chikhate soient les héritières de cette antique tradition méditerranéenne.
[6] L’aïta (l’appel) est un genre musical, spécifique aux plaines atlantiques arabophones, céréalières et pastorales. Remontant à l’implantation des Béni Hilal et des Béni Maâquil, elle porte la marque des chevaliers errants tout autant que d’une sensualité ritualisée. Une aïta des tribus côtières dit :
« Allons voir la mer
Restons face aux vagues jusqu’au vertige ».
[7] Trompette annonçant les fêtes religieuses
[8] Tambour à cadre muni de sonnailles, permettant au chef d’orchestre de synchroniser la rythmique des percussionnistes. Ainsi au cours du carnaval nocturne de l’achoura, on chantait à Essaouira :
Vaillant compagnon, frappe ton bendir
La nuit est encore longue.
Vaillant compagnon, frappe ton bendir
Vois donc venir l’aube
[9] Mouqaf : Un lieu où l’on se tient debout pour offrir sa force de travail.
00:49 Écrit par elhajthami dans Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : musique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
22/11/2009
Tapis - Tableaux
Tapis-Tableaux : l'art de l'indicible
Matière et manière
Par Abdelkader MANA | LE MATIN
Publié le : 14.11.2008 | 14h45

Des œuvres d'art, peuvent se faufiler à notre insu au milieu des objets utilitaires, jusqu'au jour où le regard exercé de l'expert vient les tirer de l'anonymat auquel ils étaient initialement destinées, pour nous révéler leur dignité .
Et c'est ce que nous propose Frédéric Damgaard, en publiant en ce mois de novembre 2008 un très beau livre sur l'art des femmes berbères au Maroc.
Il faut, en effet, avoir le regard exercé par une longue fréquentation des formes et des couleurs pour dénicher chez la femme berbère le tapis -tableau qui renvoie à l'art contemporain. Comme jadis il avait découvert des talents d'artiste chez des autodidactes d'Essaouira et de sa région, le désormais célèbre critique d'art Danois, nous propose maintenant sa collection de tissage rurale comme autant d'œuvres d'art.. Après Omar Khayam qui disait dans un célèbre quatrain :

« Allège le pas, car le visage de la terre est recouvert des yeux des biens aimés disparus », on a envie de dire désormais à quiconque foule un tapis : « Faites attention ! Vous êtes peut-être en train de fouler une œuvre d'art ! »
En effet, au-delà de l'origine ethnographique de tel ou tel tapis ou tissage, ce qui frappe dans la collection du désormais célèbre critique d'art Danois, c'est d'abord la puissance d'expression des formes et des couleurs, qui séduit d'emblée le regard. On tombe immédiatement sous le charme magique de ces objets d'art, comme on reconnaît sans médiation la beauté d'un poème ou d'une partition musicale. Formes florales, anthropomorphiques, sinusoïdales ou géométriques, soupoudrées d'or, de rouge et de noir. Damgaard choisit volontairement de mettre en relief des détails pour souligner davantage la parenté explicite qui existe entre cet art des femmes rurales et l'art contemporain au Maroc et ailleurs.

Tapis - tableaux qui se prêtent à une double lecture horizontale et verticale ou parfois même le « défaut » de fabrication ou l'usure du temps contribuent à ce caractère insolite et indicible de l'art rural, qui se caractérise par la gourmandise de ses formes et sa transgression de la sacro-sainte règle de symétrie de l'art citadin. Chaque niveau est différent du suivant et le même motif n'est jamais reproduit sous la même forme et la même couleur : variation sur la même note musicale. Et toujours cette harmonie mystérieuse qui anime la structure d'ensemble malgré les contrastes apparents et l'interpénétration de l'horizontal d'avec le vertical.

Des couleurs chaudes comme l'amour et la tendresse féminine. Comme les noces d'été et les fêtes saisonnières. Comme les rêves au lendemain d'une nuit nuptiale. Et toujours ce bonheur de rêvasser sur ces surfaces chatoyantes comme au bord de l'eau et au voisinage du feu. Comme une traversée de champs dorés parsemés de marguerites et de coquelicots. On a l'impression de surprendre non pas une tisseuse mais une rêveuse qui tisse par ses fils d'or et de soie, son paradis imaginaire, son jardin secret. La fraîcheur de son regard à la levée des aubes resplendissantes et son éblouissement par les couleurs du crépuscule.

Énigmatique plaisir dont seul l'artiste a le secret. Qui oserait piétiner de tels œuvres, que pourtant la tisseuse destinait à un usage purement utilitaire, et à qui le regard expert d'un Damgaard, donne une dignité d'œuvre d'art. Comme dans une rêverie créatrice, La tisseuse passe d'une forme à l'autre, d'une couleur à l'autre, pour nous offrir en fin de parcours un tapis – tableau que ne renierait pas l'artiste d'avant-garde le plus contemporain qui soit. Musique silencieuse, émerveillement, moment de grâce. En somme une invitation à la rêverie visuelle, où rien n'est définitivement délimité à l'avance, où les formes en suspens semblent suggérer une continuité vers l'infini au-delà du cadre limité du tapis- tableau. Un espace de prière et pour la prière. Un art sacré donc. Mais aussi un art festif : jaune d'or, mauve pâle…Mais dans l'ensemble on ne sait pas de quelle poésie, de quel mystère, de quelle beauté tout cela est le signe..

On se dit : comment es-ce possible qu'avec un nombre si limité de signes, de symboles et de couleurs, on en est arrivé à ce langage de l'infini ? Chaque tapis – tableau est si différent de l'autre. Et chaque tapis – tableau transcende d'une manière si surprenante les déterminismes ethniques de son origine pour atteindre une expression esthétique universelle. Beauté intrinsèque. Esthétisme qui opère magiquement et immédiatement sur le regard. On est là aux origines de l'art contemporain marocain : mémoire tatouée, transfiguration des saisons printanières d'un pays berbère aux luminosités solaires. Voici donc l'hommage de l'homme venu du grand Nord à l'art des femmes berbères du grand Sud marocain.Le point commun entre la plupart des tapis présentés dans l'ouvrage est d'appartenir soit à des transhumants, soit à des nomades : Béni Mguild, Béni Waraïn, la région de Boujaâd, les Rehamna, les Oulad Bou Sbaâ, les Chiadma et Sidi Mokhtar qui fournit la khaïma aux Regraga pour leur pérégrinations printanières.

De là à déceler dans ces tapis berbères une influence saharienne, voire africaine, il n'y a qu'un pas que l'auteur franchit allègrement y compris à juste titre pour des montagnards sédentaires tel les Glawa dont le col de Telouat était connu pour être un lieu de passage obligé entre l'Univers saharien et africain au sud et l'univers méditerranéen au nord.

C'est principalement les deux courants culturellement marquants du monde berbère proprement dit. En effet, certains tapis présentés dans l'ouvrage évoque ces masques africains sous forme de croix superposées, des totem ou des scènes de chasse telles qu'on peut encore les voir aujourd'hui dans la grotte d'Agdez au Sahara, du temps où celui-ci était verdoyant et attirait pachydermes, autruches et chasseurs africains qu'on voit reproduits par des peintures rupestres.

C'est que le Sahara a été non pas un obstacle mais plutôt un lieu de brassage et de métissage, entre les sédentaires Masmouda, les nomades Sanhaja, et le Soudan (le pays des noirs), bien avant l'arrivée des moulattamoune (ces porteurs de lithâm (voile), ces arabes maâqil Hassan, qui furent le fer de lance des Almoravides, et qui partirent à la conquête de l'Andalousie musulmane depuis les ribât, ces couvents – forteresses, du bord du fleuve Sénégal..
----------------------------------------------------------------------
Par delà les formes et les couleurs communes
L'ouvrage présente toutes les techniques du tissage au Maroc,depuis le tapis en laine du Moyen Atlas, en passant par le « Boucharouette » de la région de Boujaâd, le tissage broché Glawa, le tapis noué Aït Seghrouchen, jusqu'au couvertures hanbel Zemmour. Et cela concerne des objets de la vie quotidienne aussi variés que le tapis de selle,le sac, le sacoche, le coussin, la tente des nomades et des transhumants. Cela concerne le vestimentaire au féminin: telle la handira (cap de femme), la tadarrat (le voile de cérémonie), le tissus brodé d'Ighrem ou de Tata. Mais le vestimentaire se conjugue aussi au masculin : en commençant par la djellabah et la tunique de laine que portaient jadis les moines guerriers, en passant par de très beaux capuchons et bonnets de bergers de haute montagne.
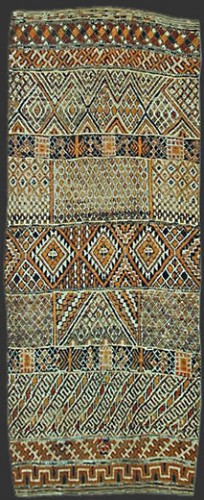
Des vêtements en laine épaisse pour affronter les rigueurs de l'hiver qui caractérise aussi bien les cimes enneigées de Bou Iblân chez les Béni Waraïn du nord-est que ceux des Glawa au sud-ouest. Là haut, il fait en effet très froid, de sorte que dès la tonte des moutons, les tisseuses berbères confectionnent d'épais tapis de laine pour isoler du sol, que des vêtements chauds pour protéger du vent glacial et sec qui balaie les cimes granitiques et dénudées.

On fait alors des provisions de navets pour des couscous bien gras.
Les berbères sont connus pour trois choses me disait mon père : le port du burnous, la consommation du couscous et les crânes rasés. D'où la nécessité de les couvrir de capuchons et de bonnets surtout quand il neige et quand il pleut. Mais que ces bonnets et ces capuchons soient hauts en couleurs ! Tel en a décidé la bergère à destination de son berger ! Un mode de vêtir qui n'appartient nullement au Musée de l'histoire, et dont la fonctionnalité est loin d'être simplement folklorique.

Village Bni waraïne
Et quand en ces hautes cimes de l'Atlas les tisseuses homériques d'Iswal en pays Glawa se préparent aux rigueurs de l'hiver en fredonnant de frais refrains tout en maniant l'antique quenouille – les chants des tisseuses accompagnent tout le processus du tissage – on obtient alors des objets esthétiques plutôt qu'utilitaires.
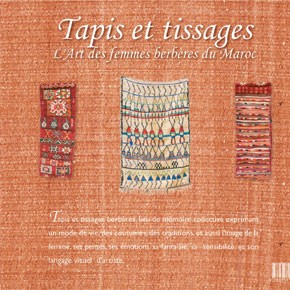
13:03 Écrit par elhajthami dans Arts | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le temps des consuls
Le temps des consuls
Par Abdelkader Mana
Hier, en passant devant le cimetière « rasé » de Bab Marrakech — il paraît que les musulmans ont le droit de raser les cimetières au bout de soixante-dix ans — et en particulier devant les trois palmiers où mon père disait qu’Abdessalam, son tuteur, était enterré ; j’ai passé plus d’un quart d’heure à lutter contre le trou de mémoire, pour retrouver le nom d’Abdessalam : trou de mémoire pour sépulture disparue. Devoir de mémoire envers mon père et ma mère. Le jour où je m’attaquerais à cette amnésie, ce jour-là, je pourrais peut-être m’autoproclamer « écrivain ».

Abdesslam, l’homme à la sépulture disparue qui a élevé mon père vendait de la farine près de la minoterie Sandillon. Le nom de ce dernier figure dans la toute première alliance israelite de Mogador : les élèves de cette école étaient, en juillet 1905, au nombre de 206, dont un Français, le jeune Sandillon. Le local de l’école était au premier étage d’une maison de la nouvelle kasbah – l’actuel commissariat de police. La présence d’une seule école anglaise de filles créait une situation particulière aux enfants des autres nationalités qui étaient obligés de suivre ses cours, c’était le cas des filles de Mr Sandillon, le minotier français de la ville.
Ce Sandillon, dont je me sens si proche parce qu’il avait fondé au début du XXe siècle, le premier journal que Mogador ait jamais connu. À la fin des années 1980, quand je menais des recherches sur l’histoire de la ville, j’avais retrouvé dans un fichier de la bibliothèque de Rabat, la collection complète de ce journal ! Malheureusement, à chaque demande, le bibliothécaire revenait les mains désespérément vides, me disant que le journal avait disparu. C’était au moment même où la minoterie vacillait sous la violence des vents avant de disparaître à son tour.
Dix ans auparavant la veuve de Sandillon est revenue dans le sillage des nostalgiques français de Mogador.Ils étaient conviés à un somptueux dîner aux langoustes, dans l’ancienne résidence du contrôleur civil qui avait été confisquée par le protectorat au caïds Anflous après sa reddition en 1912, et qui appartient désormais à ce président du conseil municipal qui a pour coloration politique, les oranges. J’ai alors servi de traducteur à ce président araophone dans le style du vieux Makhzen, qui disait comprendre l’émotion de ces revenants, pour qui les rivages de Mogador symbolisaient les temps à jamais révolus de leur jeunesse. Madame Sandillon m’a prise alors à part pour me dire :
« Quand nous sommes arrivés en haut du promontoire d’Azelf, à la vue d’Essaouira au bord de l’eau, je ne pus m’empêcher de pleurer de désespoir ».
Et combien je comprends sa douleur. Je lui disais alors que selon mon père, à l’instar de son mari, il y avait un homme qui tenait boutique de chimères au quartier des Boukhara — où résida la garde noire de Moulay Ismaïl — et qui tenait un journal quotidien de tout ce qui se passait dans la ville : intempéries, hausses de prix, arrivée de caravanes, naufrage de marins …
À l’époque, il y avait encore des consuls européens dans la ville.Le citoyen Broussonet est le premier vice-consul français à Mogador Ce fut seulement en 1798, qu’il partit de Montpellier pour rejoindre son poste à Mogador : « je serais au comble de mes vœux , écrit-il si je pouvais être envoyé à Mogador ; c’est le lieu de passage des oiseaux qui viennent d’Europe, et la quantité de volaille qu’on y trouve est réellement prodigieuse. »
En y arrivant il y découvrit« d’immenses argans, dont on recueillait alors les fruits » ainsi que le thuia, dont on tire la résine de sardanaque ; « le thuia sandaraque ; le gommier, arbre important du genre de mimosa, dont on tire une gomme qui est un des objets du commerce du pays, que les arabes emploient en onguent dans les maladies cutanées ; un stapélia, leur sert d’aliment et grand nombre d’autres végétaux rares et inconnus. »

Et au cinéma Scala, devant l’atelier de mon père, c’était le consulat d’Allemagne. Mon père me disait qu’en sa halle se tenait la criée des marchandises avariées en haute mer.Lors de l’une de ces criées, alors que la femme du consul d’Allemagne traversait le hall, l’un des participants à la criée n’avait plus d’yeux que pour ses beaux atours. Le consul qui présidait la séance se leva alors et jeta violemment l’importun dehors.
La femme du consul avait aussi un jeune soupirant qui venait jouer du luth chaque soir au pied de sa fenêtre. Lorsque le consul l’a su, il convoqua son père et mit un revolver sous son nez en le menaçant ainsi :
« Si jamais on me rapporte une nouvelle fois que ton fils est revenu jouer du luth sous les fenêtres de ma femme, il ne sera plus de ce monde ! »
Le père du soupirant s’empressa aussitôt d’envoyer son fils à Fès d’où il était originaire. Et mon père de poursuivre :
« Conformément à la volonté du consul, sa dépouille a été rapatriée sur un voilier vers l’Allemagne ».
Le négociant Touf El Âzz, dont nous avons hérité de la maison, faisait partie des actionnaires du voilier « Le Prophète », qui rapatria le cercueil du consul vers l’Allemagne(voir mon texte sur ce blog sur"le temps des consuls"). Et Abdessalam, le tuteur de mon père, avait vu partir le cercueil du consul d’Allemagne du port de Mogadors. Car il était l’une des sentinelles du port ou s’amoncelait les marchandises en partance vers l’Europe : blé, amandes, caroubes, plumes d’autruches, gomme de sardanac etc. Une nuit, le chef de la patrouille du port l’a interpellé ainsi en plein sommeil :
- Alors Abdessalam !
Et lui de répondre en sursautant :
- La gâchette est à mi-pente !
Depuis lors, on surnomma notre famille « Nass Talaâ » (mi-pente).

D’un précédent mariage, Mina, ma grand-mère paternelle avait eu le coléreux poissonnier Omar, le demi-frère de mon père. Son père s’appelait Ahmed et il était originaire d’une famille tunisienne du nom de « Mana ». Un jour, après avoir fait le marché, il entendit du vestibule, le chant des chikhate à l’étage : il déposa alors son couffin et revint sur ses pas au port où il embarqua vers une destinée inconnue. Des années plus tard il revint à Sidi Mogdoul, saint patron de la ville, et de là demanda à voir Omar son fils : on se refusa à se plier à sa volonté de peur qu’il n’enlève l’enfant. Depuis lors, on ne l’a plus revu, mais il nous a laissé le nom de famille « Mana » plus élégant à porter que celui de « Nass Talaâ » (Mi-pente).
Je viens d’avoir de ma tante maternelle toujours vivante, les précisions suivantes : en fait c’est le père d’Abdessalam — qui portait le nom de « Hajoub Nass Talaâ » (Hajoub « mi-pente ») qui était la véritable sentinelle du port. De sa femme Zahra, il avait deux garçons : Abdessalam le marchand de farine de la minoterie Sandillon qui a élevé sévèrement mon père — il l’interpellait uniquement du surnom de « carross » (bghel) — et son frère Si Mohamed qui avait un jour embarqué sur un voilier en partance de Mogador pour ne plus revenir.
Tante Fatima me raconte aujourd’hui :
- Jusqu’à sa mort, la mère du disparu avait scruté l’horizon sous le vieux figuier de la porte de la marine, en espérant son retour à en devenir folle. Elle consultait souvent à ce sujet les voyantes : pouvaient-elles lui dire si, un jour, son fils allait revenir avant sa propre mort ?
Abdelkader MANA

06:59 Écrit par elhajthami dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mogador, consuls, négoçiants |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
17/11/2009
Mohamed Sijilmassi
L’INVITE DU LUNDI
Le Docteur Mohamed Sijilmassi

Choisir notre destin, par rapport à notre histoire.

Nous inaugurons ce lundi<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> une nouvelle chronique. Elle s’intitule « L’invité du lundi ». Ainsi donc, chaque lundi, « Maroc – Soir » engagera un entretien avec un homme ou une femme, du Maroc ou de l’étranger, appartenant au monde de la politique, de l’économie, des sciences ou de la culture. Cette rubrique, en ouvrant la voie à des talents de s’exprimer publiquement, nourrit l’ambition d’élargir l’horizon du débat serein et des connaissances enrichissantes. Notre premier invité est le Dr. Sijilmassi. Homme de science et de culture, il est pédiatre de profession. A ce titre, il a publié récemment un livre chez SODEN sur « les enfants du Maghreb », où il parle d’ailleurs de rites de passage et d’imaginaire, ce qui ne nous éloigne pas de ses préoccupations artistiques. Cependant, on sort avec l’impression frappante qu’on a rendu visite plus à un historien de l’art qu’à un médecin : son cabinet de travail est un véritable musée d’art moderne. Dans la salle d’attente, un gigantesque tableau de Fatima Hassan attire particulièrement l’attention. Il a d’ailleurs déjà publié un livre sur « la peinture marocaine », un autre sur « la calligraphie arabe » (en collaboration avec Abdelkébir Khatibi), enfin, il vient de publier son dernier livre sur « les arts traditionnels au Maroc ». L’auteur a d’ailleurs un nom prédestiné, puisque Sijilmassa était la capital économique et culturelle du Sahara dont l’art se caractérise par une certaine simplicité et une certaine austérité qui semble être justement les traits de caractère dominants du Dr. Sijilmassi. Son livre est un répertoire de la créativité des grands maâlam (maîtres - artisans). La conception mentale étant toujours plus rapide que la maîtrise gestuelle : le maître est justement celui qui est parvenu à transmettre de l’intelligence à ses gestes. L’apprentissage avec ses rites d’initiation qui ponctuent le passage du statut d’apprenti à celui de compagnon et, enfin de maître, vise cette plénitude du geste où la main devient pensée. L’œuvre du Dr. Sijilmassi, qui nous accorda cette interview, restitue admirablement cette pensée de synthèse qui fait à la fois la spécificité et l’universalité de l’art marocain.Entretien réalisé par Abdelkader MANA.

Maroc Soir : L’art fait que les objets ont une âme ; c’est l’esprit qui se fait matière. Il semble même, d’après vos recherches, que les symboles qu’on retrouve dans la bijouterie et les tatouages ont une fonction magique de protection contre le mauvais œil, l’avortement et l’adultère…
Dr.Sijilmassi : Le tatouage porte la trace d’une culture qui s’imprime sur le corps et rend la peau médiatrice entre l’extérieur et l’intérieur de la personne tatouée. Lorsque des objets d’art sont décorés par les mêmes dessins que ceux des tatouages, il s’établit entre le corps et les objets une symbiose exceptionnelle, comme cela est le cas dans l’art rural marocain. D’autre part, le tatouage signifie l’appartenance à une même lignée et à une même tribu. Enfin le dessin d’un tatouage reste longtemps gravé en notre mémoire et marque l’entrée dans la vie.
Maroc Soir : Des fouilles archéologiques ont mis en évidence des vestiges phéniciens ; ont-ils eu un impact sur l’art traditionnel marocain ?
Dr.Sijilmassi : Il est difficile de le prouver. A mon avis l’art phénicien n’a pas été repris dans la vie quotidienne. Ce n’est qu’à partir de l’islamisation du Maroc qu’il y a eu un véritable renouveau et un enrichissement qui a crée un art original et autonome bien que s’inscrivant dans l’univers de l’art islamique. Dans la ville, il y a une manière de décorer qui est assez homogène ; elle s’inspire de cet art islamique dont l’Andalous n’est qu’une variante. Cette unité de style citadin vient de l’unité de la source : esthétique arabo –musulmane qui lui a donné naissance et qu’elle a enrichi. Cet art s’est d’abord développé dans l’architecture avant d’imprégner les autres objets.
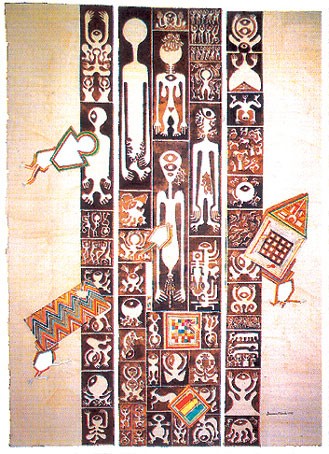
Maroc Soir : C’est l’art de la symétrie, de l’harmonie et de la répétition rituelle ?
Dr.Sijilmassi : Oui, car tout se ramène à Dieu, lignes épigraphiques, lignes florales et lignes géométriques s’unissent les unes aux autres et se répètent indéfiniment comme le nom d’Allah qu’égrène un chapelet…
Maroc Soir : entre le Maroc et l’Andalousie, la diffusion culturelle n’était pas à sens unique ?
Dr.Sijilmassi : Non. On parle par exemple de calligraphie maghrébine et andalouse. Les Almoravides ont épuré l’arabesque et innové dans le domaine architectural aussi bien au niveau des formes des surfaces décorées que des volumes. Il y a eu donc, un échange culturel au sens le plus profond du terme : recevoir et donner ce qu’on a imaginer soi – même.
Maroc Soir : Quelles étaient à votre avis les causes de cette créativité au Maroc ?
Dr.Sijilmassi : La créativité artistique n’est pas un luxe contemplatif, mais une source d’équilibre et « d’écologie ». Créer et décorer un objet chez les Marocains rural et Saharien répondent à une nécessité fonctionnelle et immédiate d’abord, lointaine ensuite. Ce langage oublié, bien que codifié, répond à des moments forts de la vie, tout en s’inscrivant dans l’ordre islamique établi et ses innombrables interprétations sécurisantes. L’artiste – artisan grave le bois, martèle le cuivre, façonne le bijoux, dessine la poterie, fait et défait les nœuds du tapis, il envoie des messages de Rabat à Oujda, de Nador à Dakhla, sachant qu’il transmet par sa créativité un univers qui porte les pulsions de la vie et nous renseigne sur l’imaginaire des marocains et son évolution depuis la nuit des temps.
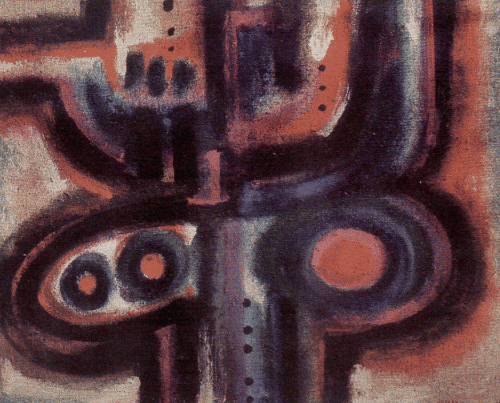
Ahmed Cherkaoui un precurseur particulierement apprecie par Mohamed Sijilmassi
Maroc Soir : En dehors de ce que la géographie imprègne, il y a des raisons historiques au développement d’un certain style ?
Dr.Sijilmassi : En effet le Maroc est le seul pays à ne pas avoir subi l’occupation Ottomane qui a nivelé l’art dans toutes les contrées qu’elle a occupé même dans le domaine culinaire. Notre cuisine se distingue des autres pays arabo – islamiques.
Maroc Soir : Il est très connu que l’art dépend de la commande et que sans commande un genre artistique se meurt. Sachant que son travail était apprécié à sa juste valeur, le maâlam le faisait avec patience et amour.
Dr.Sijilmassi : Les mécènes sont les Rois, les princes et les intellectuels qui ont toujours encouragé la créativité artistique au Maroc. C’est avec Moulay Ismaël que les arts traditionnels ont connu un éclat et une créativité dont l’influence s’est perpétuée jusqu’au Maroc moderne. Et on assiste actuellement, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Hassan II, à un retour aux sources et à la revalorisation de la tradition artistique. Nous en avons un exemple dans les magnifiques arabesques du Mausolée Mohamed V à Rabat, dans la mise en valeur des différents palais du Royaume qui ont été restaurés et enrichis par de nouveaux éléments décoratifs, leur rendant leur splendeur d’antan. Nous en avons aussi un exemple dans le magnifique musée du palais de Fès, où des objets d’art citadins, rural et Saharien, des peintures et des sculptures modernes ont été rassemblées sous les directives de SM Hassan II, pour offrir un panorama complet de la variété dans la créativité des artistes – artisans marocains.
Maroc Soir : L’artisan citadin était perfectionniste pour mériter de plein droit le titre de maâlem (maître) dont on l’affuble. Il s’oppose à l’artisan de la campagne qui n’est pas comme lui à la recherche de la finesse des formes mais à celle de leur gourmandise et de leur vitalité naturelle. On a l’impression qu’il y a la rigueur d’un côté et une liberté de l’autre ?
Dr.Sijilmassi : Cette différence est due au fait que dans la ville les artistes – artisans sont regroupés en corporation et l’artisan reste engagé dans la continuité de la tradition. On passe par tout un cycle d’apprentissage et par tout un rite d’initiation avant d’être reconnu comme maâlem . Alors qu’à la campagne le contrôle social est plus relâché du fait de la dispersion de l’habitat, l’artiste – artisan évolue de lui – même et la créativité est plus libre et plus individuelle. Dans la campagne le maâlem n’est jugé que par le consommateur alors que dans la ville, il est jugé et par le consommateur et par la corporation. Il y a chez les ruraux une parfaite maîtrise de l’espace : ils osent remplir une surface de motifs qui ne se rapprochent pas les uns des autres en les plaçant délibérément asymétriques mais qui ne heurte pas le regard. Au contraire, il accroche et crée un échange entre le spectateur et l’objet qu’il observe.
Maroc Soir : La transmission intergénérationnelle du « savoir faire » devient de plus en plus défaillante. Mais du même coup les jeunes se libèrent des vieux carcans…
Dr.Sijilmassi : En effet, depuis quelques années, on assiste à un renouveau de l’artisanat du fait que les nouveaux artisans ont fréquenté l’école et se sont ouvert sur le monde. Certains émergent d’une manière significative. Je pense à Lamani, le céramiste de Safi – décédé il y a quelques années – qui avait travaillé à Sèvre en France, et de retour chez lui, il innové énormément dans le domaine de la poterie, à telle enseigne qu’on reconnaît sa signature uniquement par son style. La créativité dans les arts traditionnels continue. C’est pourquoi j’ai inséré volontairement dans mon livre des chefs d’œuvre récents qui n’ont rien à envier à ceux du XIXème siècle.

Ahmed CHERKAOUI
Maroc Soir : C’est cette créativité collective qui semble avoir inspirer beaucoup d’artistes contemporains ?
Dr.Sijilmassi : L’exemple du peintre Cherkaoui est éloquent. Il a poussé très loin l’analyse d’objets traditionnels. En épurant de plus en plus le dessin, il vous restitue en deux traits les configurations d’une main ou celle d’un tapis rural. Belkahya s’est inspiré quant à lui, de l’art Saharien, Fatima Hassan choisit les thèmes de la vie quotidienne et Ouadghiri, l’imaginaire enraciné dans le centre populaire…
Maroc Soir : C’est un mouvement de retour aux sources, de réconciliation avec soi ?
Dr.Sijilmassi : Il faut d’abord retrouver son identité culturelle ensuite la laisser s’épanouir. Il y a toute une génération qui n’a pas connu le Protectorat et qui a une autre vision de la société en rupture avec celle des aînés, notamment dans le domaine des méthodes éducatives. Faire moderne, oui, mais tout en restant attaché aux traditions culturelles. Il y a tout un nouveau discours sur l’art populaire qui est revalorisant, tout en sachant qu’il y a nécessité d’innovation.
Maroc Soir : Prendre la technique tout en sauvegardant son âme ?...
Dr.Sijilmassi : Nous n’avons plus de complexe vis– à - vis de l’occident. Notre intelligence est mûre et capable d’adopter la haute technologie. Maintenant nous sommes responsables de choisir notre destin, non pas par rapport à l’occident, mais par rapport à notre histoire.
Propos recueillis par Abdelkader Mana

Entretien paru à Maroc – Soir du Lundi 10 novembre 1986-7 Rabia I, 1407-N°5155
09:45 Écrit par elhajthami dans Entretien | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Driss Chraïbi
L’invité du lundi[i]
Driss Chraïbi

Un immense éclat de rire critique

Je pars donc en pèlerinage vers El Jadida pour le rencontrer comme on part en pèlerinage vers un marabout au milieu de son sanctuaire. Mais Driss Chraïbi est un marabout vivant. Au cours du voyage, je lis son « naissance à l’ aube ». Par quelle question faut-il commencer ? Le faire parler d’Oqbq Ibn Nafii et Tariq Ibn Ziad, ses héros ? Des paysans et des montagnes qu’il aime et qu’ il décrit si bien ? On verra bien.
Du rire surtout et de l’humour, parce que de ses livres se dégage un immense éclat de rire critique. Le fleuve d’Oum Rbia est en cru, signe de bonnes augures, un moment de grâce et d’écriture pour ce fils de « la mère du printemps ». La mer est rouge, l ’Oum Rbia l’ a certainement fécondé. Au loin, au bout de la baie des araucarias se dressent comme des lances des guerriers d’ Oqba Ibn Nafii, vers le ciel gris. Le calme. Le silence. La paix sur la ville. Cet entretien a eu lieu en marchant a travers les ruelles d’ El Jadida, pas à pas, mot après mot du gîte ou l’ écrivain se terre pour écrire – Dieu je ne sais quoi !- a l’ école maternelle où se trouve son fils.
Entretien réalisé par Abdelkader MANA

Citernes portugaises de Mazagan
M.S. – On constate chez vous un grand intérêt pour l ’Islam et le monde paysan…
Driss Chraïbi – Moi je crois qu’on est arrive partout dans le monde et principalement dans notre pays – dans la sphère arabo - musulmane - à abandonner les idées pour revenir a la vie. De telle sorte que mes derniers livres comme « naissance à l’aube » ou « l’Oum Rbia » (la mère du printemps), portent non plus sur une idée ou une théorie, une simple vue de l’esprit mais sur l’homme. J’ai dû faire appel à l’imaginaire comme si j’avais abandonné cette misérable fin du vingtième siècle pour revenir très, très loin dans le passé.
M.S. – Vous avez horreur des concepts ?
Driss Chraïbi – Absolument. Je ne suis pas un homme abstrait du tout. Je suis un homme concret tel que vous me voyez.
M.S. – Vous aimez les mots qui giclent comme la vase de l’Oum Rbia sous vos pieds ?
Driss Chraïbi – Oui. Les mots concrets avec un sens, un contenant et un contenu. Les mots qu’on puisse toucher, sentir, regarder ; qui ne s’adressent pas seulement au cerveau, qui soient reliés à la fois à notre passe millénaire et qui rejoignent l’an 2000.
M.S. – Peut-on explorer l’histoire, remonter l’horloge du temps par les mythes et les légendes et pas seulement en se référant à Ibn khaldoun ?
Driss Chraïbi – Je dirai davantage, parce que les mythes et les légendes franchissent les siècles et deuxièmement ils sont la mémoire du peuple. Ibn Khaldoun est l’un de mes maîtres à penser mais il n’est lu que dans certain milieu. C’était un homme rigoureux qui appelait un chat un chat, qui traitait ses confrères écrivains de langue « kaddid »(viande boucanée). Seulement, c’était un homme de réflexion alors que les traditions populaires ont la vie plus dure que les livres.
M.S. – Donc il y a tout un pan de l’histoire que l’historien ignore ?
Driss Chraïbi – Oui, je crois. Mais je ne suis pas historien. Alors loin de moi cette idée ou cette prétention. Ce que je peux dire : Pour écrire « naissance à l’aube », j’ai lu énormément un livre d’Ibn Abdelhakam qui donnait d’un événement cinq ou six sources différentes. Donc cinq ou six interprétations différentes. J’ai commencé à écrire un livre qui collait a la réalité – « naissance à l’aube », c’est à dire « naissance à l’Andalousie » sous la conduite d’un personnage extraordinaire ; Tariq Ibn Ziad qui était Marocain, on suppose qu’il était berbère. Cette première version là, j’ai eu le courage de la brûler. Parce que c’était un roman historique. J’ai fait appel au rêve beaucoup plus loin que l’histoire. Et c’est la plus belle chose que chacun de nous porte en soi – c’est à dire la part du rêve qui rejoint ce que vous disiez tout à l’heure sur les mythes et les légendes qui surpassent et dépassent de très loin l’écrit.
Driss Chraïbi – J’écris des fois le matin très tôt ou bien encore deux heures et trois heures de l’après-midi ou à partir de onze heures du soir. Je commence par la fin du roman. Je me dis : « Tiens Driss, tu vas faire comme l’âne des Doukkala ; vas vers l’écurie, vas vers cette fin, « dabbar rasak » (débrouilles-toi). Je construis de plus en plus des personnages qui sont indépendants de moi. Ils ont leur autonomie, et chaque fois que je m’aperçois sur le plan de l’écriture qu’ils ne tiennent plus la route, j’interviens personnellement : j’ai le courage de prendre cette page-là, de la jeter au feu et de recommencer : c’est autrui, ce sont les personnages qui parlent. Je ne suis en fait que leur servant, leur porte voix et c’est ce qui explique le succès de certains livres.
M.S. –Qu’est-ce que ça veut dire pour vous la littérature, l’art ?
Driss Chraïbi – Ce n’est pas une entreprise d’Etat, ce n’est pas une entreprise collective – on a vu ce qu’était devenue la littérature sous Staline. La littérature ou la culture est une entreprise individuelle ; il faut retrousser ses manches et apporter sa pierre. On commence par une certaine critique. La critique pour elle-même lorsqu’elle devient négative est absolument stérile, et pour le créateur ou l’intellectuel et pour le monde dans lequel il vit. Moi, j’ai 60 ans. Je considère qu’étant revenu ici dans la terre de mes ancêtres, j’ai ma carrière qui commence et loin de moi toute affaire de critique, parce que j’ai résolu tous mes problèmes et que j’ai envie de construire. Un créateur c’est d’abord quelqu’un qui construit. D’abord pour lui-même ensuite pour les lecteurs à qui il s’adresse. Je n’aime pas les gens qui comptent sur l’Etat (Adawla). Nous devons, chacun de nous, compté sur soi-même. Je vous dis cela parce que j’étais en occident, loin de tout, sans aucune aide et me voici.

Driss Chraïbi – Vous voulez dire comment ça se passe mon séjour au Maroc ? J’ai eu la chance inouïe de visiter de fond en comble, de long en large, le Royaume de sa Majesté. Eh bien, c’est magnifique. Moi, je trouve que c’est absolument magnifique. Je vous dis magnifique, paisible, en toute liberté. Je vous le dis parce que j’ai un esprit lucide. C’est ce qui me permet de vous dire que nous vivons dans un pays appelé à devenir en l’an 2000 ; le pays par excellence de tout le monde Arabe. Je le sais et je le sais d’expérience.
M.S. – Au vu du fanatisme qui enflamme le monde ; le gouvernement de Sa Majesté mène une politique de dialogue et de tolérance qu’en pensez vous ?
Driss Chraïbi – Je l’ai dis il y a quelques jours à la faculté des lettres de Mohammadia – où j’ai donné une conférence devant une salle comble d’étudiants – et j’ai eu chaud au cœur. Chaud au cœur. J’ai dis simplement que nous sommes début janvier, qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, que je souhaitais une bonne année à mon auditoire et qu’en premier lieu, ma première pensée va vers notre Souverain à qui j’adresse – par la voie du journal Maroc - Soir – mon salut d’humble et de fidèle serviteur. Je le soutiens à 100% ; premièrement parce qu’il a su maintenir l’unité du pays, deuxièmement parce qu’il a donné de ce pays une image internationale et troisièmement il est notre Commandeur des Croyants. Et ceci, sans flatter personne, je continue à ne faire que de la littérature.

M.S. –Es-ce que vous n’aimeriez pas que vos livres soient aussi enseigner au Maroc ?
Driss Chraïbi – Mais ils sont enseignés au Maroc ! Ça,
ça,me frappe. C’est ce que j’ai dis dans les C.P.R., les facultés, les C.C.F. Certains livres qui sont des brûlots, qui sont assez critiques, comme « le passé simple » par exemple. Mais il y a longtemps qu’ils sont enseignés ici dans le Royaume. Donc ça prouve que ce pays est extrêmement libéral. Imaginez un livre comme « Le fleuve détourné » de Rachid Mimouni ? Mais il est interdit en Algérie !
M.S. – Il y a une constante dans toute votre œuvre depuis « le passé simple » : votre rapport paradoxal à la religion ?
Driss Chraïbi – Je ne m’interroges pas quand j’écris un livre. Vous voyez, le problème de l’Islam ne devait pas poser problème. Il pose problème pour l’Occident, pour moi, non. Simplement, je m’insurge devant certains pays – que je ne veux pas nommer – qui donnent une triste image de l’Islam. Un triste pays comme par exemple l’Iran. Ce qui ne peut que renforcer certains pays du monde occidental qui ont horreur du monde islamique. Dans tout ce que cela comporte : à la fois la religion, une façon de vivre et une culture. Ce qui renforce les sionistes.
M.S. –On peut supposer d’après certains passages de vos livres que vous considérez la religion comme un ensemble de contraintes irrationnelles ?
Driss Chraïbi – Oui, moi, je me base sur l’Islam premier qui dit textuellement : « En Islam point de contraintes ». c’est tout. D’autre part, on m’a interrogé assez souvent autour de mon long périple, qui a duré trois mois à travers le Royaume du Maroc – et quel beau Royaume !- on m’a interrogé sur l’Islam. Et j’ai toujours répondu que l’Islam est une affaire personnelle entre l’homme et son créateur. C’est tout.
M.S. – Vous vous élevez contre le fanatisme ?
Driss Chraïbi – Absolument. Probablement parce que je ne suis pas fanatique moi-même. J’appelle fanatique quelqu’un qui est angoissé, qui doute de lui. Je ne doute pas de moi, je n’ai pas d’angoisse et je me trouve dans un pays islamique – ici au Maroc – qui a toujours été premièrement le bastion de l’islam – il n’y a qu’à lire l’histoire – et deuxièmement un pays extrêmement tolérant.
M.S. – On ne peut s’empêcher d’éclater de rire en lisant certains de vos passages ; par le côté humoristique vous êtes un peu notre Charles Dickens ?
Driss Chraïbi – Certains de mes livres je les écris en riant. Il se trouve que le rire et l’humour portent beaucoup plus loin que la violence et l’agressivité. Probablement parce que j’ai encore toutes mes dents que je n’ai pas encore envie d’écrire mes mémoires. Au contraire, mes prochaines œuvres – des contes pour enfants que je vais adapter pour la RTM, que je veux publier aux éditions la SODEN – sont des contes pour enfants qui font « mourir de rire » (pas littéralement). Ce ne sont pas des contes édifiants, moralisants etc. L’humour qui éclate est une preuve de bonne santé.

M.S. – Dans « le passé simple » vous dites qu’il y a un rapport entre l’éducation au Msid et le succès des marocains dans la course à pied : comme en atteste Aouita…
Driss Chraïbi – Ça, c’est de l’humour. Mais de l’humour féroce. C’est à dire que la plante des pieds avec les falaka a été tellement mise à l’épreuve que le macadam ou la piste ne fait absolument pus aucun mal à la plante des pieds. Ça forme le caractère des gens. C’est de l’humour noir. Dans « enquête au pays », il y a un fellah qui est là, debout en pleine chaleur – 40° à l’ombre – dans un champs avec des épines mais les pieds nues.
M.S. – Ce n’est pas les épines du chiendents ?
Driss Chraïbi –Les chiendents de l’humanité !

M.S. – On s’approche maintenant de la maternelle où étudie votre enfant…
Driss Chraïbi – Oui, pourquoi Maroc – Soir ne ferait-il donc pas d’enquête sur les maternelles ?
M.S. – On en fera incha’Allah.
Driss Chraïbi – La maman de mon enfant est britannique : première langue, l’Anglais. Chez nous, en France nous parlons français et lorsqu’il est arrivé ici, je l’ai inscrit voici trois mois dans un jardin d’enfants où l’arabe classique est devenu son moteur, son problème numéro 1. Il se lève le matin, répète, révise avec sa maman l’arabe classique que j’ai étudié mais qu’après 30 ans d’absence, j’ai du oublié. Cela m’a donné l’idée de faire un film que j’intitulerai «An 2000 ». Ce film va être produit entièrement par le service culturel de l’ambassade de France – pourquoi pas ? – que je réaliserai et que j’offrirai par la suite à la RTM –pourquoi pas ? Le sujet est très simple : je vais filmer la journée de trois enfants : le mien qui est tout blanc. Une petite fille marocaine et un petit garçon khamri, à travers leur journée d’enfants. Puisqu’ils sont d’origines différentes, ça sera donc trois provinces différentes. Ça me permettra de filmer El Jadida et les Doukkala, Tétouan et sa province et Fès. De ces trois enfants il y aura le rappel par voix off des ancêtres depuis les temps les plus reculés. La ligne conductrice est celle-ci : lorsque ces enfants auront vingt ans. Donc le titre du film est « Maroc 2000 ».

M.S. – Nous voilà arrivés à la maternelle, je vois votre enfant jouer avec ses petits camarades.
Driss Chraïbi – Oui, Yacine, le âfrit est habillé en vert. Je joue avec mes enfants parce que je les ai crées : je suis à la fois leur père et leur copain. En même temps, je me ressource auprès d’eux, je recharge ma soif de vivre dans leur jeunesse.

M.S. – Faites-moi visiter la maternelle.
Driss Chraïbi – Nous sommes en janvier 1987, le temps est loin où j’allais dans ma première école le msid que j’ai critiqué au « passé simple » parce que la méthode éducative était « apprendre sous la contrainte »…
M.S. – La falaka ?
Driss Chraïbi –Oui. Il n’y a pas de falaka ici. Les murs sont couverts de peinture comme vous pouvez vous en rendre compte. Il y a l’ABCD en Français mais également le lif, lam, jim, ha en langue Arabe. Vous avez de petites tables sous forme de fleurs ; une idée géniale. De temps en temps, je viens ici lorsque je suis bloqué dans un chapitre particulièrement ardu de mes livres. Je viens m’asseoir sur une petite chaise de 30 centimètres à côté des enfants et je me trouve parfaitement heureux comme si je recommençais ma vie. Parce qu’un livre aussi beau soit-il me laisse toujours sur ma faim et je me dis : « Tiens, il faut aller vers plus de sincérité, plus d’authenticité, plus de beauté. » Vous avez vu tout à l’heure la salle de repos avec vidéo etc. Il y a la salle de peinture où les enfants sur un thème choisi donnent libre court à leur imagination. C’est à dire, si on dit : « Tiens, dessines- moi un escargot », l’enseignant ne voit aucun inconvénient à ce que l’enfant dessine la mer ou l’arbre. On cultive aussi l’expression gestuelle ou de jeux, de telle sorte que depuis que nous sommes ici, ça fait un quart d’heure, l’enfant qui est très attaché à moi, ne m’accorde aucune importance et est parfaitement intégré aux autres. Cette méthode d’enseignement développe le sens communautaire chez les enfants. Ils forment un groupe de filles et de garçons.
M.S. – Qu’en dites vous Monsieur le directeur ?
Le directeur. – La méthode consiste à laisser l’enfant libre pour s’épanouir ; nous le laissons faire ce qu’il veut tout en le surveillant…
M.S. – Avez-vous lu des livres de Driss Chraïbi ?
Le directeur. – J’ai lu son dernier livre : c’est différent de son livre très connu « le passé simple » : c’est un autre Français, c’est pas tout à fait la même chose.
Driss Chraïbi – Ne vous en faites pas Monsieur le directeur ; mon prochain bouquin, je vais vous l’écrire en un seul exemplaire, uniquement pour vous. Ça , c’est de l’humour.
Propos recueillis par Abdelkader Mana

C’est le 15 juillet 1926, à Mazagan (El Jadida) sur la côte atlantique, qu’est né Driss CHRAÏBI, auteur d’une vingtaine d’ouvrages traduits dans le monde entier.
En 1954, à l’âge de 28 ans, il publie chez Gallimard, « Le passé simple », son ouvrage le plus célèbre .
En 1967, la revue marocaine d’avant garde « Souffles », que dirigeait le poète Abdellatif Laâbi, et dans laquelle écrivaient entre autre, Tahar Ben Jelloun et Mohamed Kheir Eddine, consacre l’un de ses premiers numéro à Driss CHAÏBI.
En 1987, après 30 années d’exile, Driss CHRAÏBI, rentre au Maroc, le visite de fond en comble pendant trois mois et revient en pèlerin à El Jadida, lieu de sa naissance et de ses racines profondes.
Le dimanche 4 avril 2007, Driss CHRAÏBI s’éteint à l’âge de 81 ans dans le Dôme au sud-est de la France.
01:35 Écrit par elhajthami dans Entretien | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
16/11/2009
Mémoire en devenir...
Abdelkébir KHATIBI
« Une mémoire en devenir »

En me rendant d’Essaouira à Casablanca, le lundi 16 mars 2009, je suis profondément bouleversé par l’annonce de la mort de mon ami Abdelkébir KHATIBI. Ce qui m’a le plus bouleversé, c’est d’avoir au bout du fil sa fille éplorée : « Ils vont l’enterré au cimetière des martyres ! » me disait-elle. De lui, j’ai voulu m’entretenir avec n’importe qui. En me disant quelque peu coupable : il faut écrire quelque chose. Mais quoi ? Mon immense tristesse et ma solitude de plus en plus grande. Une amie m’a cependant conseillé de ne pas renoncer à exprimer à chaud, ma tristesse, sans qu’il y ait là ni culpabilité ni narcissisme de ma part : partager – faire part- de notre sensible expérience, et quelles que soient les couleurs qui lui viennent, à notre sensibilité, si tel est le sens de notre humaine humanité. En un mot « faire un travail sur soi » et sur sa « mémoire en devenir », comme me le conseillait Abdelkébir KHATIBI, lui-même.

J’avais travaillé avec lui à la revue Signes du Présent[1] en 1988, où j’ai publié « Sociétés sans horloge », mon étude comparative entre « Les Argonautes du pacifique occidental » de Bronislaw Malinovski et le Daour des Regraga auquel je venais de participer. Dans cette étude j’écrivais entre autre : Dans cette énorme roue qu’est le temps, les vies humaines ne constituent que des jalons qui se succèdent de génération en génération jusqu’à l’horizon des siècles qui se perdent. Les Regraga s’obstinent à tourner autour du printemps : on a du mal à percevoir chez eux, le temps qui passe, les hommes qui s’en vont dans le silence. Il y a donc plusieurs « revenir » : celui des saisons, celui du rituel, celui du mythe et celui des revenants comme le note le romancier marocain Abdelkebir Khatibi :
« La tradition est le revenir de ce qui est oublié. Ce revenir doit être retenu et questionné pour qu’il nous indique le chemin des morts qui parlent. Que dit la tradition – toute la tradition ? Elle dit le séjour du divin dans le cœur et la raison des hommes. Ce séjour, la métaphysique l’a recueilli dès l’éveil de la pensée. La métaphysique est en quelque sorte, le ciel spirituel de la tradition ».

Invité à un colloque de poésie en Italie, Abdelkébir Khatibi, m’avait alors confié son propre bureau à l’Institut Universitaire de la Recherche Scientifique pour y écrire mon étude qui sera publiée cette même année au n°4 de Signes du présent, consacré au temps et à la culture technique. Abdelkébir Khatibi y publiait un intermède intitulé « Jeux de hasard et de langage ». Il m’avait également chargé d’un compte rendu d’ouvrages d’auteurs ayant traité du temps : l’horloge hydraulique de Fès d’après un document arabe d’Al Jazari, l’horloge chinoise d’après Nedham, l’attracteur universel d’après Ilia Prigogine, prix Nobel de Chimie... A son retour d’Italie, il m’avait confié que pour lui « le temps, c’est la vie ».
Cette collaboration qui m’avait permis de publier ma seule étude véritablement scientifique, n’est pas née du hasard : comme il me l’a confié lui –même, mon étude comparative avait pour arrière plan « tout un livre » et surtout tout un travail de terrain qui a duré quatre années auprès des Regraga en pays Chiadma, soit de 1984 à 1988. Mais ma première rencontre avec Abdelkébir remonte à 1987, quand en tant que journaliste, j’ai publié le 12 janvier à Maroc Soir, notre entretien intitulé :« Notre mémoire est une richesse, prenons-la en charge » . On y décelait déjà sa préoccupation du temps qu’il s’agisse de l’eternel retour ou le temps irréversible de la mort et de l’histoire :
Maroc soir. – Dans votre dernier recueil « Dédicace à l’année qui vienne », il y a un rapport au temps cosmique et saisonnier, au temps amoureux. L’année, l’anniversaire, le mois, le jour, la clarté à partir des lois propres de la poésie. Donc dédicace à l’année qui vient. Vous rejoignez un peu les rites de passage qui font partie de notre culture...
Abdelkébir Khatibi : Oui, c’est d’ailleurs une poésie ritualisée. Dans le deuxième poème, il est dit : « Ritualiser chaque mot en son cadre d’or ». Ritualiser, en faire une cérémonie et que le principe de ces poèmes c’est donc fonder la poésie sur des gestes qui existent dans notre société aussi. C'est-à-dire le rite, le retour des fêtes, des années...
Maroc-Soir. – Mais il n’y a pas de rites sans musique. Marcel Mauss disait : « L’homme est un animal rythmique ». Vous parlez vous-même de la musique du silence, je vous cite : « Cette belle idée de l’art rendue humblement au silence des choses »...
Abdelkébir Khatibi : Oui, j’essaie dans la mesure de mes moyens de retrouver ce que j’appelle « une mémoire en devenir ». C’est qu’il y a toute une richesse en nous que nous ignorons. Parce que nous imitons trop vite soit la poésie des autres soit l’écriture des autres. Alors qu’en nous, dans notre sensibilité il y a une part très riche mais à côté de nous. Alors, comment peu à peu découvrir cette mémoire en devenir ? C’est un travail sur soi. Il n’y a pas d’autres voies que de travailler sur soi – je ne parle pas simplement affectivement et au jour le jour, régler les problèmes de l’économie, du travail. Mais je pense aussi au travail sur soi, quand on est artiste. Ce travail sur soi demande de puiser dans sa force et de la reconnaître, de lui donner sa place.
Maroc-Soir.- Dans les pays Arabes les rapports entre hommes et femmes sont entourés de trop d’interdits...
Abdelkébir Khatibi : Il ne faut pas exagérer, il y a des choses qui sont dites, d’autres silencieuses. Chaque société a des règles sur l’interdit, sur la parole interdite. Mais pour quelqu’un qui lit au second degré ; il trouve toujours qu’on parle d’une certaine manière d’une société. Si vous lisez par exemple « L’anthologie de la poésie Esquimau », vous allez trouver partout cette métaphore ; en parlant d’une femme, le poète dit : « Vous êtes belle comme un petit phoque ». Evidemment pour un arabe ça ne veut rien dire le « petit phoque ». Lui, il a parlé de gazelle, d’oiseaux, de colombe ou, de métaphores végétales différentes. Donc la représentation de l’amour sous forme poétique change.
Maroc-Soir.- La tradition n’est pas seulement ces « mort qui nous parlent » ; la tradition retrouvée et travaillée peut devenir une nouvelle source de créativité...
Abdelkébir Khatibi : Ah oui, moi j’irai assez loin – et je crois que j’ai eu l’occasion de le dire devant l’Union des Ecrivains Marocains – que dans la tradition poétique marocaine ( c’est la poésie populaire Arabe, Berbère) est de très loin la plus importante, la plus adaptée à notre imaginaire. Je considère Sidi Abderrahman el-Majdoub comme le meilleur poète Marocain jusqu’à maintenant. La poésie populaire dans ses différentes composantes – la plaine, la côte, la montagne – peut entrer dans une mémoire en devenir. Par exemple l’audio-visuel – qui n’est pas encore techniquement avancé chez nous – s’il veut travailler sérieusement devrait entrer en contact grâce à des artistes, avec l’art et la culture populaire. C’est une chose qui n’est pas encore faite. Donc au lieu que la culture populaire soit simplement décorative ou folklorisée ; elle est partie prenante de l’avenir et de la mémoire en devenir. Elle peut donner naissance – grâce à des artistes et des poètes – à de nouvelles formes artistiques. Je vais vous donner un exemple qui n’est pas Marocain : le grand pianiste Chopin – l’un des plus grands écouté dans le monde – avait écrit la plupart de ses partitions à partir des airs populaires polonais, et il en a fait une musique internationale et mondiale. Il a fait la synthèse entre la musique classique et la musique populaire. A mon avis, c’est un travail sur nous, c’est de prendre en charge toutes les stratifications de notre mémoire qui est une richesse.
Maroc-Soir – Les représentations paysannes sont parfois poétiques comme ce jeune fellah qui me dit : « La coccinelle nait simplement de la rosée du blé » ?
Abdelkébir Khatibi : C’est très beau ce qu’il dit sur la coccinelle. Ça me fait penser à une coccinelle qui a fait tout le voyage du Sud de Suède en train avec moi. Elle était là dans le wagon. On a pris le ferry boat pour traverser et elle a disparu. Une coccinelle qui a donc passé les frontières à sa manière sans passeport. On pouvait faire un conte sur les coccinelles qui traversent les frontières. La coccinelle en arabe, en berbère, en français, est une métaphore d’autre chose.
Maroc-Soir – Un autre fellah me fait cette réflexion : « Il y a deux types d’esprits. Ceux qui sont soit mâle soit femelle sont stériles. Seuls ceux qui sont à la fois mâle et femelle fécondent les idées ». Je vous rapporte ces propos parce qu’ils me font penser à certaines de vos réflexions sur l’androgyne.
Abdelkébir Khatibi : Dans ma tête, l’androgynie c’est une manière de vouloir faire un. C’est l’amour lui-même. C’est la tentation de l’amour de faire un et en fait il y a un et un, ça fait deux. Il y a une sexualisation. Et il y a trois, le troisième étant l’enfant. Donc, l’amour, c’est vouloir faire de trois l’un. Ce qui est évidemment une tentation mythique de l’androgyne depuis longtemps. Il faut bien mettre les choses au point entre la réalité et l’imaginaire mythique. L’androgyne pour moi c’est le mythe de l’unité de l’amour, c’est tout.
Maroc-Soir – Un conteur populaire me dit un jour : Le jour de la résurrection même les analphabètes retrouveront la faculté d’écrire ; l’indexe sera leur plume, la bouche leur encrier et le linceul la page blanche. Comme le miracle coranique avait commencé pour le Prophète par l’impératif : « Lis ! », le miracle de la résurrection commencera pour chacun d’entre nous par l’impératif : « écris ! ». Qu’en pensez-vous ?
Abdelkébir Khatibi : On peut interpréter de différentes manières. Je ne suivrais pas sa manière d’interpréter. Mais par exemple, symboliquement l’enfant apprend la langue, il naît au monde en tant que corps et puis il naît au langage en apprenant le premier mot, son nom propre, le nom propre de sa mère, son père, son entourage et il entre dans le langage comme naissance. Une résurrection dans ce sens là, parce qu’elle permet de rentrer dans un autre ordre du symbolique qui change les choses dans le sens où l’activité de l’écrit a sa loi propre. C’est une activité qui laisse des traces, qui durent et qui entrent dans une mémoire et dans une généalogie de textes, qui se transmet de siècles en siècle. Donc, la résurrection c’est la survie aussi de textes dans ce sens là.
Suite donc à cet entretien paru à Maroc Soir le lundi 12 janvier 1987,Abdelkébir Khatibi m’avait confié son bureau en 1988 pour le suivi rédactionnel du numéro sur le Temps de la revue Signes du Présent. En son absence, j’ai reçu dans son propre bureau deux invités de marque: Noayiki Sawada qui préparait pour la revue Gendaïshiso de Tokyo un numéro consacré à l’Islam (qui paraîtra l’année suivante, 1989) où il va traduire en japonais le chapitre de « Maghreb pluriel »qu’Abdelkébir Khatibi avait consacré à « la sexualité dans le Coran » . Le chercheur japonais m’a semblé un arabisant très au fait des textes d’Ibn Khaldoune. J’ai également reçu l’économiste Habib El Malki, juste avant qu’il ne devient ministre de l’agriculture : Il était venu chercher ses contributions dans d’anciens numéros du Bulletin Economique et Social du Maroc. A l’époque Mohamed Kably venait de publier son ouvrage « Société, pouvoir et religion au Maroc, à la fin du Moyen –Age » dont Abdelkébir Khatibi me disait tout le bien en me recommandant vivement sa lecture : « C’est un ouvrage majeur sur les mérinides » me disait-il. L’historien des mérinide avait d’ailleurs contribué à un ouvrage collectif dirigé par Abdelkébir Khatibi sur les Ecrivains marocains (du protectorat à 1945), paru à Paris en 1975 aux éditions Sindbad.
Que ce soit pour les ouvrages collectifs ou pour la revue Signes du Présent, Abdelkébir Khatibi privilégiait toujours les collaborations ponctuelles sur un thème donné avec tel ou tel chercheur ou écrivain en fonction de ses compétences. Il avait donc une activité multiple et travaillait simultanément sur plusieurs projets à la fois : tout en préparant le n° 4 de Signes du Présent avec l’équipe maroco française de Rabat, il travaillait sur la traduction en japonais de son texte sur « la sexualité dans le Coran », et participait au colloque de poésie en Italie. Cette même année de 1988 Khatibi publie un texte intitulé Andalûcias, avec une introduction de Jean Goytisolo accompagné de 8 sérigraphies de E.Arroyo, F. Belkahya, M.Chabaa, L.R.Gordillo, J.Hermandez, M.Kacimi, A.Sadouk et A.Saura. Andalûcias, était écris en trois langues (arabe, espagnol, français) et destiné en série limité à l’Exposition Universelle qui s’est tenu au pavillon du Maroc à Séville, en septembre 1992. Tel que je l’ai connu, Abdelkébir KHATIBI débordait d’activité au point qu’il lui manquait du temps pour tout faire. Et en même temps, il était toujours disponible et accueillant.
Le dernier entretien que j’ai eu avec lui, en tant que journaliste et que j’ai publié dans l’hebdomadaire Le Temps du Maroc, n°63, du 10 au 16 janvier 1997, avait comme titre cette déclaration qu’il m’avait faite :« A la fin de ce siècle, nous avons à nous positionner par rapport à nous- même et par rapport au monde ». C’est un esthète à l’esprit éveillé en permanence qui vient de nous quitter, en nous laissant une œuvre immense et novatrice que nous devons étudier et méditer pour prendre en charge notre mémoire en devenir.
Abdelkader M A N A
[1] Avec une seule thématique par numéro, Signes du Présent , revue scientifique et culturelle, se voulait plus moderne et plus attrayante, que son ancêtre Le Bulletin Economique et Social du Maroc. Tous deux étaient d’ailleurs dirigés par Abdelkébir Khatibi.
16:34 Écrit par elhajthami dans hommage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Nostalgie
Le goût de l’anis et de la nostalgie

Les mouettes sont des vagues qui prennent leur envol
Et les vagues, des mouettes qui grondent
Quand on brise une vague
Une aile vous pénètre profondément
Et quand on brise une aile
Une vague vous pénètre profondément
Ecoutez les trois mouettes briser leurs oeufs
Comme si la mer surgissait du sable pour la première fois
Avec comme notes musicales : l’éclosion d’œufs de mouettes
Moubarak Raji
Le destin étrange d’une famille qui fit partie de mon enfance me revient d’une manière lancinante et nostalgique. Il s’agit de la belle Jraïfiya, de son compagnon Moulay El Fatka, et leur fils Choukri : un trio de légende au destin pathétique. Tout d’abord Jraïfiya, qui a vendu au cours des années 1970 l’actuelle « Villa Maroc », pour des clopinettes, avant de se retirer à Agadir, où elle mourra plus de chagrin que de maladie. Il faut dire qu’au temps des tournages d’Othello sur les remparts de la ville, Jraïfiya était la Desdemona incarnée de Mogador. L’actuelle Villa-Maroc, lui tenait lieu de maison close. C’était paraît-il, une beauté aux charmes irrésistibles. Ceux qui avaient du pouvoir et de l’argent trouvaient auprès d’elle l’idylle apaisante qui flattait leur ego. Il fallait littéralement se ruiner pour honorer la table de Jraïfiya et faire partie du cercle étroit qui accède à ses charmes et à ceux de ces filles. Le pacha borgne faisait partie de ces heureux élus qui venaient savourer les bonnes choses de la vie en s’enivrant de vin fin, en écoutant les classiques du Tarab Oriental, telles Oum Kaltoum et Smahan des années trentes. Ce même pacha borgne qui avait droit aux plaisirs de la maison close de Jraïfiya pouvait s’ériger le lendemain dans son bureau en juge et bon gardien de la morale de la cité !
Du temps de Jraïfiya, les plus beaux fruits étaient destinés à la clientèle sélective qui avait accès à sa maison close. Dans mon enfance, j’ai pu connaître de près son mari, Moulay El Fatka, parce que ce personnage haut en couleur était un compagnon bucolique de « Dadda Brahim », le chauffeur d’autocar et mari de ma tante maternelle, chez qui je passais mes vacances d’été à Casablanca.
Ma tante maternelle habitait alors dans la médina d’Essaouira du côté de la Scala de la mer — la maison même où était né Bouganim Ami, l’auteur du « Récit du Mellah », comme il me l’a indiqué lui-même lors de son bref séjour de 1998. Une maison avec patio où la lumière venait d’en haut. Et moi tout petit au deuxième étage regardant le vide à travers des moucharabiehs et répétant la chanson en vogue à la radio :
C’est pour toi que je chante
Ô fille de la médina !
Ma tante a dû déménager par la suite à Casablanca, d’abord à la maison de Derb Sultan — juste à côté du marché et des escaliers du chemin de fer, là où tout petit je me suis perdu un jour me retrouvant aux mains d’une inconnue dénommée l’« Aârifa », représentant le pouvoir municipal dans le quartier des Hobous, ensuite au quartier de villas dénommé France-Ville. Dadda Brahim a dû y accéder en signe d’amélioration de son niveau économique, aussi à un moment où ces quartiers chics étaient en voie de marocanisation après le départ des Français. Da Brahim travaillait alors aux transports intervilles du Grand – Sud que possédaient les Aït Mzal, issus d’une grande tribu du Souss qui avait prospéré d’abord dans le commerce caravanier avant de s’adonner au transport des voyageurs, reliant par autocar Tafraout à Casablanca.
A l’alliance israélite où j’étudiais, on m’accorda alors de beaux livres pour enfant, que je n’ai pu recevoir à l’estrade, mais que Zagouri, mon institutrice, me fit alors venir chez le pâtissier Driss, où j’ai eu droit et aux Beaux Livres et à un gâteau au chocolat ! Je lui ai menti, en lui disant que je n’ai pas pu assisté à la remise des prix parce que j’étais parti à Chichaoua ! En réalité l’appel de la plage et des vacances étaient plus forts, surtout quand les élèves se mettaient à chanter à la récréation dans la cour :
« Gai gai l’écolier, c’est demain les vacances...
Adieu ma petite maîtresse qui m’a donné le prix
Et quand je suis en classe qui m’a fait tant pleurer !
Passons par la fenêtre cassons tous les carreaux,
Cassons la gueule du maître avec des coups de belgha (babouches)
Pratiquement chaque été, juste après avoir chanté à l’école israélite ce fameux chant des adieux, je me rendais en vacances à France - ville chez ma tante. Là où j’ai connu, à la puberté, mon premier amour, à la lumière duquel je lisais tous les grands amours de la littérature, depuis les maux du jeune Werther de Goethe, jusqu’au « Premier amour » de Tourgueniev. Je la vois encore tricotant sous l’oranger de la villa, les yeux baissés mais brûlant à la fois sous mes regards ardents et les chants d’Oum Kaltoum scandant au crépuscule les quatrains d’un Khayyam sur la vanité des jours sans amour… J’étais fou d’Amina, ma cousine si proche et si inaccessible ! J’en rêvais à chaque retour de Casablanca en regardant la haie des eucalyptus que traversait l’autocar dirigé par son père, et en écoutant la voix mélancolique d’une Asmahan ! Elle était brune, à la chevelure et aux yeux ardents « d’un tel noir, ô mes frères, qu’ils m’ont ravi », comme disait le vieux chant de la ville.
Da Brahim, son père, arrivait souvent le soir avec des moutons entiers, qu’il achetait aux bouchers en cours de route, si bien que le réfrigérateur était toujours plein de nourriture et surtout d’une odeur d’alcool tellement agréable, qui m’intrigua longtemps avant que je ne découvre sur le tard que c’était de l’arôme d’anis qui émanait des bouteilles de Ricard. Cette odeur d’anis, si caractéristique, je l’ai toujours identifiée à la présence, dans la charmante villa de France –Ville — qui a vu éclore mon premier amour — de Da-Brahim revenant de ses lointains et incessants voyages et surtout avec celle du loufoque et corpulent Moulay El Fatka, que je croisais au bain – douches le lendemain au sortir de longues veillées bucoliques avec Da-Brahim, passées à boire du Ricard à l’odeur d’anis , qui me donnait tant de rêves paradisiaques et olfactifs.
En rentrant un soir d’un long voyage entre Tafraout et Casablanca, Da Brahim mourut très jeune au début des années soixante-dix. Ma tante meurtrie, nous dira le lendemain, qu’il s’était levé pour aller au bain, et qu’au retour, il s’est endormi pour ne plus se réveiller. Ce jour-là je m’isolai sous un abricotier de la paisible demeure de France-Ville et je me mis sans me rendre compte à rédiger le premier texte de ma vie : un poème au goût d’anis et d’amertume, inspiré par la fin de mon premier et dernier amour.
De la cirrhose du foie Da Brahim était mort, et la mort est d’autant plus injuste qu’elle retire à notre affection des êtres si jeunes. Des années plus tard, son compagnon de veillées bucolique mourut à son tour de la même cirrhose de foie. Il laissa un fils unique qui lui ressemblait à tous égards aussi bien par son caractère loufoque que pour son amour du vin et de la vie qu’il croquait à pleines dents. C’était Choukri le fils de Jraïfiya et de Moulay El Fatka.
Dans les années soixante-dix, à Essaouira, c’était le temps des hippies. Et Jraïfiya qui avait déjà perdu ses charmes d’antan, leur louait les innombrables pièces de son ex-maison close de la kasbah. Son fils, Choukri, profitait en bon adolescent de la présence de ces curieux locataires aux cheveux longs et aux regards hagards, venus fuir les images de la guerre du Vietnam, dans le sillage de Jimmy Hendrix et du Living Théâtre : « Love and peace » était leur mot d’ordre, « trip » et nudisme était leur mode de vie entre le village de Diabet et l’embouchure de l’oued Ksob. Choukri profitait donc de la présence de ces curieux locataires pour s’approvisionner en gadgets de toutes sortes : cela allait de la montre électronique, en passant par le T-shirt et les espadrilles de luxe. Objet que les autres adolescents s’empressaient de lui dérober à la première occasion, notamment quand il se mettait sous la douche. C’était le temps heureux où l’on se retrouvait aux cabines de la plage, qui étaient organisées en forme d’« arêtes de poisson » de sorte que la plage communiquait avec le grand boulevard qui tenait lieu d’allée des Anglais, aux déambulations méditerranéennes, où le jeune Choukri se distinguait particulièrement par son humour caustique quasi naturel. On voyait bien que la vie n’était pour lui – comme pour ses parents - que plaisirs épicuriens. Il n’avait aucune idée de l’effort et de la souffrance. Et pourtant, c’est par des souffrances atroces – un cancer de la gorge dont des métastases s’étendirent à la langue en phase finale — qu’il finira prématurément sa brève existence à Agadir où il s’était exilé avec sa mère — sa vie ne fut qu’une longue veillée nocturne consacrée au rire, au tabac et à l’alcool au goût d’anis et de nostalgie.
Essaouira reste une « veuve déchue qui se souvient de sa gloire », me disait mon père. Une ville hantée par les fantômes du passé comme l’exprime dans ce récit fantastique mon ami le jeune poète Moubarek Raji :
Ici, je ris, je pleurs, je bois et je m’adresse au lointain ami, au vieux grillon dans l’âme. Es-ce que les mers des villes pauvres se vendent maintenant comme des chats siamois ?! Riez poissons de thon ! Criez, amis fantômes ! Riez araignées de mer ! Mouillez-vous d’eau salée, ombres anciennes !
Ce qui reste de l’île, c’est d’abord cette prison à ciel ouvert, recouverte de toiles d’araignée, telle une tombe de silence avec son tapis d’algues vertes et ses vestiges de murex ayant échappé aux filets des anciens pêcheurs…
Il m’importe de beaucoup le devenir de cette île. De savoir comment elle s’est envolée pierre par pierre. Au point qu’il n’en reste plus que cette prison, prisonnière de sa propre histoire. On y aurait découvert des squelettes enchaînés. Pourquoi ces chaînes pèsent – elles encore sur ces squelettes ? Ont –elles peur que leurs fantômes soient des revenants parmi les hommes ?
Il y a aussi cet homme étrange qui, depuis des lustres s’ingénie à nourrir les mouettes à l’aube, et qui ornait la porte de son échoppe de fleurs sauvages ainsi que d’un vieux squelette de mouette, comme il aurait aimé qu’on orne sa propre tombe.
Ici personne ne se soucie de l’heure qu’il est. Même l’horloge à coq n’annonce plus l’aube, car si le coq a toujours sa queue, il n’a plus de tête.« La mer n’est plus à sa place ! » avait murmuré Ringo à chaque table du café Bab Laâchour. « Depuis trois mois que je suis sur cette chaise, et mon café est toujours chaud. Trois mois ou six ans, quelle importance ! »
Tous les clients du café, montrent du doigts la prison de l’île :
- Elle s’approche ! Dans une heure l’île sera devant Bab Laâchour ! Elle y est déjà !Les barrières de sa prison s’élevaient au ciel. Les oiseaux de l’île en deviennent prisonniers. Certains clients du café nous rassuraient qu’ils avaient déjà entendu parler de ce papillon qui rêvait d’être homme et de cet homme qui rêvait d’être papillon…
Quand on s’éloigne d’Essaouira, c’est toujours sous forme de mouette qu’on la retrouve ! Leurs envol au crépuscule, leur envol au ras des vagues et au – dessus des mâts, sont la réincarnation des légendes et des mythologies marines , comme le souligne si bien Moubarek Raji, le jeune poète contemporain de la ville :
Les mouettes sont des vagues qui prennent leur envol
Et les vagues, des mouettes qui grondent
Quand on brise une vague
Une aile vous pénètre profondément
Et quand on brise une aile
Une vague vous pénètre profondément
Ecoutez les trois mouettes briser leurs oeufs
Comme si la mer surgissait du sable pour la première fois
Avec comme notes musicales : l’éclosion d’œufs de mouettes
On a retrouvé chez Ghorba, le vieux cordonnier disparu, qui pendant le Ramadan du haut des minarets enchantait la ville, par les airs séraphiques de son hautbois, seul instrument de musique admis, à l’exclusion de tous les autres, considérés comme étant diaboliques en ce temps d’abstinence, un manuscrit légué par Saddiq, poète de la ville, ayant vécu au XIXème siècle : on a dégagé, tel un talisman, un poème dédié à « Aylal et Aylala » (goéland et mouette).
Ce poème est le seul à être sauvegardé de la khazna perdue de Ghorba. Le terme khazna désigne le trésor de manuscrits contenant les qasida de malhûn, que les connaisseurs consevent jalousement au fond d’un coffre. Ghora le cordonnier d’Essaouira, le hautboïste virtuose, l’adepte des Hamadcha, qui a perdu un œil lors d’une compétition chantée du rzoun de l’achoura, était l’un des principaux khazzan (conservateurs) des qasidas du genre malhûn. Il refusait d’en transmettre le contenu à ceux qui enquêtaient au début des années 1980 sur les paroles oubliées d’Essaouira, jusqu’au jour où après sa mort, sa vétuste boutique de cordonnier s’effondra engloutissant à jamais sous les décombre, tout le trésor poétique qu’il conservait si jalousement.
. Que raconte le poète à travers cette qasida-talisman, d’« Aylal » et d’« Aylala » ? La légende d’un couple de mouettes ayant niché au dessus de la terrasse où vivait le poète de ces îles purpuraires où n’existaient que le sable et le vent. Ils finirent par focaliser son attention d’autant plus que goélands et mouettes étaient nombreux à s’élever en nuées successives au dessus de sa tête :
Tout commença avec un couple de mouettes
Qui s’en vint bâtir son nid au dessus de ma terrasse
Leurs robes blanchâtres scintillaient tels les sommets enneigés
Et le burnous gris du bien – aimé virevoltait dans les cieux
Fascination de tout ce qui est cloué au sol pour tout ce qui vole
Un jour le mâle s’est envolé pour ne plus revenir
Vint alors un chaton menaçant qui se hissa vers le nid
Restée seule que peut faire la mouette au milieu des tempêtes ?!
Qu’elle s’envole ou qu’elle demeure, ses petits seront la proie du félin,
Ses jacassements emplissent alors les fortifications du port
Des centaines d’oiseaux survolèrent l’éplorée
Le félin disparu, le vent tomba, et mon âme s’apaisa
C’est ce qui arrive à celle qui a vendu sa ceinture d’or
Permettant à l’inconnu de dérober ce qu’elle a de plus précieux
Elle a beau lancé des appels de détresse, personne n’y répond
C’est un poète – conteur qui composa cette qasida sur la mouette
Comme il en aurait composé sur l’abeille ou la flamme effilochée
Interroge – toi plutôt sur le sens des symboles
Prends une lampe et va déchiffrer à ton tour les symboles de la vie
Ne fais aucune confiance au temps, Ô toi qui comprend !
Il fait d’une hutte un château
Et d’un palais une ruines ensablées dans la baie !
Pour ce poète comme pour le magicien de la terre qu’était Boujamaâ Lakhdar, les représentations de la nature – salamandre, gazelle, mouette, abeille, etc.- sont souvent des symboles anthropomorphiques dont il faut déceler le sens au-delà des apparences. Une mouette n’est pas une mouette, elle est pour l’artiste peintre le symbole même de la ville. Le dernier tableau peint par Boujamaâ Lakhdar, avant sa disparition en 1989, représentait une mouette fantastique portant sur ses ailes les signes et les symboles magiques de la ville.
Abdelkader MANA
15:16 Écrit par elhajthami dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mogador, nostalgie, poésie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook





