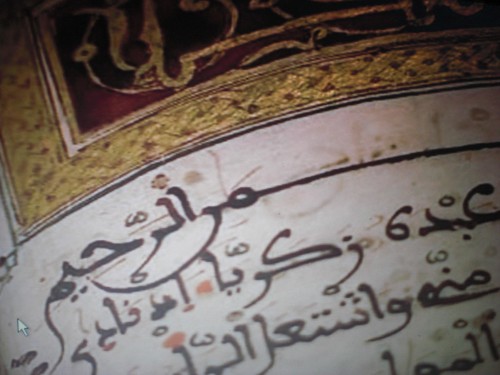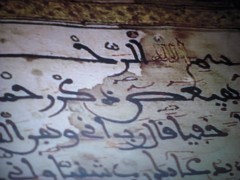05/06/2011
Musique andalouse et thérapie de l’exile...
Le modèle musical andalous
Dans tout le Maghreb, les zaouia citadines, ont servi de conservatoire pour le Modèle Musical Médini d’origine andalouse. Ce modèle a été introduit à Essaouira par les artisans d’origine andalouse aussi bien musulmans que juifs. Il semblerait qu’on venait de loin à Mogador pour consulter David Iflah et David El Qayem sur les noubas andalouses disparues. Et mon père me racontait comment le grand chantre du samaâ d’Essaouira – le père d’Abderrahim Souiri – s’asseyait dans sa jeunesse aux escaliers des maisons juives où avait eu lieu un mariage pour écouter les modulations vocales des pyutims juifs de Mogador, qui sont l’équivalent des bayteïnes dans l’oratorio des confréries de l’extase..Les Zaouïa comme réceptacle du legs Andalous en particulier pour le samaâ (l’oratorio).Gardiennes de la tradition,la plupart des zaouia se présentent comme le centre d’épanouissement pour l’art musical à un tel point que leur répertoire respectif est devenu la norme à partir de laquelle se juge la compétence des musiciens. La majorité d’entre eux leur doit d’ailleurs leur formation professionnelle.
Veillée de samaâ à Fès, organisée à Moulay Idriss par la zaouia Hérraqiya
C’est en effet dans les zaouïas de l’extase que le soufisme s’accomplit selon Mawlânâ « dans la musique, le chant et la danse ». Elles furent les gardiennent de la musique andalouse. Le lieu de prédilection reste les réunions du dhikr (remémoration) et du samaâ (oratorio). Ce sont des séances collectives de litanies et de danses extatiques. Cette tradition musicale qui remonte à l’Espagne musulmane n’a pu s’épanouir et se perpétuer que grâce aux séances du samaâ dans le cadre du soufisme populaire des confréries religieuses. En Occident musulman, la musique andalouse fut composée, selon le modèle du soufi Abou Al Hassan Al Shushtâri, de toubouâ( tempéraments) et des nûba (modes musicaux) : tab’ al dhîl, raml al mâya, asbahân, sika, mazmûm, rasd, asba’ayn etc.
Orchestre de musique andalouse de Fès
La musique andalouse a connu ses premiers développements à Fès, grâce aux apports Cordouans et Kairouanais dont les deux quartiers (rive gauche pour les premiers, droite pour les seconds) existent encore. L’influence musicale andalouse au Maghreb est en rapport direct avec les mouvements migratoires vers la rive sud, depuis le XIIème siècle, en passant par la chute de Grenade(1492), jusqu’à l’expulsion générale des Morisques et des Hornacheros en 1610. Fès accueillit ainsi sous les Mérinides, des réfugiés de Valence et sous les Wattassides, nombreux étaient ceux qui avaient rejoint Tétouan, Chefchaouen et Alger, après la chute de Grenade. Avec l’expulsion générale de 1610, un grand nombre se dirigea vers Fès et Tlemcen.
L’influence culturelle des émigrants Andalous fut considérable surtout au Maroc qui n’a pas connu de domination turc. La musique andalouse a ses racines à Bagdad, où Ziryâb fut le disciple d’ Ishâq Al-Mawsili, maître incontestable de l’école des ûdistes. Après un passage à Kairouan, la capitale de l’Ifriqiya sous les Aghlabides, il se dirigea vers Cordoue en l’an de grâce 822, où l’aristocratie arabe réserva le meilleur accueil à cet émissaire de l’esthétique orientale. Il fut le fondateur des traditions musicales de l’Espagne musulmane. Il légua à l’Andalousie, selon Ibn khaldoune , « un répertoire de chants immense qui se propagea jusqu’à la période des tawâ’if et, comme un océan, submergea Séville pour gagner ensuite les autres provinces andalouses, puis le Maghreb ».
On surnomma Ziryâb de « merle noir » parce qu’il avait diton le teint très brun :« La fluidité de son parler, ainsi que la douceur de son caractère lui valurent le surnom de Ziryâb par comparaison avec un merle noir. Même aux derniers jours de Grenade, les poètes continuaient à voir dans sa gloire un thème séduisant ».
Les deux chantres du samaâ d’Essaouira et du Maroc: Abdelhay de la zaouia kettaniya et Abdelmajid Souiri, présents à toute les cérémonies religieuses du Palais Royal
Pour al dhiki, XV ème siècle , si la musique arrive par moment à nous détacher de toute préoccupation terrestre,matérielle comme temporelle ; elle offre une plus grande liberté à l’âme pour se détacher de l’obscurité du corps.On avait l’habitude d’utiliser une fois par semaine la musique comme thérapie. Les personnes s’adonnant à la musique, remarque Ibchihi, XIVème siècle, soutiennent qu’une voie harmonieuse s’infiltre dans le corps comme le sang s’infiltre dans les veines.Abdessalam Chami nous dit à cet égard : « Si nous voulons évoquer les origines de l’art du samaâ, du début de son développement au Maroc,notre mémoire nous ramènera loin. A des siècles révolus.D’après les historiens, la tradition de fêter la nativité du Prophète où l’on chantait les qasida du madih (louages au Prophète) a pris naissance à Ceuta. C’était du temps où cette ville était dirigée par la famille al assafi. C’est à cette époque, aux environs du cinquième, sixième siècle de l’hégire qu’on avait commencé de fêter la nativité du Prophète en chantant les louanges de l’envoyé de Dieu.Après cela les sources historiques évoquent la présence du madih et du samaâ dans la Cour saâdienne : les chanteurs du madih et du samaâ faisaient partie de la fête aussi bien lors des cérémonies privées que le sultan Ahmed El Mansour Dahbi organisait dans ses palais qu’à l’occasion de la fête de la nativité du Prophète. Il y avait d’une part la chorale du madih et de l’autre celle du samaâ.L’histoire confirme la tradition. En effet, al-Ifrâni, consacreà la préparation de la nativité du Prophète sous le règne d’Ahmed El Mansour Dahbi, une description assez détaillée et assez précise : « Dés qu’on apercevait les premiers rayons de la lune de Rebia I, le souverain adressait des invitations à ceux des faqirs de l’ordre des soufis qui exerçaient les fonctions de muezzins et se dévouaient à faire les appels à la prière pendant les heures de la nuit. Ils en venaient de toutes les villes importantes du Maroc…Dés que l’aurore apparaissait, le sultan sortait du palais, faisait la prière avec la foule du peuple, puis, vêtu d’une tunique blanche emblème de la royauté, il allait prendre place sur le trône devant lequel on avait déposé tous les cierges aux couleurs variées, les uns blancs comme des statues,d’autres rouges, tous garnis d’étoffes de soie pourpre et vertes, à côté étaient rangés des flambeaux et des cassolettes d’un si beau travail qu’ils causaient l’admiration des spectateurs et émerveillaient les assistants. Cela fait, la foule était admise à pénétrer ; chacun se plaçait selon son rang, et quand tout le monde avait pris place, un prédicateur s’avançait et faisait une longue énumération des vertus du Prophète et de ses miracles. La conférence terminée, tous les assistants accomplissent les cérémonies de l’office de la Nativité, puis on voyait alors s’avancer les membres des confréries murmurant les paroles d’achchuchtûrî (maître du samaâ et célèbre soufi andalou ayant vécu au Maroc et mort en 896) et celles d’autres soufis, tandis qu’une troupe de coryphées déclamait des vers en l’honneur des deux familles (celle du Prophète et celle d’Al Mansour). » (d’après « Nozhat El Hâdî » d’Al Ifrânî).
Un des frères souiri, déclamant un mawal à Fès
On le voit ach-chuchtûrî, natif de Murcie, inventeur des mouachah et de samaâ (oratorios) chanté sur des modes musicaux andalous était déjà à l’honneur dans la Cour d’Al Mansour ! La naissance du samaâ est liée essentiellement aux confréries religieuses. C’est une composante de l’identité culturelle des médina traditionnelles où on produisait de nouvelles élégies de sorte que le corpus du samaâ n’a pas cessé de s’accroître et de se diversifier du point de vue du chant de la composition et de la poésie. Il va de soit que la musique importée d’Andalousie du temps des Almohades et particulièrement de celui des mérinides a été considéré comme le moule musical adéquat où devait se chanter toutes sortes de choses. La preuve en est qu’on a eu recourt à la musique andalouse et à ses modes musicaux pour chanter aussi bien l’art du samaâ que celui du madih ou encore du malhûn : toutes les qasida du malhûn sont chantées à travers les modes musicaux andalous.
Orchestre du malhûn de Meknès avec feu Hucein Toulali. Il avait choisi de nous chanter la qasida du coeur de Sidi Qaddour Alami comme pour conjurer le sort de la maladie et du temps qui passe : «Le silence d’une année est meilleurs qu’une parole inutile...»

On y recourt également pour déclamer le Coran à la manière marocaine. De ce fait un lien profond existe entre toutes ces formes et ces manifestations du patrimoine et la musique andalouse. La particularité qui caractérise le samaâ est qu’il recourt avec force aux modes musicaux andalous. Or quand nous menons des recherches musicologiques, dans le corpus du samaâ, nous nous rendons compte que celui-ci est plus riche. Car ce qui a été perdu dans la musique andalouse a été sauvegardé par les zaouia considérées comme le cerveau musical et son lieu de conservation jusqu’à nos jours. Les zaouia ont enrichies la musique andalouse du point de vue mélodique et rythmique tout en y ajoutant une mélodie spécifique connue sous le nom de darj. En effet, les échelles modales exécutées par la musique andalouse sont au nombre de quatre : lqaïm – nsif, labtaïhi, lqouddam et le bassît auxquelles les zaouia ont ajouté l’échelle modale de darj. Ils ont ajouté également beaucoup de chants, de textes poétiques que ce soit les qasida, les mouachahâtes, ou encore les baraouiles qui sont une spécificité de la poésie populaire marocaine.
Festival des Andalousies Atlantiques

Sous le signe de la diplomatie
Le festival a pour thème musical le Matrouz,(le brodé) genre musical judéo andalous que défini ainsi le regretté Haim Zafrani, lui-même fils de Mogador: « Dans la trame des poésies hébraïques de style traditionnel, le poète juif insère de temps à autre des strophes ou des vers de langue arabe. Cette juxtaposition, ce passage d’une langue à l’autre, c’est la réalité culturelle et linguistique du Maghreb juif. Mais ce tissu langagier, cet habit dégradé, a aussi une valeur esthétique ; il n’est pas sans évoquer l’art de la broderie, comme l’indique le nom même de ce genre poétique désigné par le terme Matrouz ou poésie brodée. Le trésor artistique des sociétés méditerranéennes modernes connaît des exemples de cette mosaïque, de ce collage non dépourvu de nostalgie, et chargé d’émotion esthétique. »

André Azoulay, conseiller Royal André Azoulay aux Carnets nomades de France Culture : «Je ne vois pas d’autres cénacles, d’autres festivals, d’autres espaces dans le monde d’aujourd’hui, où cette relation du Judaïsme avec l’Islam , en terre arabe, au Maghreb, puisse trouver cette forme et cette réalité. Essaouira, c’est ce navire amiral qui envoie en code et en lumière et en signaux tout ce qui nous manque tellement, tout ce que nous avons perdu. Cette modernité qu’Essaouira exprime est celle de cet humanisme qui était tout à fait banale ici depuis des siècles. Mais nous sommes en octobre 2010et cette humanisme a déserté nos rivages. Mais ici, il fait escale Vous avez entendu le rabbin Haïm Louk invoquer Allah, invoquer le Prophète Mohammed, c’est quasiment surréaliste pour certains. Les invoquer de la façon la plus sereine, joyeuse et tellement érudite. Alors que partout dans le monde, chez les musulmans comme chez les juifs ; on est ici sur la planète Mars. Mais quelle planète ! Quelle beauté ! Quelle chance aussi ! »

Leila Chahid, représentante de Palestine auprès de l’Union Européenne Leila Chahid aux « Carnets nomades » de France Culture : « Ce qu’on voit ici, c’est vraiment une culture commune judéo – arabe parce que nous sommes dans un lieu très spécial au Maroc ! Malheureusement ce n’est pas le cas partout, parce que toutes les villes marocaines n’ont pas connu des communautés très ancrées, très riches, très anciennes, très productrices sur le plan artistique. Mais Essaouira a toujours eu une communauté juive très ancrée dans la tradition judéo – arabe, d’une culture millénaire et très attachée à sa marocanité et très inspirée par cet esprit qui hante les enceintes et les murailles de cette ville qui vient presque avec le vent de l’atlantique ! On voit toutes ces femmes qui sont complètement couvertes par un magnifique haïk , un tissu blanc de laine, qu’elles ne mettent pas comme un tchador mais comme un voile qui les entoure, qui les protège du vent parce qu’Essaouira a cette particularité d’être un climat atlantique où le vent balaie la ville la plupart du temps de l’année sans qu’il fasse froid et ce vent l’a protégé un peu du tourisme excessif. Essaouira est une ville qui abrite beaucoup de zaouia, c’est-à-dire, de marabouts, de saints de l’Islam et du Judaïsme et a une tradition de poètes et de musiciens qui a permis à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, l’existence de beaucoup d’orchestres de musique andalouse mixtes. : Judéo – arabes ayant une tradition spécifique de chants communs qu’on appelle le matrouz qui est tissé, brodé, entre l’arabe et l’hébreu dans cette tradition marocaine. Ce qui est triste, c’est qu’avec la création de l’Etat d’Israël et le départ de la majeure partie de la communauté juive marocaine, les artistes eux – mêmes ne sont plus là pour continuer à jouer avec leurs compatriotes marocains musulmans. Il fallait une initiative comme celle d’André Azoulay des Andalousies Atlantiques pour ramener ceux qui ont perpétués cette tradition.
Hier soir nous avons assisté à quelque chose qui relève de l’ordre du miraculeux : j’ai vu des jeunes Français, dont les parents étaient juifs marocains et c’est xtraordinaire de voire ces jeunes âgés de 25 – 35 ans qui chantent en hébreux, en arabe, en espagnole d’une tradition qu’ils ont préservé. Et c’est des amateurs et qui le font par attachement à cette tradition. Je pense que c’est quelque chose qui relève d’une identité qui est réel, une réalité culturelle et artistique qui est restée un peu comme sous la peau des gens, dans leurs tripes et qui ressort lorsque l’occasion en est donnée. Il ne faut pas que cette culture disparaisse ! Je pense que la musique est la meilleure thérapie pour la douleur. Or, il y a beaucoup de douleurs aujourd’hui : il y a la douleur des palestiniens qui continuent à mourir sous l’occupation militaire assiégés à Gaza, dépossédés de leur terre, expulsés : c’est une grande douleur ! Il y a la douleur des exilés, :que ce soit les juifs exilés de leur patrie d’origine au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou ailleurs et celle des réfugiés palestiniens : moi aussi, je suis née en exile. Je pense que la musique a une fonction thérapeutique : elle met un baume sur les blessures. Elle élève les gens par la voix, par le chant, par la musique, par l’incantation…On se retrouve au niveau de l’universel parce que nous sommes avant tout des êtres humains qui devons faire face à la seule chose qui nous unit qui est la mort . Pour moi l’émotion est une forme de vérité et je pense que la musique réveille cette émotion– là. Depuis vingt ans nous vivons sous le régime de la peur de l’autre et donc je pense que de telles rencontres enrichissent le débat sur quels sont dans nos traditions, nos mémoires, les éléments qui peuvent enrichir notre avenir ? Nous sommes toujours le produit d’une stratification de plusieurs identités et je pense que l’idée qu’on est entré dans une phase où une identité s’oppose à l’autre ; c’est la peur. Il est très important de trouver le moyen d’en parler dans la sereinité. La musique comme toutes les formes d’art, la littérature aussi, est celle qui apaise le plus les passions.. Cela permet aux hommes de trouver un langage commun qu’on n’a malheureusement plus dans le monde politique. »
Abdelkader MANA

09:46 Écrit par elhajthami dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
04/06/2011
Taza la haute
T A Z A,sentinelle du Maroc Oriental
On oublie trop souvent que le minaret de Taza est l’ancêtre des tours Almohades : les formes architecturales de la Koutoubya et de Tinmel ont été élaboré dans ce sanctuaires almohades. Son minaret sobre et puissant reste le meilleur symbole de Taza. Depuis huit siècles, il monte la garde à la crête du plateau, au dessus des chemins qui mènent des plaines atlantiques aux steppes méditerranéennes et où se décida tant de fois le sort du Maroc.
épigraphie Almohad de la nef axiale la plus décorée de la grande mosquée de Taza
Taza est une des positions maîtresse, une des clefs du Maroc. C’est la sentinelle du seul couloir passant entre le Rif et le Moyen Atlas reliant le Maroc Atlantique au Maroc Oriental. La grande route commerciale, connue traditionnellement sous le nom de « Triq Sultan »(voie Royale) - passage obligé vers Fès, d’un côté et vers Tlemcen de l’autre - qu’empruntaient les pèlerins à l’allée comme au retour de la Mecque : c’est « la trouée de Taza ».. Le seul passage étroit entre les montagnes était le lit de la rivière Innaouen, qui était facile à bloquer. D’où l’intérêt stratégique de Taza sur le plan militaire. Elle pouvait obstruer le passage à l’ennemi héréditaire venant de l’Est.
Linteau de la medersa mérinide de Taza
Le linteau de la porte atteste de la splendeur de ce petit collège, qui recevait ses subsides des biens en main morte de la Qaraouiyne de Fès. Si la piété des princes mérinides se manifeste par ces collèges beaux comme des palais, c’est qu’ils en attendent une pépinière de gens efficaces pour leur gouvernement.La médersa est à la fois maison de science et asile de prière. Ce double rôle suffirait à la caractériser comme spécifiquement musulmane et médiévale. Au Maroc cette institution remonte au 13ème et 14ème siècle. On y enseigne les sciences religieuses et plus spécialement le droit qui fait partie de ces sciences. Les médersa qu’élevèrent les mérinides à Fès, Taza et Tlemcen, devaient restituer à la doctrine Malékite sa primauté compromise par l’hétérodoxie Almohade.
Taza est l’un des rares sites, où l’on peut témoigner de la continuité de la présence humaine depuis la préhistoire. Les grottes de Taza étaient habité dés l’époque néolithique, comme l’attestent les fouilles de la caverne de Kifan El Ghomari : Ces fouilles ont mis à jour, les vestiges d’une faune aujourd’hui disparue : lion, panthère, ours, rhinocéros, buffle antique, mouflon, gazelle, chameau…. Des ossements d’animaux et d’homo sapiens fossile ainsi que des silex taillés, et des pointes de flèches.
Citadelle islamique aux ruelles plus larges et moins labyrinthique que celles de Fès, et moins grouillante que celles de Marrakech, telle paraît Taza au visiteur. C’est la plus jolie ville du Maroc, à en croire Ali Bey qui la traversa en 1805 :
« Les ruelles sont belles, les maisons en bon état » et peintes à la chaux comme Chefchaouen. Lieu de fixité millénaire, retraite pour ermites et nécropole, elle est évoquée en ces termes par un vieux rabbin de Taza : « Nous regrettons surtout d’avoir été forcés d’abandonner les tombeaux de nos saints ancêtres. N’est – ce pas dans les grottes de Taza que nous avions l’habitude d’implorer la grâce divine en cas de malheurs publics. »
Marqueterie du minbar de la grande mosquée de Taza
Détails du minbar
Le minbar de la grande mosquée de Taza est fait d’une marqueterie ornée de fines baguettes d’ivoire et de bois précieux,. Aujourd’hui bien mutilé, seules ses façades latérales permettent de juger de l’œuvre ancienne qui se déploie en entrelacs. On est tenté de croire que ce type de chaire est le résultat d’une évolution commencée au 12ème siècle. On se trouve là face au minbar Almohade réparé au 13ème siècle par le Sultan mérinide Abou Yaqoub qui en dota la mosquée agrandie par ses soins.
Lorsque l’Islam s’implanta donc au Maroc, Taza avait déjà un long passé : elle était à tout le moins l’Agadir et la nécropole d’une tribu ou d’un groupe de tribus berbères. La seule chose sûre est que Taza est antérieure à l’islamisation du pays, soit à l’an 800. Elle existait déjà lors qu’Idris 1er s’installa dans le Maroc du Nord : il passa à Taza peu avant sa mort, en 790. Tous les historiens musulmans s’accordent à dire qu’à l’emplacement de Taza, il y eut d’abord un Ribat. D’après Ibn Khaldoun, ce Ribat, sorte de forteresse frontière occupée par les volontaires de la foi, a été fondé par les Meknassa du Nord, sous le règne d’Idriss 1er (788-803) qui islamisa les Ghiata et autres tribus berbères de la région de Taza.
C'est de Tinmel dans le haut Atlas que les Almohad se sont lancés à la conquête de l'Andalousie et du Maghreb, en bâtissant sur leur passage la sentinelle de taza, là même où s'élevait un vieux ribât dévolu au jihad et à la guerre sainte
C’est de Tinmel que les Almohades se sont lancés à la conquête de l’Andalousie et du Maghreb, à travers Taza leur seconde étape. Parti de Tinmel, l’armée d’ Abdelmou’mîn déboucha à travers le Haut et le Moyen Atlas sur Taza, qui devint son point d’appui pour sa campagne au Maghreb Central – toujours tenu par les Almoravides. Après la défaite de ces derniers près de Tlemcen, Tachfin l’Almoravide, au cours d’une marche nocturne, tomba du haut d’une falaise avec son cheval. C’est la première fois depuis longtemps, peut – être depuis toujours, que le Maghreb connaît l’unité politique sous des chefs issus de son sol. Et cette unification est l’œuvre de montagnards sédentaires. Le pouvoir du premier souverain Almohade s’étendait ainsi, depuis l’Îfriqiya jusqu’à l’Andalousie. Il régnait sur tous les grands centres de civilisation, et laissa à son fils un vaste empire qui comprenait tout le Maghreb et la majeure partie de l’Espagne musulmane.
Les travaux de Taza auraient été ordonnés par Abdelmoumen en 1135. Les murailles furent complétées en 1172 au voisinage de la tour sarrasine. Un siècle plus tard, vers 1249, le Mérinide Abou Yahya, s’empara de Taza après quatre mois de siège et fit remettre les fortifications en état.
La première moitié du 12ème siècle fut, dans l’histoire de la fortification marocaine, un moment décisif. Le pisé se substitua à la pierre, il paraît sous les Almoravides, il triomphe peu à peu sous les Almohades. Il semble que c’est une technique ancienne chez les montagnards de l’Atlas, qui savaient encore construire des ksours en cette matière.
Partant de la nouvelle ville, on remonte par des escalier, la pente raide jusqu'à Baba Jamaâ qui donne accès au vieux Taza du haut
Bab Jamaâ(la porte du souk du vendredi) est la principale porte d'accès à Taza la haute.Mais il existe d'autres portes aussi célèbres tel Bab Rih(la porte du vent) ou Bab zitoun(la porte de l'olivier) Taza est célèbre pour la qualité de son huile d'olive sans acide introduit dans ces parages depuis les almohades
Ces murs de pierres s’accompagnent de tours rondes : tel se présente le mur de pierre de Taza. Il impose la tour massive des remparts Almohades et Mérinides. L’aspect de la fortification maghrébine s’en trouva fixé pour des siècles. Si les remparts Almoravides de Marrakech sont déjà en pisé, on les retrouve sous les Almohades avec les murailles qui couronnent le sommet rocheux de Taza. L’enceinte enveloppante, était selon les chroniqueurs, tel le halo encerclant la lune. Construits partie en pierres, partie en pisé, les remparts ne sont pas homogènes et appartiennent à des époques différentes.
Le bastion élevé par les Saâdiens pour contrer le péril Turc qui menacait aux confins Est du maroc
Dans l’ensemble imposant que forment les fortifications de Taza du côté de l’Orient, une forteresse quadrangulaire attire immédiatement le regard, tant par sa masse que par sa disposition architecturale, Cette forteresse, encore aujourd’hui, appelée du vieux nom d’El Bastioun, est en effet la partie la plus intéressante de l’ancien système défensif. C’est le point fort de la place, le centre de résistance où converge tout le système des murs. C’est sur le Bastioun que repose toute la défense de Taza. Le reste de la citadelle, ville et kasbah, prisent, il pouvait encore continuer de résister. La lourde forteresse devenait en quelque sorte le pivot de la défense marocaine contre l’ennemi héréditaire de l’est.
A l’avènement d’Ahmed El Mansour, son premier acte fut de se poser , dès le début, en adversaire des Turcs. Or la place forte dont la situation nécessitait le plus impérieusement un armement défensif puissant était Taza. C’est à elle qu’el Mansour devait songer tout d’abord, puisqu’il voulait fermer la porte aux Turcs. C’est donc à ce moment qu’eut lieu semble – t – il la restauration des remparts de Taza, et leur adaptation aux nouvelles conditions de la guerre de siège, auxquelles répondait le Bastioun. On fixe vers le milieu du 16ème siècle, la date où fut construit le Bastioun
Le mausolée de Si El Haj Ali Ben Bari est le plus considérable de la plaine des tombeaux de Taza. L’édifice d’époque Mérinide, se situe au dessus de « Triq Sultan » qui, sortait de la ville. Sur le mur de l’édifice religieux, un panneau porte cette inscription relative à la vie du saint : « Ceci est le Mausolée du Docteur Abou El Hassan Ali Ibn Bari Et- Tsouli Et- Tazi, » Si on se rapporte à l’Encyclopédie de l’Islam :
Ibn Barri, naquit vers 1262 à Taza, et qu’il est surtout connu par ses Dourar. C’est au méchouar que se situe la medersa mérinide, dont Abou El Hassan Ali dota la ville.
Au pied du minaret, la chambre du mouwaqqit qui sert de bibliothèque de la grande mosquée depuis les mérinides. On y trouve un manuscrit du Coran qui remonte au règne Saâdien d’Ahmed El Mansour Dahbi à qui on doit la fortification connue sous le nom du Bastioun à Taza. Manuscrit magnifique sur du papier remarquablement calligraphié et enluminé avec des double pages dorées(à la fin et au commencement).
Enliminures Royales léguées en main morte à la bibliothèque de la grande mosquée de Taza
"kitab chifa", le livre de la guérison du Qadi Ayad, légué par Ahmed Al Mansour Dahbi à la bibliothèque fondée par Abou Inan, le grand sultan Mérinide
Les chambres de mouwaqqit n’apparaissent au Maroc qu’au 13ème siècle. Malgré les remaniements qu’elle a subi, celle-ci semble bien être de fondation mérinide. On y trouve ainsi «Kitab Chifaâ »( le livre de la guérison) du Qadi Ayad, en sa page de garde le seau d’Abou Înan le mérinide léguant ce manuscrit en main morte à la grande mosquée de Taza .
Ce qui reste le long des frises, du style décoratif almohade se caractérise par des formes géométriques sobres aux lignes épurées et fermes comme ce fut le cas à la mosquée de Tinmel.
Le style décoratif sobre de la grande mosquée de Taza, inspiré du modèle de la mosquée Almohad de TinmelComme à Tinmel, la mosquée Almohade était à neuf nefs réparties d’une manière symétrique. Harmonieuse combinaison d’anciennes traditions hispano – mauresques, et d’éléments nouveaux venus d’Orient.
Abdelmou’mîne qui construisit Taza, jeta les premiers fondements des mosquées Almohades. Celle de Taza est antérieure à la Koutoubiya puisqu’elle fut commencée dés 1135, et constitue ainsi « le prototype même de toutes les mosquées Almohades. » Nous dit Henri Terrasse.
La nef axiale reste suivant la tradition almohade, plus décorée que les nefs communes. C’est bien entendu au mihrab que se trouvent les plus riches décors de toute la mosquée. Ainsi,à la grande mosquée de Taza, la hiérarchie du décor reste dans la tradition almohade. Nulle part qu’à la grande mosquée de Taza on ne peut juger des caractères généraux et des tendances du décor du 13ème siècle. Malgré les progrès de la géométrie et de l’épigraphie le décor de la grande mosquée de Taza reste avant tout floral. Il donne une importance nouvelle à la géométrie et à l’épigraphie. Tel se présente la mosquée de Taza, chef d’œuvre de logique et de grâce solide, derrière lequel on sent vibrer l’âme d’un architecte de génie. L’agrandissement mérinide n’a fait qu’accroître la profondeur de la salle de prière. Et ce vaste oratoire, aux longues perspectives, tout noyé de pénombre malgré sa blancheur, est d’une beauté ferme et grave.
Le grand lustre souligne la dignité éminente de la nef axiale. Dés sa construction, il fut célèbre. L’historiographie mérinide fait l’éloge de cette œuvre exceptionnelle de la bronzerie musulmane. Aucun lustre orné de cette taille n’a été signalé en Orient.
Les grandes cours des mosquées anciennes d’Espagne et du Maghreb furent très souvent plantées d’arbres. Le Sahn el Kébirde Taza perpétuait magnifiquement cette tradition. Les historiens nous apprennent qu’Abou Rebia y fut inhumé et la pierre tombale de ce sultan s’y voyait encore en 1923.
Le style des arcs, les motifs et les teintes des zellijs, la silhouette de la grande fontaine ne permettent pas de faire remonter ces aménagements au-delà de Moulay Rachid : on croirait volantier que ce fut ce premier souverain Alaouite qui donna au Sahn el Kébir son ordonnance actuelle. Cette immense cour baignée de soleil avec ses magnifiques figuiers est d’une poésie prenante.
La vue des toits est aussi belle que celle des grandes mosquées du 12ème siècle. .Le Jamaâ El Kébir, la grande mosquée de TAZA, à laquelle ont déjà travaillé les Almohades, est agrandie par les Mérinides, les travaux étant terminés en 1294.Une inscription, en zellij noir, contigu à la Qibla, date les réparations et agrandissement que fit faire le Sultan Mérinide . On y lit :
« Abû Ya’qûb, ordonna d’agrandir la mosquée par quatre nefs du côté de la Qibla et deux nefs, une orientale et une occidentale, ainsi que le Sahn qui est à l’Est de cette mosquée, car toutes ces parties étaient sur le point de s’écrouler. Commencés le 4 mars 1291, les travaux finirent le 29 octobre 1292. »
Les Almohades ont crée une véritable civilisation, et ne se sont pas contenté, de se faire les agents de diffusion de la civilisation Andalouse. Civilisation austère et énergique où les forteresses et les mosquées l’emportent sur les palais et les jardins, mais dont l’originalité et la grandeur ne sont pas contestables.
À l’occasion du retour du pèlerinage de la Mecque, des séances de « Samaâ » sont animées, chez des particuliers à Taza. Et c’est à la tête de quatre cent pèlerins que de retour de la Mecque est mort, le 6 octobre 1269, Ali Shushtouri le grand mystique andalou qui marqua de son passage le Ribât de Taza. Cette sentinelle du Maroc oriental, était en liaison directe avec l’Andalousie via Sebta.: les poètes et mystiques andalous du 14ème siècle passaient par Taza pour se rendre à Tlemcen, à Bougie ou à Oran. C’est lors d’un séjour à Taza que le célèbre vizir Grenadin Lissân Eddin Ibn El Khatib avait appris le décès de sa mère en Andalousie.
La position de la médina de Taza, comme couloir de passage entre l’Est et l’Ouest du Maghreb, en faisait une étape où s’arrêtaient des personnages de renommée en provenance d’Andalousie comme Lissan Eddin Ibn El Khatib, le célèbre vizir et poète Grenadin. Il y est venu d’Andalousie avec ses coutumes, ses traditions et sa culture. On se souvient également du célèbre séjour d’Ibn Battouta, lors de son retour de Chine. Il existe encore une ruelle à Taza qui porte métaphoriquement son nom : c’est « Derb Cinî »(la ruelle du Chinois) . Comme Ibn Batouta était arrivé à Taza de Chine, la ruelle où il séjourna fut baptisée « ruelle du Chinois » .
Ce sont les confréries religieuses qui ont contribué à la sauvegarde ce patrimoine musical et littéraire andalou au Maghreb. Ces confréries allaient maintenir en vie une tradition musicale et poétique dans le cadre de leurs cérémonies, comme on le voit à Sidi Azzouz, où on chante la borda de Bossiri. Personne ne connaît la période où avait vécu Sidi Azzouz, le saint patron de la ville, dont on dit qu’il aurait un parent enterré en Tunisie comme d’ailleurs le mystique marocain des Ghomara Abou El Hassan Chadili. L’artisan qui a peint la barchla de sa coupole a daté son œuvre du 3 ramadan 809 de l’hégire, soit le 2 novembre 1407.
Taza, vendredi 26 nov. 2010:L’année dernière vers le coup de 13h, le sanctuaire de Sidi Azzouz, le saint patron de la ville, où nous avions enregistré une séance de samaâ en 2006 pour la série documentaire « la musique dans la vie », était dévoré par les flammes. Le ministère des habous et des affaires islamiques, qui a affecté un budget pour sa restauration n’avait plus aucune trace ni d’images du toit peint du sanctuaire. Le seul document dont les maâlem barchliya (peintres sur bois) disposaient pour restaurer à l’identique le toit peint disparu est le documentaire « Taza sentinelle du Maroc Oriental » dont j’ai supervisé pour le compte de la deuxième chaîne en 2006 ! Le chantre du samaâ local, M.Hamid Slimani qui me rapporte cette anecdote ajoute : « S’il n’y avait pas ton documentaire ; ils n’auraient pas été en mesure de restaurer la coupole en lui restituant sa décoration initiale !
À Taza, les associations dévolues au samaâ œuvrent également pour l’épanouissement de la musique andalouse. Et cela d’autant plus que cette vieille médina maghrébine se prévaut d’une grande tradition dans ce domaine. Parmi les grands noms Tazis de la musique andalouse on peut citer entre autres, maître Haj Ahmed Labzour Tazi, mûnshid et joueur de Rebab qualifié. Il se distingua par sa contribution à l’enregistrement de l’intégralité du répertoire de la Ala, avec le concours de l’UNESCO, et par une tentative sérieuse de transcription, souligne Ahmed Guettat dans son monumental ouvrage intitulé « empreinte du Maghreb sur la musique arabo – andalouse ». Parmi les autres grands noms figure celui de feu Abdessalam Lbrihi, ce natif de Taza qui se trouve parmi les auteurs ayant contribué au recueil du Haïk qui fut publié sous les règnes de Hassan Ier et de Moulay Abdelaziz. C’est d’ailleurs son fils Mohamed Lbrihi qui fonda, au tout début du XXe siècle, la première association de musique andalouse qui allait contribuer, d’une manière décisive, à la préservation de ce legs andalou au Maroc. Cet originaire de Taza, comme le mentionne un dahir de Moulay Abdelaziz, était devenu chanteur de Cour (moutrib al qasr). Il est mort en 1945. Il avait formé à la ala andalouse toute une génération de musiciens de Fès, à commencer par le plus fameux d’entre eux, El Hajj Abdelkrim Raïs. Les plus grands ténors de la musique andalouse ont donc été formés par un homme originaire de Taza. L’association qu’il avait fondée est actuellement présidée par son gendre Anas El Attar.
Mrs. Mohamed Belhissi, homme de théâtre et Hamid Slimani, chef d'orchestre du samaâ, actuellement les principaux animateurs de la vie culturelle Tazie..
L’un des grands noms du malhûn à Taza est le poète Mohamed Belghiti surnommé Btigua. Ce dernier animait régulièrement des soirées de ce genre poétique et musical à Fès et, dit-on, il connaissait par cœur quelque quatre cents qasidas, dont celle qui évoque la mort du Prophète ou encore « haoul lqiyama », le jour de la résurrection. Il avait composé des qasidas sur Taza dont l’une énumère les saints de la ville. C’est au cours de ces soirées qu’il organisait dans les Riad de Fès qu’il présentait ses nouvelles créations en matière de qasidas chantées du genre malhûn. Autre chantre du malhûn tazi, Belaïd Soussi, l’auteur de la qasida du ferran (le four public) et de cette chanson qui connaît encore un grand succès populaire (et que chante Mohamed El Asri) et qui a pour refrain :
Allah y l’ghadi l’Sahra jib li ghzal !
Ô toi qui t’en vas au Sahara, ramène-moi une gazelle !
Autre succès de cet auteur tazi « lgaâda f’jnan sbil » (villégiature au jardin de Jnan Sbil de Fès) et « Ya man bgha zine » (ô toi qui désires la beauté !). C’est encore lui qui avait composé cette chanson nationaliste à l’occasion du retour de Mohamed V de son exil de Madagascar :
Saâdi ziyant ayâmi, mahboub khatri jani !
Heureux sont mes jours, mon bien-aimé est arrivé !
Il avait également composé des chansons pour des vedettes de la chanson marocaine tel Fath Allah Lamghari. Taza faisait partie des vieilles cités marocaines, telles Salé, Safi et Meknès qui produisaient du malhûn. Mais elle ne dispose pas actuellement d’un orchestre de malhûn déplore M. Hamid Slimani. Pourtant les habitants de Taza restent encore attachés au malhûn. Certains musiciens font, de temps en temps, quelques tentatives pour faire revivre le malhûn. On entend donc du malhûn exécuté par les orchestres qui animent les fêtes de mariage, mais il n’existe pas d’orchestre spécialisé dans le malhûn proprement dit.
De par sa position entre Tlemcen et Fès, Taza est l’un des terreaux les plus fertiles au Maroc en matière de samaâ , un art du chant déclamé suivant les modes musicaux andalous, fondé sur la déclamation, les prières et les qasida mystiques. Parmi les grands noms Tazis de la musique andalouse on cite, entre autres, maître Haj Ahmed Labzour Tazi, mûnshid et joueur de Ribab qualifié. Il se distingua par sa contribution à l’enregistrement de l’intégralité du répertoire de la Ala, avec le concours de l’UNESCO, et par une tentative sérieuse de transcription, comme le souligne Ahmed Guettat dans son monumental ouvrage intitulé « empreinte du Maghreb sur la musique arabo – andalouse » .
. Henri Terrasse a insisté à juste titre sur la part prépondérante de l’influence andalouse à Taza. D’où les monuments, d’où une certaine floraison littéraire où domine le poète et historien andalou Ibn El Khatib. Taza, était en liaison directe avec l’Andalousie via Sebta.: les poètes et mystiques andalous du 14èmesiècle passaient par Taza pour se rendre à Tlemcen, à Bougie ou à Oran. C’est lors d’un séjour à Taza que le célèbre vizir Grenadin Lissân Eddin Ibn El Khatib avait appris le décès de sa mère en Andalousie. Le grenadin Lissân Eddin Ibn El Khatib y composa una qasida où il est dit :
Taza le célèbre pays
Pays où les jardins reverdissent
Pays où l’air est bon, où l’eau est abondante
Pays où la beauté est resplendissante…
Poète mystique andalou, né à Cadix vers 1203, ayant d'abord vécu au Maroc, avant de voyager en Orient, c’est à la tête de quatre cent pèlerins que de retour de la Mecque est mort ,le 6 octobre 1269, Ibn El Hassan Shoushtouri , le grand mystique andalou qui marqua de son passage le Ribât de Taza. Ce fut un des grands Washâh mystiques, qui parcourait les marchés et les foires en s’accompagnant d’un instrument en chantant ses Mouwashahâtes andalouses :
« Un cheikh du pays de Meknès
A travers les souks va chantant
En quoi les hommes ont-ils à faire avec moi
En quoi ai-je à faire avec eux ?... »
Lors de l’un de ses voyages d’Andalousie au pays d’Algérie, au milieu du sixième siècle de l’hégire, ce grand poète soufi – maître du Samaâ’ et grand pôle mystique -, est passé par Taza , en tant que lieu de transit reliant l’Orient à l’Occident musulman. Il se rendait alors à Bougie où résidait le grand mystique Ibn Sabaâïn. Il est passé par la ville qui l’a séduite, et où il composa ce poème :
J’ai porté la coupe
A l’ombre apaisantes de jardins
Ce fut dans une citadelle à l’Est de Fès
Douce était ma joie, vifs mes souvenirs
Au point que j’en oublie les miens
J’ai quitté la patrie pour la demeure des biens aimés
Où on m’a servi la coupe divine.
Ce qui reste de Shoshtari, comme des maîtres spirituels qui lui ont succéder depuis, c'est cette actualisation poignante de l'instant, où ils veulent nous faire rejoindre l'éternel. « L'instant est une coquille de nacre close ; quand les vagues l'auront jetée sur la grève de l'éternité, ses valves s'ouvriront ». Il n'en disait pas davantage pour laisser comprendre qu'alors on verra dans quelles coquilles les instants passés avec Dieu ont engendré la Perle de l'Union. Ce à quoi fait échos Niyazi Misri, poète mystique turc du 17ème siècle :« Après avoir voguer sur la mer de l'esprit dans la barque matérielle de mon corps, J'ai habité le palais de ce corps, qu'il soit renversé et détruit ; »
Oui, l'instant est une coquille de nacre close ; quand les vagues l'auront jeté sur la grève de l'éternité, ses valves s'ouvriront. Cette dimension mystique imprègne encore aujourd’hui la vieille médina de Taza, où les pèlerins de retour de la Mecque sont encore accueillis par le samaâ qu’y légua, il y a des siècles de cela le grand maître andalous du chant soufi.
En dehors de la médina, il n’y avait que des vergers, et des cimetières .La citadelle continuait à dominer de ses remparts la campagne alentour.On trouve dans Kitab El Istibcar une description curieuse de la ville dans la deuxième moitié du 13ème siècle. Elle est établie au milieu de grandes montagnes d’accès difficile ; les figuiers, la vigne, les arbres fruitiers de toutes espèces et le noyer y abondent. Les habitants sont des berbères Ghiata : « c’est une grande ville, située sur le flanc d’une montagne, et qui domine des plaines traversées par des ruisseaux d’eau douce ; elle est protégée par un rempart considérable de pierres jointes au mortier, et la durée en est assurée. » Ribat-Taza qui se trouve sur la route menant d’occident en orient, est aussi appelée Taza.- Ez-Zaïtoun, en raison de l’abondance de l’olivier..Taza atteste la grande extension de la culture méditerranéenne de l’olivier qui remonte ici au temps du lime romain. Des silos creusés dans la médina recelaient des provisions de grain qui devenaient précieuses en cas de blocus. On y cultivait des vergers, des réservoirs y accueillaient des eaux de la hauteur en provenance Ras El Ma. La ville recevait en temps normal l’eau d’une seguia descendant des montagnes, alimenté par une dérivation de l’Oued Taza. En cas d’hostilités avec les tribus montagnardes, le premier soin de celles – ci été de couper la seguia , afin de priver d’eau la ville[1] : les Ghiata n’y ont point manqué jusqu’au début du 20ème siècle. C’était une chose à laquelle Taza devait s’attendre fatalement à chaque siège. C’est d’ailleurs pour la délivrer du blocus des Ghiata, que Hassan 1er s’était rendu à Taza en 1874.En dépit de la barrière du Rif, le Taza du haut est une citadelle méditerranéenne par excellence du fait même de son histoire et de sa culture. Au pied de son éperon, le Taza du bas, la ville nouvelle, ne cesse de s’étendre sur ce qui fut jadis des jardins et des vergers.Abdelkader Mana
19:10 Écrit par elhajthami dans Histoire, Le couloir de Taza, Pèlerinages circulaires en Méditerranée | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : histoire, le couloir de taza |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
03/06/2011
Naissance d’un festival
Gnaoua et musiques du Monde

Le fait qu’Essaouira avait été jadis un port de transit, où avec les marchandises les musiques sont venues d’ailleurs fait d’elle une ville – carrefour avec comme principal apport la musique des gnaoua comme le souligne l’historien Jean Louis Miège, spécialistes des relations entre le Maroc et l’Europe au 18ème et 19ème siècle :

Parmi les personnalité de marque au colloque de musicologie de ce festival figure Mme Viviana Pacques qui a longuement vécu et étudié les Gnaoua à Tamsloht et qui est l’auteur de deux ouvrages de référence sur la question- « l’arbre cosmique » et « la religion des esclave »- nous déclare à ce propos :
« Il y a deux fêtes indispensables pour les gnaoua : ce sont les fêtes de Chaâban et celles du Mouloud. Au mois de Chaâban cela se passe dans la maison de la moqadma qui refait ses autels, sa mida et sa nourriture. Et au Mouloud, le moussem se passe à Tamsloht. Rien ne s’exprime par le langage ou presque rien. Les chants ont peu d’importance. Tout est expliqué par une sorte de métalangage qui est fait des objets rituels qui apparaissent ou reviennent à un certain moment précis. Tout est un code : les pas de danse, la cadence de la musique, l’ordre du déroulement de la lila. Tout est codé. Tout est significatif, dans les moindres détails ».
Au trois religions monothéistes s’est ajouté l’animisme africain venu d’Afrique subsaharienne dont sont issus les deux principales familles de la confrérie des gnaoua d’Essaouira : Les Gbani de Bamako et les Guinéa de Tombouctou et de Dakar au Sénégal comme nous l’explique maâlem Mahmoud Guinéa :


Georges Lapassade est le premier à découvrir en 1967, les Gnaoua d'Essaouira dés la période hippie en campagnie du living theater. Il valorisa leur rituel et leur musique en reconnaissant sa parenté avec le Jazz. On le voit ici en campagnie de maâlem hayat : photo prise en 1978, il est pour ainsi dire le père spirituel de ce festival et du colloque demusicologie qui l'accompagne
Lorsque le living theater quitte Essaouira en septembre 1969, Abderrahman Qirrouj, marqueteur d’Essaouira et maâlem gnaoui est devenu Paka , joueur de gunbri dans le célèbre mouvement folk marocain. Sa carrière folk commence par son entrée au groupe de Jil Jilala, avant d’être consacrée par son entrée dans le groupe de nass el ghiwan . Il avait déjà participé à des veillées musicales avec Jimmy Hendrix autres Jazz – man de passage par la plage de borj el baroud. Paka qui les a écouté adoptera désormais une tignasse et une tenue hippie à chaque fois qu’il montera sur scène en compagnie de nass el ghiwan. Il a pu ainsi découvrir, la possibilité et en même temps, la nécessité caractéristique du Jazz d’improviser et de moduler sur la base d’une trame traditionnelle. Le Jazz, c’est essentiellement, cette libération qui se réalise à partir d’une tradition. En se libérant, le musicien traditionnel devient créateur. Il suffit d’écouter Paka interpréter un thème gnaoui pour comprendre cette alchimie musicale où le guenbri accompagne tantôt des quatrains du Majdoub , tantôt le chant sacré.
Le succès fulgurant de ce festival auprès de la jeunesse, tient à la fusion qu’il opère entre les groupes des gnaoua du Maroc, et les musiques afro-américaines : c’est la musique des gnaoua a les mêmes racines que le Jazz ou le Reggae avec lesquels elle fusionne à merveille ! Et c’est ce que nous explique Mahmoud Guinéa qui participe à ce festival : « La musique gnaoua et celle du Jazz ont la même origine africaine. C’est pourquoi, ces deux musiques fusionnent sans problème. Nous avons joué avec plusieurs groupes étrangers : celui de Carlos Santana à Casablanca, celui de Peter Grossman et de hamid Dreik en Allemagne. J’ai joué avec beaucoup de musiciens à l’étranger. J’ai joué avec un batteur du tabla indien. Un espagnol qui a vécu quinze ans en Indonésie. C’est là qu’il avait appris le tabla auprès d’un maître. Il est venu à Essaouira et nous avons produit une cassette ensemBle. J’ai joué aussi avec la cithare indienne au sein du groupe folk des « mchaheb » (rayons de soleil) ».
Sur une même scène , le guenbri et les crotales traditionnelles d’une part, la guitare, le synthé, la flûte et la voix humaine expérimentée comme instrument de musique d’autre part. Si ce mariage entre musique rituelle et pop – music semble réussir , c’est bien parce que les deux genres musicaux puisent à la même source rythmique. Celle de la diaspora noire. Comme les gnaoua, la pop – music a aussi des origines noires : le Jazz , cette musique de déportation noire en Amérique. Les gnaoua et la pop – music fonctionnent sur le même registre, les mêmes pulsations musicales, le même art de l’improvisation ; celui de l’homme noir. C’est là, me semble – t- il, la raison profonde de cette parfaite harmonie entre le négro – spirituel gnaoua et la pop – music.
Cette fusion musicale entre les gnaoua et les musiques du monde fut magistralement illustrée quand la chanteuse irano – américaine, Susan Dayhim est montée sur scène, en utilisant sa voix comme instrument de musique : « Je fais beaucoup de choses avec ma voix, nous déclare-t-elle. C’est moi qui travaille avec les gnaoua, pas eux qui jouent avec moi : eux ils font la musique et moi je cherche comment je peux ajouter quelque chose avec ma voix. Tout le monde est engagé quand la musique prend. Il n’y a ni maître ni esclaves. Il y a cette harmonie cosmique : cette connexion est le vrai sens de la musique. Là haut où tout s’arrête, le temps, l’espace et on entre dans l’abandon de la transe. J’ai écouté ce qui se passait sur scène. J’ai essayé de penser mélodiquement à des choses différentes. A comment ma voix peut se mélanger mélodiquement, rythmiquement avec les gnaoua. »


La confrérie des gnaoua dont la principale zaouïa se trouve à Essaouira n’est pas sectaire. Et c’est cette ouverture sur l’autre qui lui a permis de s’ouvrir sur la modernité voir d’y trouver même une nouvelle raison d’être. La clientèle des gnaoua n’est plus seulement locale : à peine le festival terminé que maâlem Guiroug est déjà sollicité avec sa troupe pour se rendre à Londres pour y animer des soirées musicales.
Pour Steve Shehan qui a élu domicile au village de Ghazoua, non loin d’Essaouira ; au Maroc, on ressent les influences qui sont venues enrichir un patrimoine en permanente évolution :
« C’est pas quelque chose de figé. C’est cela que j’aime au Maroc. On en a la preuve avec ce festival. Essaouira, c’est une histoire de cœur. Cela fait vingt ans que je viens ici :j’ai la chance d’y habiter souvent et j’habite encore à Ghazoua à sept kilomètres d’Essaouira. Il y a un charme. Une fois de plus on sent l’apport des autres cultures : les portugais, la mer, le vent. Il y a une douceur de vie dans les haïks des femmes, une poésie. Vraiment, je fonds quand je vois ce qui m’attire et ce qui m’inspire. On va tous rentrer chez nous, voyager, mais avec une inspiration renouvelée, avec une envie nouvelle, une envie de revenir ici. Je vois d’autres amis qui ont été totalement envoûtés. Ça ne vous donne qu’une envie, celle d’aller plus loin , donc de revoir les gnaoua. Certains vont se mettre au hajhouj , au guenbri, c’est cela qui est intéressant : provoquer d’une part la curiosité et d’autre part aller plus loin dans la création ».
Ce métissage entre musiques de noires marocains avec la world music obéit ici au même au même processus de fascination pour la rythmique africaine, sous-jacente à d’autres mouvements musicaux que la jeunesse a connu ces trente dernières années au niveau mondial tel le Reggae, le Rock ou le Rap : toute cette culture musicale de la jeunesse a pour dénominateur commun, la présence d’une forte composante négro – africaine. Avec ce festival, le carnaval de jadis, qu’on croyait mort à jamais , ressuscite avec ses feux de joie et ses éclats de couleurs, d’une manière à la fois théâtrale et grandiose. A la confluence des racines africaines et des influences andalouses, Essaouira, s’adresse désormais au monde. Abdelkader Mana
13:39 Écrit par elhajthami dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
02/06/2011
Parcours immobile
Edmond Amran El Maleh
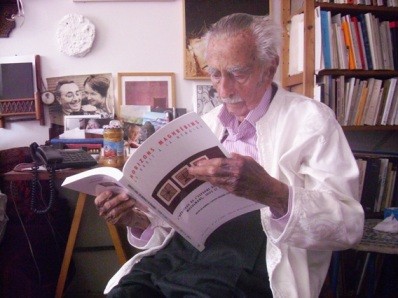
Comme le pêcheur à la ligne va à la rencontre des insondables abysses bleus , l'être est en quête naturel d'absolu. Je me souviens que lors du débat sur le chant sacré, au colloque de musicologie d’Essaouira, en 1980, c’était surtout les notions de Dhikr et de hal qui faisaient réagir Edmond Amran El Maleh. Le Dhikr, c’est la mention incessante de Dieu, l'oubli de tout ce qui n'est pas Dieu : « Remémores (udhkur) ton Seigneur quand tu auras oublié. ». Et selon Ibn Âta' Allah « le Dhikr est un feu. S'il entre dans une demeure, il dit : c'est moi, non un autre ! S'il y trouve du bois, il le brûle, s'il y trouve des ténèbres, il les change en lumière ; s'il y trouve de la lumière, il y met lumière sur lumière ». Le thème de la lumière est une des constantes de l'enseignement soufi. C'est elle qui pénètre dans les cœurs qui s'ouvrent à Dieu. Elle se présente chaque fois comme une force spirituelle, un appel à la vie intérieur. Hallaj écrit :« L'aurore que j'aime se lève la nuit, resplendissante, et n'aura pas de couchant ».La « Laylat el Hajr » de Hallaj paraissant viser la nuit de l'esprit, sous d'autres symboles : l'oiseau aux ailes coupées, le papillon qui se brûle, le cœur enivré de douleur, qui reçoit.
L’autre concept mystique qui intéressait particulièrement El Maleh est celui du « hal » (état spirituel). Cette quête de purification du cœur qui relie les étapes à chacun des horizons. Ces diverses étapes de la voie soufie, qu’on appelle Ahouwal sont sensées conduire au dévoilement progressif et à la purification des coeurs. Le but ultime de ce voyage à la fois réel et symbolique est de préparer l'âme à l'union divine… Les soufis ont insisté sur cet aspect de purification des cœurs et des âmes, pour consolider les valeurs de tolérance, d'amour et de miséricorde.
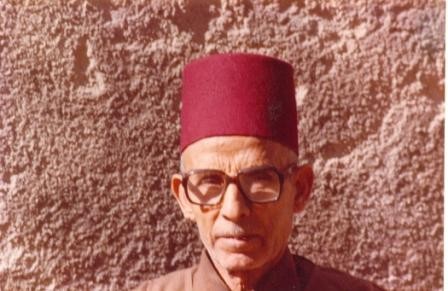
Mon père
Un jour je rencontre Edmond Amran El Maleh en plein centre ville et je l’invite à une lecture d’un passage de mon journal de route, qui porte sur la nuit des Oulad Bouchta Regragui. Une nuit de transe et de flamme. Une fois la lecture terminée, je me souviens que l’auteur de « parcours immobile » n’avait pas émis de commentaires sur la valeur littéraire de mon texte comme je l’espérais... Mon père qui était venu nous rejoindre pour le thé raconta à notre invité d’honneur cette anecdote:
« Pour se rendre d’Essaouira à Marrakech un négociant juif a demandé au pacha de la ville de lui désigner un mokhazni (agent du Makhzen), pour l’accompagner. Il fallait alors trois jours à dos de mulet pour parcourir la distance qui sépare Marrakech d’Essaouira, son avant-port. Le mokhazni se présente alors au magasin du négociant juif et l’interpelle sur un ton brutal :
- Je viens de la part du pacha : quant est-ce que nous irons à Marrakech ? !
Le négociant lui rétorque alors :
- Vas dire au pacha que le voyage est reporté.
Le pacha ayant compris que le « report » est plutôt dû à l’indélicatesse dudit mokhazni, en désigna un autre réputé pour son tact et son savoir – vivre. Ce dernier se rendit d’abord chez lui, mit son plus beau burnous et se parfuma de musc. Une fois arrivé chez le négociant, il le désigna par ses triples qualités :
- Salut Monsieur le Consul, le Négociant, et le Rabbin…
Ce dernier se retourna alors vers l’assistance en lui disant :
- Avez-vous vu l’incarnation même de la politesse ? Prépares-toi au voyage, on prendra la route très tôt demain matin… ».
L’anecdote concernait le propre grand-père de l’écrivain ! Originaire des Aït Baâmran, dans le sud marocain, Joseph Amran el Maleh était en effet à la fois grand Rabbin de la Kasbah, négociant en plumes d’autruches et consul représentant la nation d’Autriche à Mogador !
Le maqâm(mansion) de Sidi Sliman El Jazouli à Tazrout en pays Neknafa
Je me souviens aussi que lors de cette entrevue, mon père avait entretenu Amran El Maleh, de la dimension spirituelle de l’existence humaine et des deux types de savoirs qui la caractérise : îlm dahir (la science des apparences), et îlm al bâtine (celle des mystères). La première s’appuie sur des indices qui lui permettent d’affirmer qu’un homme va mourir, qu’une femme va accoucher ou que la pluie va tomber. Mais elle ne peut nous prédire la date de l’évènement. Dieu seul peut la connait, et c’est là ce qu’on appelle la science des mystères. La science dont il s'agit ici est la science du cœur auquel l'envoyé de Dieu avait fait allusion par ce dit :« Il y a deux sortes de sciences : une science dans le cœur, et c'est la science utile. Et une science dans la langue et c'est la preuve que donne Allah aux fils d'Adam. »
Ils s’entretenaient ainsi de la transcendance de la voie soufie, cette Tariqa qui s'inscrit dans une chaîne ininterrompue de maîtres spirituels, héritier chacun de ce secret, jusqu'au Prophète de l'Islam et, à travers lui, toute la chaîne des Saints et des Prophètes antérieurs. Ils se sont aussi entretenus de Sidi Sliman el Jazouli auquel Edmond Amran El Maleh a consacré un beau live : « Périple autour de Jazouli ». Périple que j’ai effectué récemment chez les Neknafa en pays Haha, pour y enquêter sur le maqâm (mansion) d’El Jazouli, en appliquant l’enquête ethnographique à un sujet historique. En fait pour y retrouver mes propres racines spirituelles. El Jazouli s’était retiré dans ces campagnes des tribus Haha et Chiadma, non loin du mysticisme Regraga qui depuis 771 (1370) existe à l’embouchure de l’oued Tensift. A l’issue de ma dérive à son piton rocheux, comme jadis à l’issue de mon pèlerinage chez les Regraga, j’ai traversé le mont Tama pour rejoindre à notre vallée de Tlit celle qu’on surnommait affectueusement « Lalla », notre marraine à tous. Elle m’accueillit comme d’habitude avec profusion de nourritures et de pastèques rafraîchissantes. Je ne savais pas encore que c’était la dernière fois que j’allais la voire. Le lendemain, très affaiblie, on l’a transféré du pays Haha à Marrakech, exactement comme ce fut le cas jadis pour Jazouli. Je note dans mon journal du jeudi 28 août 2008 : Lalla n’est plus. Elle est morte très tôt ce matin et sera inhumé à Marrakech vers la mi-journée. Elle rejoint ainsi mon père et ma mère que Dieu lui fasse miséricorde. Avec sa disparition, c’est la fin de toute une génération : celle qui nous rattachait encore à nos terres d’origine.
L’auteur de Dalaïl el Khaïrat qui suivit au début à Fès les cours de la Madrasa çaffârîn, occupait une chambre dans laquelle, dit-on, il ne laissait entrer personne. Apprenant la chose, son père se dit en lui-même :
- Il ferme la chambre parce qu’elle renferme quelque trésor.
Et il quitte son pays de Semlala dans le Sous, se rendit à Fès auprès de son fils et lui demanda de le laisser entrer dans la chambre. El Jazouli accéda à son désir ; sur les murs, de tous les côtés, étaient écrits ces mots : « La mort ! La mort ! La mort ! »
Le père comprit alors les pensées qui hantaient son fils ; il se fit des reproches à lui-même :
- Considère, se dit-il, les pensées de ton fils et les tiennes !
Il prit congé de lui et revint à son pays d’origine. »

La dernière visite d'Edmond Amran El Maleh à Essaouira
18:00 Écrit par elhajthami dans Mogador | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mogador |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le bélier d'or
Femmes voilées et dévoilées
Jacky Belhaj
Quand j’étais gamin, mon père était amine des babouchiers de la médina de Rabat. Dans mes tableaux, on retrouve les couleurs des babouchiers des années soixante. C’est là bas, chez les kharrazine de la médina de Rabat que je suis né. Les couleurs des blaghis que mon père amenait à la compagne...
Il y avait les Oudaya qui étaient à côté de la mer, un lieu qui symbolisait pour moi, les lumières du printemps. J’étais bercé dans la peinture. À l’école, chaque fois qu’on étudiait le printemps, je mettais des oiseaux dans mes cahiers. Toute ma vie , j’ai dessiné. Je peignais sur les plats de poterie où on préparait les crêpes : l’farrah dial rghayf. La poterie se remet à vivre grâce aux pigments naturels de la peinture. Tout était naturel.

Et puis je me rappelais les années de ma mère. Une femme fêtarde qui recevait souvent. Et quand ces amies enlevaient leur djellaba et leur litham on découvrait des filles. J’étais gamin. Et puis, je ne peux oublier une chose extraordinaire, quand ma mère m’amenait au hammam des femmes. J’avais la tête qui tournait. Elles étaient toutes belles et toutes nues. Toutes heureuses. Le henné, le massage. Elle se faisait masser par deux femmes, et cela revient dans tous mes tableaux : les couleurs des yeux immenses , les seins généreux, la volupté du corps. J’ai découvert cela quand j’étais gamin, et ce paradis ne me quitte plus jamais. Le rêve, le sexe, la femme, la différence, la volupté, la beauté, la générosité des poitrines. Elles me prennent dans leurs bras et j’ai envie de téter leurs seins, de retomber dans la chaleur utérine, de redevenir bébé.
Dans ma peinture, la coupole symbolise à la fois le sein et le saint. On adore se mettre sous l’envoutement du sein et la protection du saint. Le sein de la femme est sacré. On a envie de redevenir l’enfant qu’on était. D’où la prédominance des couleurs féminines dans mes tableaux. Nous les hommes on n’a pas de couleurs. C’est nous qui sont l’objet de la femme. C’est elles qui se jouent de nous. On est à leur merci. Je me mets à genoux devant elles. C’est elles qui nous dominent. Quand on est heureux, c’est elles qui nous rendent heureux. D’où l’argent et l’or dans mes tableaux. Les plus beaux bijoux au monde, ce sont les femmes. Tout homme se met à genoux pour offrir les plus beaux bijoux du monde, le plus beau diamant, le plus beau rubis pour honorer sa femme.
Un tableau, c’est un rêve que j’écris. C’est ma façon de m’exprimer. Pendant plus de 25 ans, je ne parlais plus. Je ne communiquais plus avec mon environnement. Et maintenant ma parole est libérée en commençant un tableau marocain, où je retrouve les souvenirs de mon enfance :
Tikchbila Tiwliwla
Ils ne m’ont pas tué
Ni ne m’ont laissé vivre
Ils m’ont juste offert une coupe...
Je n’arrive pas à faire des traits droits : mes peintures tournoient à la manière de cette comptine de tikchbila tiwliwla. Ah non ! On était gamins : haba fik chwini fik chantions nous, en jouant à cache - cache. Depuis la création d’Adam et d’Eve on joue toujours à cache - cache pour séduire nos femmes. Mais en réalité c’est elles qui se jouent de nous. On devient tout petit devant la beauté et le charme de la femme. On se déguise en chaton pour avoir droit à une petite caresse de leurs beaux yeux de sirènes de mer.
Le mauve, le vert, le rose, le jaune, le bleu de mer et de la nuit. Eloge à la femme éternelle. Je suis heureux avec mes tableaux. Une maison sans tableaux est une maison sans âme. Il y a l’équilibre de la personne. C’est ma vraie famille. La chaleur. Cette peinture me console. C’est féerique. J’y intègre des matériaux de récupération : des fils électriques, du caoutchouc, un bout de ferraille, le musicien, le luth-saxo. Des trompes l’œil. La fille danse : Tikchbila Tiwliwla.. Le bélier offert à la princesse. Les perles. Je lui offre tout l’or du monde pour un simple regard. Des tatouages en diamants. Elle n’a pas besoin de se dévoiler. C’est quelqu’un qui te possède. Quand je sors le feu qui me dévore, elle me possède, elle me possède, elle me possède, au cours d’une nuit sacrée ...
J’habitais derb Gnaoua à Rabat. Ba Mahjoub était le plus grand Gnaoui du Maroc. Les murs tremblaient quand il jouait. J’étais gamin. C’est des moments qu’on ne peut pas définir. Il y a des couleurs fantastiques. « Tutti colori »: c’est le feu, l’atifice endiablé, imaginaire. C’est ce qui permet de ressortir la force endormie depuis trente ans d’exil, de solitude et de silence. les femmes rentraient en transe, les filles se déchaînaient en écoutant les chants de la diaspora noire qu’elles ne comprenaient même pas. C’est là que j’ai découvert le Blouse, le Jazz, la Gadra Sahraouie. C’est la musique qui est jouée dans les eglises par les noirs américains dans la période où les eclaves étaient enchaînés. Le gospel. Ils se sentaient enchaînés pour aller au pardis.
Quand je suis en transe, je ne suis plus là. J’ai l’impression d’être dans un nuage. Les merveilleuses. Quand je suis dans le noir, c’est le noir féérique. Mon grand prère est parti sept fois à la mecque à dos de chameau. En commerçant. Je suis fier d’être noir.
Un voile en relief avec des yeux d’argent. Des yeux immenses avec des cils géants. C’est la beauté des yeux écarquillées. Elle te dévore avec ses yeux qui dévorent tout son visage, au point qu’il n’y a plus de visage. Il n’y a que les beaux yeux. Comme dans le fantastique. Les couleurs bleus. Je suis très tendance mode. Le mauve, c’est la tendance. Ça fait caftan mauve. L’habillement marocain. Le caftan, c’est millénaire. Tu joue avec. Je suis né là dedans. Ma mère portait le caftan brodé à la main avec des doigts de fée.

C’est la grande magie. On devient possédé. C’est un bélier en or pur. Le bélier revient toujours. Au Maroc, tout ce qui est festif s’accompagne du sacrifice du bélier. Mais mon bélier ne peut pas être sacrifié parce qu’il est en or. Si j’arrive un jour à le sacrifier, il sera fini et je ne pourrais plus le réinstaller. Il est à la fois divinité de Tanite, et dieu Baal. Je me transforme moi-même en bélier doré, parce que je veux me sacrifier pour elle. La femme en or, la femme voilée, mais toute dorée. On a peur de la toucher. C’est Cléopâtre.
Elles ont ce voile qui augment le mystère. L’esthétique de la femme dérobée. On a des femmes – serpent, avec du venin dans les yeux et on aimerait bien qu’elles nous tuent avec le regard. Mais elles nous tuent quand même, qu’on le veille ou pas ; on est à leur merci. Elle te paralyse avec le doux venin de son regard. C’est géant. Ce sont de sacrés serpents non venimeux qui circulent en moi, que je transcris sur mes tableaux : œil – poisson, avec des cils en fils électriques de récupération. Les cils sont en même temps, la queue du poisson. C’est un poisson magique qui pétille, qui vit, qui n’est pas mort ! Il est immortel.
Ça tourne et ça retourne dans tous les sens. Et les couleurs et les mouvements. Ce sont les vagues. Car quand on rêve ; on est dans les vagues.
Le hijab - talisman, le marabout pour la séduction. Serpent multicolore qui protège la femme. Poisson bleu qui sort de la tête. C’est un poisson en or. Le personnage se transforme en bélier pour essayer de séduire. Le bélier et la coupole, c’est magique.
Le tableau métallique est une sculpture : une gigantesque installation. Avec des bijoux, des strass, des perles rares. Le bleu émeraude. Des yeux persans qui te transpercent. Moummou Boukhorsa , c’est marocain, c’est mythique. C’est du métal et du bois. On peut appeler ça : « Métallique 1 ». C’est mes tripes qui sont là.

Le diable qui me possède, j’essai de lui parler calmement. De communiquer avec lui. Mais il ne veut rien savoir. Il est en moi. Il vit en moi. On est inséparable.
Triptyque onirique : multiplication des personnages, au niveau de la matière, des formes et des couleurs.. Multiplication du même personnage qui s’autogenèse sous des masques différent pour séduire la femme inaccessible.
Elle est vivante dans l’espace et dans le temps. Elle est omniprésente.
Elle est là , elle est là, elle est là . Éblouissante. Avec ses grands yeux, elle est sacrée. C’est ma divinité. J’ai beau me déguiser en sphinx, en mettant le marabout sur la tête, je lui tire chapeau : anta bayâ (à toi je présente mon allégeance). Elle est tellement forte que je reste scotché. Elle m’hypnotise. J’en rêve. Je suis à genoux. Je tombe par terre. Elle me met chaos debout.
Je me demande comment j’arrive à faire des choses aussi magiques et à les maîtriser ? Il y a une dimension surnaturelle en moi que je n’arrive pas à expliquer. Je suis en transe chaque fois que je crée. C’est celui qui me possède qui fait ça. Je crois qu’il s’appelle Jacquy. Celui qui est en moi.
Aïcha Kandicha est magique. C’est elle qui domine la situation. La plus forte au monde, c’est Aïcha Kandicha. C’est une femme-fleur. Elles sont toutes des fleurs, les femmes. La terreur se transforme en pétales de rose. Le démon se transforme en ange dont on rêve.
Jazz – Gnaoua. Le Bouderbala en transe dont les doigts sont des serpents. C’est la magie des doigts induits au henné dont la grâce rappelle la danse de la Guedra. Le Gnaoui, c’est sacré. :
Le Gnaoui yaoui – yaoui
Le Gnaoui, Bouderbala
Le Gnaoui le maître de Yabori
Protège-moi, patron du port
Face aux Oudaya et à Sala, la ville des corsaires, Sidi Yabouri est le saint patron des marins – pêcheurs.
Je m’inspire de la mode, parce que j’ai habillé beaucoup de stars à Paris. Mais aussi des couleurs et des odeurs de Marrakech : ces tanneurs et leurs couleurs magiques, le souk des épices, celui de la menthe et de l’absinthe, ses ruelles tortueuses, ses murs ocres, ses portes monumentales, le Bab Gnaoua des Almohades, le Bab Aylal, et celui des cigognes avec ses multitudes de femmes voilées et dévoilées. Marrakech la ville où les odeurs ont des couleurs. Celles des saveurs d’ épices et des plantes médicinales au pouvoir sont fantastiques. Ça m’a amené à habiller des femmes du monde en pantalon – saroual marocain. J’ai ainsi habillé Miss Paris et Miss France avec les teintes et les tissus de Marrakech. Avec la complicité de NAF – NAF on est arrivé à être élu dans le monde de la mode « l’habit de l’année 78 ». Avec l’empreinte de Jacky Belhaj, le pantalon – saroual marocain entra conquiert ainsi l’univers de la mode du prêt-à-porter en allant de Paris à New York, de Montréal à Londres et à Tokyo.
Il y a donc un rapport entre l’artiste peintre et le créateur de mode qui a transformé les produits marocains en vêtement à la mode traversant le monde avec la complicité des grands couturiers parisiens, italiens et autres.
Mystique des couleurs : vert tendre, jaune canari, rose pastel. Légèreté des couleurs, poésie des formes. Rêverie projetée dans l’espace. Voyage à travers les légendes marocaines.
Jacky Belhaj, peintre – installator. La couleur black est la meilleur au monde. Ce qui m’étonne , c’est que cette africanité refoulée depuis toujours en moi, refait surface maintenant après trente ans d’exile parisien. Ce retour au Maroc m’a boosté . Je n’arrive pas à croire à cette fantastique explosion de ma créativité, alors que j’étais frappé de mutisme. Je la doit à ce retour au Maroc et à mes racines africaines. Je suis fier d’être black. J’ai mis à l’entrée de ma maison un masque africain, que j’ai appelé « INSTALLATOR I », qui veille sur moi et me protège : deux cornes de buffle au dessus d’un cercle solaire dont les traits sont faits de cauris et de coquillages du Soudan. Je sculpte également des masques africains en bois. Le fer forgé de ma véranda représente des masques africains répétés indéfiniment : c’est une chorale de chanteurs blacks africains. Ils me protègent. Il y a aussi l’araignée – tarentule qui s’interpose entre ma maison et la vue sur mer. Et dans mon jardin , mon installation vélo en fer forgé triporteur de pots de fleurs. Et puis le lion en roches naturelles installé sur son cadre et qui veille également sur moi.
J’avais griffonné au Metro, Aïcha Kandicha l’ensorceleuse, que j’ai brodé par la suite en fils de fer. Elle m’a toujours fasciné depuis que j’étais gamin. On nous disait : « Il ne faut pas trop s’éloigner ; elle risque de surgir au bout de la rue. » Je suis subjugué par les femmes qui portent le henné, par l’invisible, visible.
Je m’amuse en peignant. C’est une fécondation. La toile est un fœtus. J’habille la toile. Tous les jours, je nourris mon bébé : ça fait référence à l’autel des Gnaoua où il s’agit aussi de « nourrir les Mlouk ».
Des yeux verts entourées de perles rose-cristallin.
Les mariées d’Imilchil sur fond de bronze. C’est une installation métallique.
Le mouvement et la musique des vagues, les poissons invisibles, les escargots de mer, les goélands se prélassant au soleil matinal au bord de l’eau. Lumière sur lumière. Les taches blanches étoilées. Tout cela est intégré d’une manière spontanée dans les œuvres. Les influences de la mer.
Propos recueillis par Abdelkader Mana
08:17 Écrit par elhajthami dans Arts | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
01/06/2011
La Tour du vent et du feu !
HAMZA FAKIR
La Tour du vent et du feu ![1]
« Un soir, du haut du promontoire d’Azelf, raconte Fakir, j’ai vu Essaouira illuminée, entourée de noir. Elle semblait flotter dans l’air, nager dans l’eau. Depuis lors je n’ai pas cessé de représenter sa population dans un espace plein. » Tantôt, il la représente sous la forme d’une raie, tantôt sous la forme d’une bande colorée, qui traverse l’espace vide comme une légende bruyante et colorée : des volumes flottants dans la stratosphère de la poésie juvénile.

C’est que Fakir n’a que 21 ans et sa peinture a la fraîcheur même de son âge. Son discours porte la marque des rêves qui bourgeonnent à l’équinoxe du printemps : poète, il passe la plupart de son temps au bord de la mer, non pas pour « bronzer idiot », mais pour créer à partir de l’univers marin un monde imaginaire qui éblouit nos regards par la douceur de ses couleurs et la force symbolique de ses contenus. Un contenu aux fortes connotations africaines avec ses masques rituels et ses oiseaux tropicaux.

Hamza Fakir, est incontestablement l’une des figures marquantes de l’art nègre, dans l’expression ethnologique et artistique sur les artistes d’inspiration africaine d’Essaouira, qui se tient actuellement à la galerie Frederic Damgard.
« Quand je peins, je me sens noir, comme un vrai africain. J’écoute de la musique africaine ; une musique de transe qui fait bouger. En l’écoutant, je sens que quelque chose me tient à la gorge. C’est vraiment très dur de travailler sans la compagnie de personne, mais heureusement qu’il y a cette musique africaine qui me soulage de mes souffrances. Dans ma peinture, les masques africains, les oiseaux, les poissons, sont entremêlés à la femme voilée d’Essaouira qui domine tout. Elle est toujours possédée par le grand esprit et les djinns ; en particulier par le grand esprit noir ; celui de l’Afrique, avec lequel j’essaie de nouer des liens grâce à ma peinture. Au milieu du grand tableau, j’ai imaginé ce grand esprit africain, que j’ai entouré de danseurs noirs. Des noirs qui tournent autour de lui en criant. Pour moi, ces esclaves du grand esprit, eux aussi vont chercher des femmes, pour les posséder, et pour en faire des êtres enchaînés au grand esprit.
Mes rêves sont toujours limités, à ce petit monde d’Essaouira. L’idée du tableau me vient parfois au début du sommeil. Je commence à imaginer des visages et des formes. Il y a des moments, où je sens vraiment que ma tête va éclater, alors je me réveille et j’essaie d’esquisser un premier croquis. Ça peut demander des heures de travail et de fatigue. Mas juste après, je me sens soulagé, et l’envie de dormir me revient.
Quand le matin arrive, je vais sur la plage, et j’essaie de bien développer cette idée conçue dans le rêve du demi-sommeil. Je vais dans mon coin préféré ; un abri en haut des ruines de « la tour du feu »[2]. c’est là que je développe mes esquisses, surtout quand il y a beaucoup de vent. J’ai déjà essayé mais je ne pourrais pas travailler ailleurs. Seul, ce lieu hanté par l’histoire et l’esprit du passé, m’inspire. J’y dialogue avec la mer et les pierres anciennes. Comme par le passé, de temps en temps des caravanes venues d’ailleurs, laissant des empreintes de chameaux que rapidement le ressac efface.
La « tour de feu » et la solitude m’inspirent. Delà, j’ai une superbe vue sur la plage immense ; au loin je vois des vaches et je pense à la Corne de l’Afrique, ce bout du monde. Les vaches sont toujours là, le matin, calmes sur le sable. Ce qui est bizarre avec ces vaches, c’est qu’elles viennent soit du sacré village de Diabet, soit de Ghazoua. Elles viennent de bon heure, sans berger, car elles connaissent les chemins de la forêt, qui débouchent sur la mer. En regardant les mouettes et les goélands, dont l’envol m’inspire…
 Quand tu t’assois le matin au bord de la rivière, tu vois des oiseaux superbes. Surtout les faucons qui volent vers l’île. C’est surtout le ballet aérien des étourneaux sur l’île et sur la ville, qui m’inspire les formes flottantes de certains de mes tableaux. Une fumée emportée par le vent.
Quand tu t’assois le matin au bord de la rivière, tu vois des oiseaux superbes. Surtout les faucons qui volent vers l’île. C’est surtout le ballet aérien des étourneaux sur l’île et sur la ville, qui m’inspire les formes flottantes de certains de mes tableaux. Une fumée emportée par le vent.
Pourquoi les piranhas ?
Parce que tu vois dans la rivière, surtout quand il y a du vent, de jolis poissons, qui sautent en pleine liberté. Ils sont très contents de leur milieu aquatique, limpide et calme. Je les représente sous des formes d’algues, avec des nageoires multicolores et surtout de grosses dents. Si tu les vois avec ces grosses dents, tu diras qu’ils sont méchants, mais c’est tout à fait le contraire, les grosses dents représentent leur sourire : un sourire qui n’est pas tronqué, un vrai sourire du cœur. Je vais sur la plage et j’essaie d’imaginer ce monde.
Quand je me promène seul, dans les ruelles d’Essaouira, le regard ébloui par ses petites fenêtres bleues, et ses murs blancs, je scrute surtout les visages, que j’imagine par la suite à ma façon. Je vois que derrière le voile du sourire, il y a beaucoup de problèmes. Un sourire de masque. C’est surtout cette souffrance derrière le masque que je peins par un cri. Le masque est leur vrai visage. Je représente toujours la souffrance des gens, avec des visages grimaçants. Ce n’est pas de beaux visages, car j’adore beaucoup les films d’épouvante, où les visages font peur. J’ai peints un grand masque sur fond gris.
C’est le grand esprit qui n’est pas heureux. Il domine la femme qu’il possède. Sa tête est un volcan, et c’est ma tête aussi. Il est beau, non ? Il crie jusqu’à ce que les larmes jaillissent de ses yeux, dont on voit les vaisseaux bleus qui jaillissent comme l’éclair au milieu du ciel. C’est un masque vivant. Quand les Gnaoua dansent, ils portent aussi leur masque rituel sous la forme d’écharpes multicolores. Avec cet anneau au pied, cet errant qui voyage à pied le sac sur le dos, et ce chameau, j’essaie de faire voir les caravanes qui passaient à Essaouira. Mais je ne peux pas toujours expliquer mes tableaux, sauf quand je me réveille le matin, que je mets mes mains dans ma poche, et que je marche très longtemps sur la plage. Ce jour-là, je me raconte ma peinture, pendant des heures et des heures. C’est seulement à ces moments d’extase, où la parole vous tient à cœur autant que les images, que j’arrive vraiment à m’expliquer mes propres tableaux. Mais ce sont des moments où les paroles sont adressées au soleil et au vent et non pas aux humains.
Il va falloir vous dire un dernier mot, sur mes couleurs, et la portée symbolique que je leur accorde. Dans ma peinture il y a toujours le rouge, le noir et un peu de blanc qui représente le bien, il y a toujours du noir qui représente le mal avec comme perspective la vie qui est ce rouge-sang qui coule dans nos veines. Il y a aussi des formes cellulaires : des formes très bizarres qui viennent spontanément sous mon pinceau, et qui ne sont ni des visages, ni des animaux ; qui comportent toujours un œil, pour signifier aux gens que ces formes bizarres ont une vie. Ce sont pour moi, des corps qui vivent en nous ; des cellules de la souffrance. Des oiseaux souffrent aussi…. »
 Un cheval à huit pattes, un diable aux couleurs des algues, une traînée de pierres sacrées, et d’étoiles, un poisson dont la queue est formée par une main, de grosses griffes pour rappeler que la main de Fatma qui protège peut aussi faire du mal. Une roue solaire, un masque vert, un filet de pêche parce que les gens d’Essaouira vivent de ce que leur donne la mer – une djellaba avec un poignard en bandoulière qu’on voit dans les moussem, un pied décoré au henné, un haïk décoré aux motifs traditionnels, une femme portant un bébé sur le dos, un noir sans visage, une femme au regard vide, une écriture de talisman…
Un cheval à huit pattes, un diable aux couleurs des algues, une traînée de pierres sacrées, et d’étoiles, un poisson dont la queue est formée par une main, de grosses griffes pour rappeler que la main de Fatma qui protège peut aussi faire du mal. Une roue solaire, un masque vert, un filet de pêche parce que les gens d’Essaouira vivent de ce que leur donne la mer – une djellaba avec un poignard en bandoulière qu’on voit dans les moussem, un pied décoré au henné, un haïk décoré aux motifs traditionnels, une femme portant un bébé sur le dos, un noir sans visage, une femme au regard vide, une écriture de talisman…
Les expériences personnels de Fakir, tournent dans sa tête comme dans un moulinet avant de se reproduire sur la toile, sous la forme d’un remplissage graphique, sans ombre, ni perspective reproduisant ainsi au niveau symbolique l’horreur du vide qui habite la conscience islamique, où l’agencement de l’espace en forme de labyrinthe favorise l’entassement des êtres et des choses : on préfère les espaces pleins aux espaces vides, la foule grouillante de vie à la solitude. Abdelkader MANA
[1] Article paru dans l’OPINION du vendredi 27 juillet 1990
[2] C’est ce qui est connu communément par le nom de « Borj El Baroud ». Ce fort que surplombait une batterie utilisée par le sultan pour fermer la passe Sud de la baie d’Essaouira par des tirs croisées avec une autre batterie située juste en face sur l'île, est situé près de Diabet à l'embouchure de l'oued kso. La partie supérieure est musulmane (1432), les gros blocs qui ont servis de base à la construction musulmane peuvent être les vestiges de "Migdol", la tour punique qui a dû être construite par Hannon au fond de la baie de Mogador et a fourni l'ancien nom d'Amogdoul cité par le géographe El Békri. Ils sont battus par les brèches à chaque marée par les vagues. La partie sud abritée des vents alizées de cette vielle ruine servait de refuge à marée basse aux hippies qui y venaient dans les années 1967-1973, du village voisin de Diabet pour y prendre des bains de soleil en y pratiquant treep et nudisme. C’est le lieu mythique, le plus fort en énergies cosmiques éoliennes et solaires.
19:00 Écrit par elhajthami dans Arts | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arts |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
31/05/2011
Le port de Tombouctou
Essaouira avait un rôle de transit entre l’Afrique et l’Europe, c’est pour cela qu’on l’a surnommé « le port de Tombouctou ». Ici les caravanes de Tombouctou prolongeaient les caravelles de la lointaine Europe. Les populations noires sont venues en deux vagues : la première vague est venue pour travailler dans la sucrerie saâdienne de l’oued ksob à la fin du 16ème siècle et au début du 17ème siècle. Ces anciens esclaves noirs se sont intégrés progressivement à la société berbère où on les appelle « ganga » du nom de leur gros tambour. Au bord de l’oued ksob, les saâdiens avaient établi un pressoir de canne à sucre qui a fonctionné régulièrement de 1578 à 1603 où travaillait essentiellement une main d’œuvre servile noire. D’après el oufrâni , le marbre apporté d’Italie était payé en sucre poids pour poids. Maintenant, l’arganier s’est substitué à la canne à sucre : on voit encore l’emplacement de la chute d’eau et les traces de frottement laissées par la roue hydraulique. Sur une grande distance, de splendides aqueducs, targa, en pisée, actuellement desséchés acheminaient l’eau depuis la source chaude d’irghan, jusqu’à la sucrerie.
Feu Wisaâd lors du repas communiel des Ganga de Tamanar
La deuxième vague est celle des gnaoua d’Essaouira qui date de la fin du 18ème siècle. Dans leur chant boulila (le maître de la nuit), on retrouve encore le souvenir de bilad soudan (le pays des noirs et sa traite négrière. Ces noirs ont été employés à l’édification du port comme en témoigne Georges Höst en 1764 : « Sidi Mohamed Ben Abdellah s’employa à construire une nouvelle ville à Souira ou Mogador et envoya cent livres de fer et quelques nègres. Ce qui marqua le début de cet endroit curieux. » Le sultan pensait ainsi disposer d’un port bien défendu et accessible toute l’année à ses navires. Alors que les ports du nord étaient pratiquement inabordables en dehors de la saison de pluie à cause de leur ensablement. Le sultan fonda un chantier naval en même temps que le port. Et en 1768, sa flotte était composée de 12 bateaux de tailles différentes armés de deux cent quarante et un canons.
Tambour de feu, cette voix/voie des dieux africains
Vers la fin de la période des moissons, avant de célébrer leur fête annuelle, ou maârouf, les ganga font une longue tournée aumônière dans tout le pays Haha et bien au-delà. Les rassemblements diurnes et saisonniers de ces ganga ont un but avant tout thérapeutique : on cherche à provoquer la guérison par des séances musicales, en se servant exclusivement des tambours et des crotales. Lors de leur fête annuelle, ces adeptes de « Lalla Mimouna » sacrifient un bouc noir. Ce qui donne lieu à un repas communiel à base d’huile d’argan, d’amendes et de miel. C’est par leur tambour, cette voix des dieux africains, que les Berbères identifient ces « ganga », terme qui signifie justement « gros tambour ». Ce métissage de la berbérité et de la négritude est illustré magistralement par leur danse collective qui tient à la fois de l’ahwach berbère et du tempo africain.
C’est en s’inspirant du culte de possession des gnaoua et de la magie de leurs couleurs que le peintre Tabal a pu développer un art singulier : une peinture inspirée de la spiritualité et de la rythmique de l’Afrique profonde. Une ethno- peinture où les couleurs sont associées aux esprits des éléments de la nature et àleurs principes vitaux : le feu, le vent, l’eau, mais aussi le lait,le sang, le soleil, la lune, l’hiver, l’été, la nuit, le jour, le monde des vivants et celui des morts.
Issu des gangas berbères par son père, le peintre Tabal fut dans sa jeunesse initié au culte des gnaoua citadins. L’imaginaire ganga fils du soleil et des saisons, s’associe chez lui à celui des gnaoua fils de la lune et de la nuit. Il porte en lui, le pouvoir de l’androgyne qui crée l’harmonie entre les devises musicales et les couleurs de l’arc en ciel. Sa fécondité créatrice lui vient de cette unité intérieure. « Tes tableaux font peur ! » lui dit un jour un ami. Il voulait signifier par là qu’ils lui paraissaient mystérieux. Son père lui avait laissé sa bête de somme en lui disant : « Prends – la pour travailler. Et si tu n’accepte pas de faire ce métier, vends-la ». Tabal a beaucoup réfléchi. Il n’a pas vendu l’âne. Il s’en est servi pour travailler. Il allait dans les hameaux des environs en suivant les traces de son père qui avait coutume de dire : « Si tu suis ton chemin, il finira toujours par te mener quelque part ».
A la mort du père, Tabal prit son petit âne et son grand tambour et s’en alla cheminer par les mêmes sentiers et les mêmes collines : les arbres et les pierres le reconnurent, les enfants aussi. Entre deux tournées, de retour chez lui, il prit un jour une planche et commença à peindre le visage de son père pour en conserver la mémoire. Dans son esprit, la peinture ressuscite les morts. Les fleurs violacées et lumineuses qui ont frappé son regard au bord de la rivière l’inspirent quand il se met à peindre. Quand il est possédé par les génies de la peinture et par leur enthousiasme, ses tableaux deviennent comme une rivière en crue qui l’inspire et le stimule. Quand du haut de la montagne , il assiste à son débordement et qu’il voit tout ce qu’elle charrie : les arbres déracinés, les cadavres d’animaux, l’agneau les pattes en l’air, la tête du chameau disparaissant sous les eaux ; il éprouve alors le besoin de retenir tout cela en le fixant sur la toile.
Tabal est un peintre de la mémoire, la sienne propre et celle de la diaspora noire. Ses tableaux sont autre chose que de simples tableaux. Car, ils sont habités par les esprits possesseurs : ceux de ces ancêtres, ceux de l’esclavage. La danse rituelle des anciens africains anime sa peinture. S’il exprime par sa peinture une imagerie africaine traditionnelle, avec ses crocodiles, ses singes, ses autruches et ses masques rituels . Cela est dû non pas à une volonté consciente mais à son identité de noir. L’Afrique en tant qu’horizon de sentiments et d’art parle en lui. Il est comme un médium possédé par la culture de ses ancêtres déportés. Les esprits qui l’habitent sont ceux des anciens rois d’Afrique et des puissances fauves de la savane. Pour comprendre les rapports qu’il entretien avec la transe et les couleurs, il faut se souvenir que pour les gnaoua, les couleurs ne sont pas seulement cet enchantement de lumière dont se pare la nature pour nous éblouir , nous séduire. Mais qu’ils sont d’abord les couleurs des génies invoqués au cours des nuits rituelles. Elles sont en correspondance symbolique avec les encens et les devises musicales des esprits surnaturels par qui leurs adeptes en état de transe sont possédés.

L’errance est parfois difficile et dangereuse. Le samedi, Tabal travaillait dans les environs de had dra pour se rapprocher du souk qui a lieu le lendemain. Il allait aussi à Sidi Ali Maâchou dont les descendants guérissent la rage. Les chorfa du marabout l’accueillirent bien. Ils lui donnèrent à boire et à manger. Il dormait à la belle étoile à côté du sanctuaire. Cependant, une nuit qu’il a dormi à l’intérieur du marabout, il rêva qu’il était en train de peindre des jardins. Par ce rêve, il comprit alors que de la peinture lui viendra beaucoup de bien : « Le pinceau, dit-il, je le tiens d’une main ferme, tandis que ma tête s’envole ! »
La femme de Tabal
Qui dit rituel, dit théâtralisation, mise en scène. C’est à la talaâ(celle qui fait « monter » les esprits), ou voyante médiumnique qu’on fait appel quand quelqu’un est possédé par les djinns. Elle utilise les cauris et les cauquillages pour la divination comme l’a pu constater Edmond Doutté au tout début du 20ème siècle : « J’ai retrouvé, aux environs de Mogador, les devineresses qui prédisent l’avenir avec des coquillages et que Diégo de Torres, observait déjà en 1550. Ce sont des femmes négro-berbères qui prétendent faire parler les térébratules fossiles. »
Tabal chez Zaïda Guinéa, voyante médiumnique décédée depuis lors
Grâce à leur autel des mlouk, leur plateau de cauris du Nil du Soudan ; les voyante médiumniques déterminent ainsi la nature et l’origine de l’esprit possesseur. Le remède consiste soit en pèlerinage à Sidi Chamharouch, le sultan des djinns en haut Atlas, ou la grotte – figuier d’Aïcha kandicha au mont zerhoun, surtout au mouloud, soit l’organisation d’une nuit rituel. Dans les deux, il faut toujours un sacrifice. Au moment de la consultation, la voyante est un simple médium, puis qu’elle est elle-même possédée par son melk, son esprit possesseur.
Après la procession et le sacrifice commence à l’intérieur de la zaouïa, la partie préliminaire qu’on appelle Kouyou. Du guenbri, le maâlem , se sert à la fois comme instrument à corde et comme instrument à percussion : tirant sur la corde tout en frappant la peau. La partie ludique des Kouyou se déroule en deux temps : les Oulad Bombara d’abord : au cours de cette phase, on évoque essentiellement la condition d’esclave et on se livre au jeu énigmatique dénommé « la quête du chamelier ». Vient ensuite la Nekcha , la danse rythmée par la plante des pieds, à la manière des claquettes américaines, accompagnée du guenbri où l’on rythme uniquement des mains. Magie de l’Afrique et de ses rythmes !
Feu Mahmoud Akherraz, le sacrificateur des Gnaoua
On commence par la parodie, le jeu et le rire pour se préparer au tragique de la transe de possession. Vers minuit, après la longue pose qui suit la phase ludique des Kouyou, on en vient enfin au sérieux de la transe. Les encens et les couleurs, chacun au nombre de sept, sont en correspondance symbolique avec les sept cohortes des génies possesseurs qui provoquent les transes rituelles. Ce panthéon des gnaoua est composé de saints de l’Islam maghrébin et des génies de l’Afrique Noire ou mlouk. On passe d’une mehella, bataillon de génies à une autre : la mehella des bleus succède à celle des blancs, la mehella des verts suit celle des rouges : les bataillons de génies succèdent aux bataillons de génies .La lila est un voyage où on refait un monde qui a été édifié en un instant où le temps n’existait pas.Les gnaoua travaillent sur les sept couleurs : quand les gens tombent malades , c’est qu’il y en a une qui ne va pas. Le rituel est finalement une mise en ordre spirituel des énergies cosmiques perturbées. A l’horizon, l’aube se met à poindre. La transe et les génies qui la provoquent se dissipent avec la lumière du nouveau jour qui point. Abdelkader Mana
23:18 Écrit par elhajthami dans Musique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : musique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Lumiière d'Afrique
Jean Louis Miège et le noble métier d’historien
Le vendredi 24 juillet 1987,je rends comte à Maroc - Soir de l’Université d’été de Mohammadia en publiant des entretiens avec Haïm Zafrani, Germaine Ayache , dont celui – ci avec Jean Louis Miège (voir fac simili) . En guise de présentation j’écrivais : Parmi les participants, nous avons rencontré l’éminent historien qui a publié en cinq tomes (éd. P.U.F.), l’histoire des relations entre le Maroc et l’Europe du XVII et XIXème siècle. Il s’agit du professeur Jean Louis Miège, né à rabat, qui a formé de nombreux historiens marocains et qui dirige actuellement trois thèses de doctorat d’Etat de jeunes chercheurs marocains dont l’une porte justement sur 1912. Dans cet entretien Jean Louis Miège nous parle de Mogador où est née sa femme, de son attachement à ses racines marocaines, du commerce transsaharien, du judaïsme marocain et du long ébranlement qui va conduire au protectorat.

Q. Vous avez consacré de longs passages à Mogador dans votre œuvre concernant les rapports entre l’Europe et le Maroc au XVIII et XIX ème siècle.
J.L.Miège : J’en parle également dans un livre collectif consacré aux principales villes du Maroc. On avait demandé à un certain nombre d’auteurs – Sefrioui, boujean, Deverdain…- de faire un chapitre chacun consacré à une ville. Je me souviens que Boujean avait fait Meknès et moi-même j’ai fait la partie consacrée à Casablanca – que j’habitais – et à Essaouira ; Mogador à l’époque. L’ouvrage s’appelle « dans la lumière des cités Africaines ». Il a été couronné par l’Académie des Sciences d’Outre Mer paru dans les années 1955 et c’est assez peu connu.

Q. qu’est ce que vous avez révélé dans ce livre de Mogador ?
J.L.Miège : Ce livre a été un peu le complément de ce que j’écrivais alors concernant l’histoire de la ville et qui étaient des écris d’érudition, d’historien, fondés sur des archives. Là, c’était le livre d’un amoureux de la ville, donc c’est beaucoup plus la partie affective, esthétique, des sentiments que la ville éveillait en moi ; c’est beaucoup plus personnelle d’une certaine façon que les autres travaux qui sont d’érudition.
Q. vous êtes le spécialiste des rapports entre l’Europe et le le Maroc au XIXème siècle : la ville était devenue d’une importance circonscrite et locale. On se demande pourquoi Mièg accorde tant d’intérêt pour l’histoire d’une petite ville au XIXème siècle ?
J.L.Miège : Evidemment le destin de l’histoire a fait que Mogador a été un petit peu marginalisée par rapport aux nouveaux courants commerciaux alors que justement l’intérêt que j’ai vu dans la ville, c’était l’importance qu’elle avait joué dés sa création et au début du XIX ème siècle et c’est au fond cette histoire à la fois de son ascension et peut – être les débuts de son déclin par sa grande rivale qui allait entièrement l’éclipser – Casablanca – qui m’a fait m’attacher à elle. Parce qu’on voyait une ville naître , se développer et s’épanouir – et avec une très grande originalité – et on sentait déjà cette ville commencer de s’engourdir parce que l’histoire va la laisser un peu en marge des nouveaux courants.

Q. Dans votre livre vous signalez que la ville était victime de la découverte de la machine à vapeur et de l’occupation de Tindouf à la fin du siècle dernier ?
J.L.Miège : Oui, ce sont à la fois des raisons techniques , des modifications des communications à vapeur qui ont fait que le port a décliné et puis c’est évidemment qu’il a été coupé progressivement de l’arrière pays profond ; c'est-à-dire de ce trafic à travers le Sahara, avec l’Afrique Noire dont Mogador était tête de pont.

Q. Ce commerce transsaharien démontre qu’il y a des liens profonds entre le Maroc et l’Afrique et surtout entre le nord du pays et le Sahara marocain.
J.L.Miège : Oui, il est indéniable qu’à travers toute l’histoire, on parle toujours évidemment de la conquête marocaine de Tombouctou de l’époque saâdienne, qui a vu le plus brillant moment des contacts. Mais à travers toute l’histoire ces contacts, qu’ils aient eu lieu plus vers l’Est par le Tafilalet et la grandeur de Sijimassa, ou qu’il ait eu lieu plus vers l’Ouest avec l’émergence justement de Mogador, ont toujours été, d’une extrême importance du point de vue humain, économique et culturel. Ce que je crois avoir – et mes travaux ultérieurs l’ont confirmé – démontré ; c’est le réveil de ce commerce transsaharien au début du XIXème siècle. Et contrairement à ce qu’on pouvait imaginer ; ce n’est pas au XVIIIème siècle que le commerce a décliné mais très à la fin, à la deuxième moitié du XIXème siècle. Et donc les rapports ont été peut – être plus étroits au début du XIXème siècle qu’ils n’avaient été pendant beaucoup de périodes antérieures. Ce qui fait l’importance de la « révolution », en quelque sorte, que cette interruption a pu amené puisque c’était un commerce en plein essor qui avait doublé, triplé, en l’espace de quelques années ; qui ensuite s’est brusquement amenuisé et qui s’est reporté alors très à l’Est ; c'est-à-dire vers la Libye qui a été l’héritière de ce commerce ou plus à l’Est encore vers la mer rouge et à la péninsule arabe.

Q. Dernièrement, kakon, natif d’Essaouira a écrit sur la ville un livre intitulé « la porte du lion », Edmond Amran El Maleh a écrit « Parcourt immobile » où on retrouve cette nostalgie pour la ville, Haïm Zafrani en parle également…Comment expliquez – vous cette nostalgie de la communauté juive pour sa ville malgré le départ ?
J.L.Miège : Je pense que vous pouvez poser la question à mon ami Haïm Zafrani qui vient d’arriver à l’Université d’été de Mohammadia. Nous en avons justement beaucoup parlé aujourd’hui au déjeuner. Je pense que cette nostalgie tient d’abord d’une façon générale à la nostalgie qu’on a de ses racines. Et moi-même né à Rabat et ayant une famille qui a vécue 60 ans au Maroc ; je ne peux manquer d’avoir de la nostalgie de mes racines. Je pense ensuite, que cette communauté avait une très profonde originalité, parce qu’elle est à la fois très marocaine, très enracinée mais également très ouverte sur l’extérieur, très vivante et il y a eu là une petite civilisation – j’oserai dire dans la grande civilisation séfarade Judéo – Arabe et plus spécialement Judéo – Marocaine. Et il y a eu une micro - civilisation particulière de Mogador qui tenait justement à ces particularités et peut être à une teinte Anglaise due à quelques Gibraltariens qui apportaient une touche supplémentaire et que cette synthèse d’éléments, ce décore si particulier de la ville si belle de Mogador, qui avait crée cette petite civilisation Judéo – Marocano – Mogadorienne ou Essaouirienne oserai – je dire.

Q. Dans ce symposium estival ; les historiens se sont mis d’accord pour parler de la pénétration coloniale à partir de la Bataille d’Isly, où le Prince de Joinville avait justement bombardé Mogador en 1844…
J.L.Miège : Oui, comme vous le dites très justement, cette marginalisation un peu de Mogador, isly, les rapports avec l’Algérie, la frontière de l’Est…Retiennent peut – être plus maintenant dans le subconscient Marocain de place que le Sud ou cette période. Je crois surtout que le Maroc n’étant plus à l’époque une puissance maritime ; le fait de cette bataille terrestre qui fut une grande bataille a plus fortement marqué les esprits qu’un bombardement maritime. Et peut être il aurait fallu commencer quelques décennies plutôt et justement à la fondation de Mogador.

Q. C’est quand même à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle que les puissances ; l’Angleterre, la France, l’Espagne, l’Allemagne ont commencé à préparer le protectorat du Maroc ?
J.L.Miège : Si vous voulez. Je pense qu’il y a le véritable tournant, la période absolument décisive et très circonscrite et très courte dans l’histoire en réalité. Elle se prolonge ensuite, l’ébranlement est long. Mais, c’est en six ou sept ans que tout le destin du Maroc se joue et bascule. C’est entre le traité de commerce avec l’Angleterre en 1857 ; c’est la guerre de Tétouan en 1859 et le traité de 1860 et c’est le traité avec la France de 1863 – D’une part l’intervention des trois grands partenaires, l’Allemagne , la France et l’Espagne et d’autre part la triple action économique avec le traité commercial, militaire et politique. Avec la guerre de Tétouan et le traité Espano – marocain et social avec la convention avec la France qui étend la protection et qui modifie l’équilibre de la société marocaine. Alors on a trois ébranlements : diplomatique, économique et social qui ont eu lieu au même moment. Le reste, ce sont les efforts entrecroisés et la suite de ces trois choses presque corrélatifs en l’espace de six ans seulement.

Q. On a dit aussi , sur le plan de la politique intérieure, que c’est aussi au fait que la bourgeoisie marocaine refusait de contribuer aux dettes contractées par le Mkhzen en recourant le cas échéant à la protection étrangère. On a pu dire que le protectorat du pays a débuté par le protectorat des individus. Qu’en pensez vous ?
J.L.Miège : Je pense qu’il y a un peu de vrai. On peut le constater objectivement. On ne peut pas porter de jugement de valeur.Car à distance et avec les travaux de tous les historiens qui se font depuis des décennies ; nous voyons comment l’histoire s’est déroulée. Mais les contemporains ne pouvaient pas avoir conscience de la portée d’un acte individuel qui était un acte d’intérêt matériel, de sauvegarde matérielle immédiate dont la portée n’a été qu’à longue durée mais par l’accumulation de ces décisions individuelles. Donc, il n’y avait pas du tout de prise de conscience qu’amènerait ce passage sous la protection individuellement, d’une puissance étrangère. Mais ces effets accumulés et additionnés le long des décennies a bien manifestement été très néfaste au pays : il a ouvert la porte au protectorat proprement dit et non plus à la protection des personnes.
Q. Est-ce que l’historien peut recourir au concept de la segmentarité qu’utilise l’ethnologue ou la sociologie pour expliquer la facilité de cette pénétration ?
J.L.Miège : D’abord, je dirai, qu’il n’y a pas de cloisons : nous sommes des spécialistes mais nous nous ignorons jamais les uns les autres. Il n’y a pas de cloisons entre les sciences humaines. Il est bien évident que le sociologue ne peut pas se passer de l’historien que l’ethnologue de l’anthropologue etc. Je contesterai peut – être un petit peu le mot de « facilité de pénétration », car tous les travaux montrent la lenteur de cette pénétration. Ma modeste contribution a montré que le protectorat n’avait pas éclaté brusquement mais qu’il avait été précédé par cette insidieuse, cette lente pénétration et dislocation d’une société pendant près de 60 et 70 ans et aussi – tous les travaux le montrent aujourd’hui – d’une longue et lente et forte résistance à cette pénétration. Donc, ce n’était pas une pénétration facile. Ça a été le long accouchement d’une nouvelle société.
 Q.Donc vous pensez que c’est une explication un peu facile que de dire que les travaux universitaires de tel ou tel ont aidé à mieux connaître le pays et à savoir mieux le dominer ?
Q.Donc vous pensez que c’est une explication un peu facile que de dire que les travaux universitaires de tel ou tel ont aidé à mieux connaître le pays et à savoir mieux le dominer ?
J.L.Miège : Vous savez comme dit un de mes collègues Lacoste – directeur de la revue de géographie Eurodote - la géographie n’est pas innocente, aucune science n’est en soi innocente : on peut se servir de la psychologie pour faire la guerre, de la géographie pour aider les guerriers, des travaux des historiens pour faire de la propagande politique. Donc, que ces travaux aient été utilisés, ils l’ont été comme l’étaient les travaux des arabisants ; des gens qui connaissent mieux la société pour mieux la contrôler. Mis je ne pense pas qu’ils aient été d’abord téléguidés préalablement avec cette volonté et qu’ils aient été rédigé par leurs auteurs dans la perspective d’une pénétration. Mais qu’ils aient été utilisé ? Très certainement. Dans la vie atuelle combien de découvertes pacifiques sont utilisées par les militaires et vise versa. Ce sont des connaissances globales qu’on utilise à un moment donné.

Q. Des historiens Marocains participant à ce symposium avancent qu’on a négligé, les sources arabes de l’histoire Marocaine…
J.L.Miège : Je pense que c’est exacte. Je ferai simplement trois remarques : d’une part ces archives ont été très longtemps peu lisibles et d’accès très difficile. Ils sont souvent moins riche qu’on ne l’espérait. Donc, c’est un des apports nouveaux mais tardifs de l’historiographie. Deuxièmement, en tant qu’historien, je dirai que pour moi, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises sources. Il peut y avoir de bonnes archives locales si elles sont bien interprétées et si elles sont justes ; comme il peut y avoir de mauvaises archives extérieures mais également de bonnes archives extérieures lorsque l’homme était honnête et a bien connu le pays. Donc, notre métier d’historien est d’utiliser toutes les sources d’archives en les contrôlant les unes par les autres, en leur appliquant à toutes les mêmes critères sans vouloir par leur origine les valoriser les unes par rapport aux autres. Ce qui est important ce n’est pas d’où elles viennent ; c’est le contenu de la réalité qu’ils abordent. Ceci dit, je crois que l’expansion de la recherche historique passe désormais de plus en plus par ces découvertes , ces publications et cette exploitation des manuscrits et des archives locales. Encore faudrait – il que la forêt ne soit pas cachée par l’arbre et qu’on n’arrive pas à une micro histoire à partir de petits documents que l’on survalorise parce qu’ils sont des documents locaux. Je crois qu’il faut un équilibre comme dans toutes les sciences de l’histoire spécifique, du Maroc mais replacée – nous en parlons tout à l’heure à propos du commerce saharien – dans l’histoire mondiale ; ce sont de grands courants dont on ne peut pas exclure le Maroc. Propos recueillis par Abdelkader Mana

Les illustrations de Patrice LAURIOZ nous dépeignent un pays enchanteur aux trainées de poudres salées et pourpre...
19:18 Écrit par elhajthami dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
30/05/2011
Cap Sim
Les sept vagues de l’aube
Essaouira, le 9 août 2003
J’ai marché, marché à n’en pas finir, depuis la baie immense et lumineuse d’Essaouira, jusqu’au-delà du cap Sim, sans rencontrer âme qui vive, hormis quelques tourterelles perchés aux branchages squelettiques et desséchés des mimosas. Car les dunes de sable sont d’une brûlure insupportables. J’arrive enfin à la crique où finit le cap Sim et où commence la baie sauvage et préhistorique de Kawki. C’est à ce moment-là — après m’être baigné dans l’océan glacial d’un bleu turquoise – qu’au bruissement des vagues, et sous le soleil zénithal, j’ai enfin le déclic salvateur : je proposerai à la revue française Immédiatement un article sur la jeune poésie du zajal dans le Sud marocain. Le cap Sim et le Zajal. Béni soit le cap Sim pour m’avoir fait une telle offrande de poésie.
La mer
Je ne l’ai pas trouvée là où elle posait ses mains
Où est partie la mer ce matin ?
Était-ce un poète qui serait passé par là ?
La mouette
Il n’a pas trouvé sur quoi écrire son désarroi
Était-ce un poète qui serait passé par là ?
De deux coquillages,
Une pierre de sagesse me parvient
En se roulant vers moi
Était-ce un poète qui serait passé par là ?
Il se demandait le long du fleuve :
Était-ce
Un poète
Qui serait
Passé
Par
Là
?
Je me suis rendu au cap Sim, puis à Kawki. Cela fait un trajet de vingt-cinq kilomètres à pied par une côte sauvage et magnifique. Bien entendu, je pense très fort à mon père décédé le 14 décembre 2002, qui est à l’origine de mon projet d’écriture : sauver de la ruine, les fragiles empreintes de ceux que nous aimons, c’est ne pas les perdre totalement. Et voilà, qu’à mi-parcours, je tombe sur un coquillage rare dans les parages, et pas n’importe lequel : une nacre . C’est le type même de ces coquillages avec lesquels mon père décorait les tables d’arar (thuya) durant toute sa vie de labeurs, de sueurs et de prières. Chez les Argonautes du Pacifique occidental aussi, la circulation des coquillages souleva (blanc) et mwali (rouge) signifie, d’une certaine manière, le retour de la mémoire des morts. Pour quiconque, une telle rencontre nacrée est simple coïncidence, pour moi, c’est l’esprit toujours vivant de mon père, qui m’envoie ainsi ce message cosmique pour apaiser ma désolation et ma solitude.

Un peu plus loin, au milieu du cap Sim, je découvre une plante médicinale du nom vernaculaire d’ajebbardou, que deux jours auparavant, ma mère m’avait réclamée : on malaxe cette plante charnue avec de l’huile d’olive et l’on s’en enduit le corps pour se débarrasser des mauvais esprits — les esprits du vent qu’on nomme ariah — ou on la met sous l’oreiller d’enfants souffrant de cauchemars. Ma mère souffrait d’hallucinations dues à une tumeur au cerveau et elle en a besoin pour cette raison.
Les deux messages cosmiques signifient aussi que mes racines profondes se trouvent dans ces lumineux rivages et que, partout ailleurs, je pourrais peut-être gagner plus d’argent mais serais toujours comme une nacre hors de l’eau, une plante hors de sa terre nourricière.
Essaouira, le 10 août 2003
Face au crépuscule et au hadir (grondement de mer) mon ami Raji me fait de vive voix le récit de ses poèmes dont celui dédié à ces marins que les femmes attendent au rivage et qui ne reviennent jamais :
Chaque vague est un ancien pêcheur
Mort de noyade
La vague peut-elle se noyer en elle-même ?
La mer est plus longue qu’une canne de pêcheur
Ce n’est pas moi qui le dis
Ce sont les fuites d’eau au travers des mailles du filet.
Métaphore des espèces en voie de disparition en ces parages — algues, poissons, arbres, hommes, culture — la grande coupe de forêt à laquelle procèdent des bûcherons aux environs du cap Sim : des mimosas et des eucalyptus qui ne fleuriront plus cette année. Les bûcherons brûlent tout, sauf ce genre de thuya, qui pousse aux abords de l’océan, parce que contrairement au thuya de l’Atlas, dont se servait mon père en tant que marqueteur, il ne repousse jamais après la coupe.

Entre les racines du cœur et l’esprit de la terre
L’arbre déteste la hache
Et le visage du bûcher
Il préfère le serpent multicolore
Qui glisse comme le désir sur sa peau
Brûlure du midi au cap Sim, fraîcheur des algues à la lisière des eaux douces et des eaux salées, envol d’oiseaux de mer au gré des alizés esprit de la terre qui nous rattache aux morts, à nos morts ; brûlure des interrogations, déracinement des hommes.
Lundi 18 août 2003
Journée lumineuse. Abondants arrivages au port. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Essaouira est port méditerranéen sur l’Atlantique. Non seulement en raison de son histoire ancienne de port-relais entre les caravanes de Tombouctou et les caravelles de la lointaine Europe, mais aussi en raison des mutations en cours : tout ce que compte la médina de beaux riads est désormais entre les mains de résidents venus de l’autre rive et de l’autre vent. Le pouvoir brutal et imperceptible de l’argent.
Un sentiment de dépossession semble s’être emparé des natifs de la ville vendue au plus offrant. Ils se sentent marginalisés, expulsés de leur propre ville. Hors jeux. Même la culture — ou plutôt ce qui en tient lieu, en termes de communication version marketing y est désormais animée d’une manière extravertie. Le fait d’être un Ould Blad (enfant du pays), ne vous donne aucune légitimité pour bénéficier des substantielles prébendes du sponsorat que génèrent des festivals forcément internationaux. Au contraire. Tout ce qui dans le local ne peut pas rimer avec le global est exclu. Ainsi les Gnaoua riment avec les musiques du monde, par rapport à ces gens de l’ombre que sont devenus les Hamadcha, les Aïssaoua et autres musiques de l’extase. La reconnaissance de la culture locale est désormais tributaire de la mode et de l’esthétique dominante au niveau mondial. Tout ce qui n’est pas moderne dans le local est destiné au Musée de l’ethnographie, lui-même relégué aux oubliettes de l’histoire depuis 1989. Développement local sans la participation des locaux. C’est cela aussi, la mondialisation.
« On a vendu les clés de la ville », disait mon père.
On a vendu la ville tout court et ô suprême dérision, au nom de la sauvegarde même de la ville ! Le tiers des maisons de la médina est désormais aux mains d’Allemands, de Bretons, d’Italiens, de Danois, d’Anglais, d’Américains. Il y a même une Zimbabwéenne blanche, toujours élégante, par-delà les âges.
Et la vente aux enchères continue ! Ici, les gens sont pauvres, m’explique un courtier de la ville, lorsqu’ils entendent cent millions de centimes, ils cèdent immédiatement leur maison. Des quartiers entiers sont maintenant occupés majoritairement par des Européens. Bientôt, il va falloir un visa aux Marocains pour accéder à la médina…
Pour le moment notre vieille maison n’est pas à vendre. Par le passé, elle appartenait au négociant Touf El Âzz, l’un des actionnaires du bateau à voile Le Prophète qui reliait Essaouira à Marseille.
Avec la bataille dite d’Isly, qui préfigurait au Maroc la pénétration capitaliste et coloniale, les habitants ont pu retrouver après l’accalmie leurs maisons et leur culture. Avec la mondialisation, les nouvelles règles du jeu édictées par l’OMC et l’argent - roi – tout est à vendre l’ethnopeinture des artistes « singuliers » comme les plus belles filles de la ville, les habitants risquent de ne plus retrouver ni leurs maisons, ni leur culture. Quand les écarts de niveau de vie confinent à la provocation, comment les échanges « psychologiques » peuvent-ils être équilibrés entre l’autochtone et l’allogène ? Des Souiris de souche disent qu’ils sont reçus avec moins d’égards que les résidents européens par les autorités de tutelle. Vraie ou fausse, une telle perception est la traduction d’un climat qui rappelle une urbanité de type colonial.
Morts sont les gens du Rzoun, cette compétition chantée, ce charivari carnavalesque, qui opposait jadis, à chaque nouvel an, les deux clans de la ville : les Béni Antar, ces gens de la mer et de l’Ouest, aux Chebanates, ces nomades du désert, du feu et de la terre. Avec la disparition du Rzoun, c’est un peu des repères de la ville qui se perdent :
Permettez-moi donc d’avouer
Les soucis qui m’oppressent
Et si je meurs, que personne ne me pleure
Mais quel est votre chef ô Chebanate ?
Osman à la tête bossue
Et à la bedaine serrée d’une cordelette ?
Et qui est votre chef Ô Béni Antar ?
Ali Warsas traînant au port son chien
Éternellement sur son âne ?
Le modèle culturel urbain est menacé de disparition, en tant que corporation d’artisans, en tant que confréries religieuses, en tant que communautés de voisinage et de sentiments.
Devant le chalet de la plage, une sculpture de Miloudi à la signification sans équivoque : « Main basse sur la ville ». Le patron du chalet de la plage n’en revient pas des spéculations en cours :
" Les Européens arrivent ici avec un petit capital, achètent une maison, la transforment en restaurant, et la revendent quelques années plus tard à dix fois son prix. Et dire qu’ils sont venus « investir » !.
De démographiquement majoritaires, les habitants de la ville sont devenus psychologiquement et politiquement minoritaires. Il est d’ailleurs significatif que Dar Souiri ait été en même temps le siège du Centre culturel français, en attendant qu’il soit transféré à la vieille demeure où l’explorateur Charles de Foucauld fut reçu en 1884 par un orchestre andalou animé par des musiciens juifs et musulmans, dont le chantre mogadorien David Iflah… À Essaouira, les pouvoirs — à commencer par celui du Makhzen — sont toujours venus d’ailleurs.
Partout s’installent des bazaristes venus du Grand Sud. Dans une ville-bazar. Il n’y a plus d’artisans incrustant la nacre dans les essences de l’Atlas. Les artisans meurent, émigrent ou noient leur chagrin dans le vin.
Je passe devant l’atelier de mon père : fermé.
Celui d’Amseguine, le maître des rebouteux, également.
Celui de Ba Antar avec ses tables d’arar aux dessins géométriques et floraux complexes, aussi.
Les grands maîtres de l’artisanat local morts, ne reste plus qu’un immense bazar. Les Rifains en nouveaux seigneurs du port, les Sahariens pour les bazars, et les Européens pour les riads, voilà la nouvelle configuration du peuplement d’une ville où il faut être désormais du tourisme ou ne pas être.
De « carrefour culturel », Essaouira n’est plus qu’une station balnéaire, où la plage – le convivial taghart de notre enfance, jadis dédié aux compétitions sportives entre quartiers est désormais vendue aux résidents d’hôtels de luxes et quadrillée de policiers, à moto, à cheval et à pied, et le soir venu, violemment éclairé par de puissants projecteurs : surveiller et punir… Il est loin le temps où les femmes venaient se débarrasser du mauvais sort, aux sept vagues de l’aube, le temps où des devineresses berbères prédisent l’avenir en écoutant des térébratules fossiles, le temps où l’on n’osait pas s’approcher des vagues les nuits obscures, de peur d’être frappé par les déesses de la mer. Bref, il est loin le temps des ensorcellements et des mystères. Voici venu le village planétaire des marchandises… et des rencontres virtuelles des solitudes.
Seul le mellah, le quartier juif, taudifié et en partie effondré, échappe encore à cette balnéarisation mondialisée, parce que trop exposé aux embruns. Mais guère pour longtemps… Au mellah un flot de touristes est invité par un guide à visiter une vieille maison juive sur laquelle est écrit :
« Cette maison est à vendre : porte ouverte à l’acheteur ». C’est au pied de cette même maison témoin d’une période révolue qu’un jour, vers le coup de seize heures, alors que je m’amusais avec les enfants de Papes qui possédait le bain maure du même nom, où en 1949 Orson Welles avait tourné des scènes d’Othello que par un cri déchirant, j’avais découvert pour la première fois la séparation et la mort… La juive qu’on voyait toujours avec son mari au balcon, avait brusquement surgi à sa fenêtre, éplorée, se frappant la poitrine : elle venait de perdre pour toujours le compagnon de sa vie, et pour nous, le voisin d’une autre vie, d’une autre ville… Le mellah est maintenant mémoire béante ouverte sur le ciel et le vent, en attendant son improbable sauvegarde par l’UNESCO.
Le Mardi 19août 2003
Ni ciel, ni mer, un seul bleu éclat de lumière. Au fond de la baie, un pêcheur retire son filet vide de l’océan et de l’azur. De mon oncle paternel – Da Omar le coléreux poissonnier adepte de la confrérie disparue des Aïssaoua, mort une aube des années soixante-dix, il se souvient encore. Cela me rassure, que notre nom ne soit pas totalement éteint, puisque la baie s’en souvient toujours. Le vieux pêcheur fournissait mon oncle en captures d’une baie jadis poissonneuse :
- Au lieu-dit « Ma Lahlou » (eau douce, là où une source jaillit à la lisière des vagues, où se désaltèrent les récolteurs d’algues), je pouvais prendre dans mes filets, jusqu’à soixante-dix kilos d’ombrines et de loups. L’ombrine ne coûtait qu’un demi -dirham le kilo, et guère plus de trois pour le loup. La sargala (la bonite) qui a disparu des parages, on la jetait aux chats.
Sous la roue de sa bicyclette jetée à même le sable, gît l’unique capture du jour : une pauvre serelle. Où sont passés les poissons ?
- En vingt-quatre heures, je n’ai rien pêché. Mais celui qui a trouvé sa gana – terme utilisé par les artisans locaux dans le sens de « disposition d’esprit propice à la création » - en travaillant avec la mer, ne peut plus travailler avec les hommes.
Au moment de nous quitter, il m’offrit la serelle :
- Tu trouveras plus loin de quoi la griller.
Je lui offre pour ma part une grappe de raisin. Cette année, les raisins sont certes aussi sucrés et charnus que d’habitude, mais leur taille est anormalement petite. La sécheresse en est la cause, mais aussi les rejets chimiques du complexe phosphatier de Safi, qui auraient affecté les oliveraies de la plaine atlantique et les fonds marins. Un ânier nous offre le feu :
- Ne me remerciez pas, ne sommes-nous pas enfants de la même ville ?
- Nous sommes la ville elle-même, lui rétorque Raji. Nous sommes son sourire amer quand elle se dénude face au miroir. La ville, c’est du ciment mêlé au secret.
- Quel secret ?
- La peur du silence au fond de la nuit. Mon ombre et ton ombre effacées.
La mer gronde sous le vent et déjà l’homme à l’âne n’est plus que mirage au fil des dunes.
« Le monde est tout ce qui arrive », disait Watsenstein.
Et ce qui nous arrive en ce moment est d’être là, face à nous-même et à ce fantomatique cormoran étalant ses ailes noires sur les rochers à la lisière des vagues :
- L’ombre s’efface, constate Raji. Mon ombre et ton ombre effacées. Nous ne sommes que des fantômes invisibles.
Lieu de communication et d’écriture, karkora, le tas de pierres sacrées que la mer couvre et recouvre au gré des marais et des saisons. Parole de récolteur d’algues :
- Il faut récolter une grosse quantité d’algues, pour avoir une galette d’orge.
Et pour retrouver la paix de l’âme, le violon bleu cherchera en vain la femme, pour jouer sur sa poitrine la musique des flux et des reflux des nouvelles lunes…Une musique douloureuse, sur la trace de ceux que nous avons aimés et que nous n’avons jamais retrouvés. La mer et l’amour ont l’amer en partage, m’écrit Falk. Et c’est le légendaire aède berbère qui le dit :
De tous ceux qui sont passés
Hélas, tu te souviens,
Tu connaîtras que la vie n’est rien qu’un chemin…
Au port, le patron du restaurant Coquillages un ami d’enfance me promet une sortie en mer, avec un sardinier ou un chalutier, le vendredi ou le samedi prochain. Un Raïs rifain me recommande vivement le chalutier Azzam II (quelque chose comme « le deuxième souffle »), d’une part, parce qu’il parcourt plus de milles qu’un sardinier, et d’autre part, parce qu’on y mène une véritable vie sociale à bord. Une ultime raison me décide : le chalutier lève les amarres à l’aube.
Le vendredi 22 août 2003
Aux affaires maritimes, on ne voit pas d’inconvénient à ce que je sorte en mer avec le navire de mon choix, à condition qu’on m’enrôle sur la liste d’un équipage…
- Quatre heures du matin largua d’ici éclate de rire Abahhû croisé à la porte de la marine, qu’on encensait jadis pour apaiser les esprits de la mer. Dans le subconscient maghrébin, la mer est toujours synonyme de mort.
- C’est quoi « largua » ?
- Larguer les amarres en espagnol.
- Te souviens-tu de sargala ?
- Nous l’appelions « poisson juif », parce qu’il était très apprécié au repas du shabbat. Les Français l’appellent « bonite », je crois.
- Ça fait des lustres que ce sargala a disparu ?
- On le retrouve plus qu’aux rivages du Sahara, du côté de la Mauritanie. Une espèce en voie de disparition au même titre que d’autres poissons migrateurs.
Raji s’enthousiasme pour mes projets d’écriture en haute mer :
Le poisson ne se lave pas le visage le matin,
La mer est son visage lavé.
Depuis ce blanc sel, depuis ce bleu éternel…
Avant que les portes de la ville ne se ferment le soir, une femme grimpait au sommet du vieux figuier pour scruter à l’horizon l’improbable retour du bien aimé, mort de noyade. En vain, elle adressait ses folles suppliques à la nuit et à la mer :
La mer est le marin lui-même
Toi, la veuve, ton mari n’est point mort
Il est redevenu vagues
Car, terrien, il ne l’était que par erreur
L’âme de la lune attire la mer vers les vagues
Ton mari n’est pas mort
Il est revenu au bleu originel des vagues
Il est revenu au blanc-sel originel
À l’infini itinéraire des éternités
Ô veuve, ton mari n’est pas mort !
Terrien, il l’était par erreur
Seule la mer est à même de rectifier
Les généalogies et les origines
Pourquoi grimpes-tu donc au vieux figuier ?
Qu’il soit à Bab Marrakech ou à la porte de la marine ?
Les racines de cet arbre vont te murmurer ses nouvelles
Tel le vieux voyant de la ville
Qu’est moi-même avant de naître
L’arbre est le mirage de l’âme secrète
De la mer dans un coquillage
Ce qui scintille au lointain horizon
N’est pas la chandelle qui illumine ce cap Sim
Mais l’âme éternelle du marin
Au plus profond des vagues…
La peur du grand large, chacun l’exorcise à sa manière, moi par l’écriture, mon frère Majid par l’achat d’une arganeraie, juste avant son départ pour la France. L’écriture et la terre, c’est pour partir sans jamais partir.
Le samedi 23 août 2003
1 h 30. J’ai peu dormi. Le jeune mousse m’avait demandé de me présenter au port à 2 heures du matin. C’est la première fois que j’accompagne un chalutier en haute mer. Et si je n’en revenais pas ? Ces derniers temps un paquebot aurait heurté au Sahara un chalutier : tous les marins sont portés disparus. Je pars avec de l’eau, des raisins et des figues. Il va falloir se couvrir, car froide est la haute mer. La ville dort encore. Elle est silencieuse. Mais une fois franchie la porte de la marine, énormes grondements de moteurs :
Le grondement des navires lointains
Nostalgie de qui à qui ?
La plupart des équipages quittent les cales où l’on s’endort, allument les lumières, s’activent sur les ponts, mettent simultanément les moteurs en marche. Le port s’endort. Le port se réveille. J’arrive à temps : le chalutier Azzam II où je suis enrôlé est toujours à quai. Le jeune mousse vient me souhaiter la bienvenue à bord.
- Tout l’équipage est au courant que je suis du voyage ?
- Bien sûr, on t’a enrôlé in extremis, alors que la Marine fermait déjà ses portes. Sans quoi vous seriez resté à quai…
On ne larguera les amarres qu’à l’approche de l’aube. On ira du côté de cap Sim, qu’on appelle aussi « trou espagnol », parce que les navires s’y mettent à l’abri des tempêtes. Si je retrouve ainsi le cap Sim, c’est signe que je suis en train de prendre le bon cap. En haut des mâts, j’entrevois le croissant de lune. Il fait sombre. De petites barques quittent le port. C’est pour la pêche à la langouste. Les mouettes survolent les bateaux en éternelles gardiennes du port. Et de Raji me survient ce poème :
À l’oiseau couleur d’âme
Des battements d’ailes
En guise d’à-Dieu.
On ira loin, plus loin que le cap Sim.
Légère brise, « cette chevelure du vent » qui scella mon amitié au jeune poète :
Pour apaiser ses gémissements
Elle peignait la chevelure du vent
Le coquelicot n’est que brise
Si son parfum n’était si fort
L’abeille amoureuse l’aurait dédaigné
Ô mon fils, lui a-t-elle dit
Quand on a annoncé au coquelicot
Qu’on doit lui couper la tête
Le coquelicot enlaça et embrassa son propre sang
Au coquelicot les rites funéraires furent des noces
Ô mon fils lui a-t-elle dit
La mer, sa magie et sa grâce
On a cru pouvoir l’enfermer dans un cercueil
Mais sa veine déborda d’une blessure salée
Et brisa le cercueil…
La mer, ne la fait pas monter par une canne
Ne la fait pas monter au bord d’un hameçon
Laisse la mer à la mer
Laisse la mer à sa guise
« Pour la pensée, les signes ont la même importance qu’eût pour la navigation, l’idée d’utiliser le vent afin d’aller contre le vent », écrivait le mathématicien autrichien Gottlob Frege. L’idée d’utiliser le signe pour aller contre l’amnésie et la mort. C’est en cette même heure sombre de la nuit, que mon père nous a quittés : il parvint dans un dernier souffle à prononcer le nom qu’il m’avait donné. Les prières augmentent les lumières des étoiles, et jettent un pont par-dessus la mort.
Quelle idée blessante fait tourner le sable ?
Les vides de son hémorragie
Sont cousus par la montée écumante du sel.
Quelle idée blessante fait tourner le sable ?
Ce qui te fait gronder ô mer
N’est pas la mer
Ce sont les blessures du martyr Hallaj
Quelle idée blessante fait tourner le sable ?
Mille et un clapotis de rames l’apaisent.
On s’active sur le pont. Hormis un marin autochtone Chiadma, tout l’équipage est d’origine rifaine. On prépare les filets, on actionne le treuil, on largue les amarres. Il est exactement 3h30, quand Azzam II s’engage dans la baie sombre. Derrière nous la ville dort encore. Mer calme tant que nous sommes dans la baie protégée de la houle par l’île au large. Mais une fois franchie cette barrière, vertige tant que durera le cap vers le sud. Au sombre firmament, le croissant de lune. L’équipage rejoint à nouveau la cale pour dormir. Le chalutier vogue par-dessus les grosses vagues, en draguant le filet à vive allure : racler les fonds marins de sorte qu’au passage les poissons se trouvent pris au piège.
Tel un cancre aveugle
Le marin libère la lune de ses filets
En point d’interrogation ( ?)
Maintenant la proue ne pense qu’à l’hameçon
La mer est un hameçon
Qui dort
Dans la tête
D’un homme bleu
Il lui arrive de pêcher, des poissons dont il ne connaît même pas le nom
La mer perdue,
La mer qui n’a laissé aucune trace,
Renaît en permanence sous forme de poèmes,
Qui lèvent leur chapeau à sa majestueuse étendu bleu…
Au levé du jour, bleu d’azur, bleu profond, une caravelle se pose sur le mât. Une lourde charge ralentit le dragage. Était-ce une grosse prise ? Une de ces baleines qui hantent les parages ? De soixante-seize brasses de profondeurs, on retira finalement une énorme météorite. Des poulpes, des crabes, des coquillages, des dorades et des sérails frétillants. Le Raïs décide de rentrer au port. Entrer en mer, c’est mourir. En sortir, c’est renaître. De quelle lumière est l’horizon ? La mer l’a surpris de nuit, par un coup de pinceau couleur d’azur.
Le soir de mon départ pour Casablanca, la campagne électorale bat son plein. Elle ne me concerne point. J’apprends le décès d’Abdelaziz, le dernier infirmier des Béni Antar. Il vivait reclus depuis longtemps. On l’a enterré presque incognito, alors qu’il y a quelques années toute la ville aurait suivi son cortège funèbre. Avec lui, c’est un peu d’Essaouira de notre enfance qui meurt. Et puis ce terrible Haïkou de mon ami Raji :
Dans les innombrables urnes
Un seul mort
Le pays
Cette terre où nous sommes nés, nous appartient-elle toujours ? Avant l’écriture et après l’écriture, le silence.
Abdelkader MANA
21:39 Écrit par elhajthami dans Poésie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poèsie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook